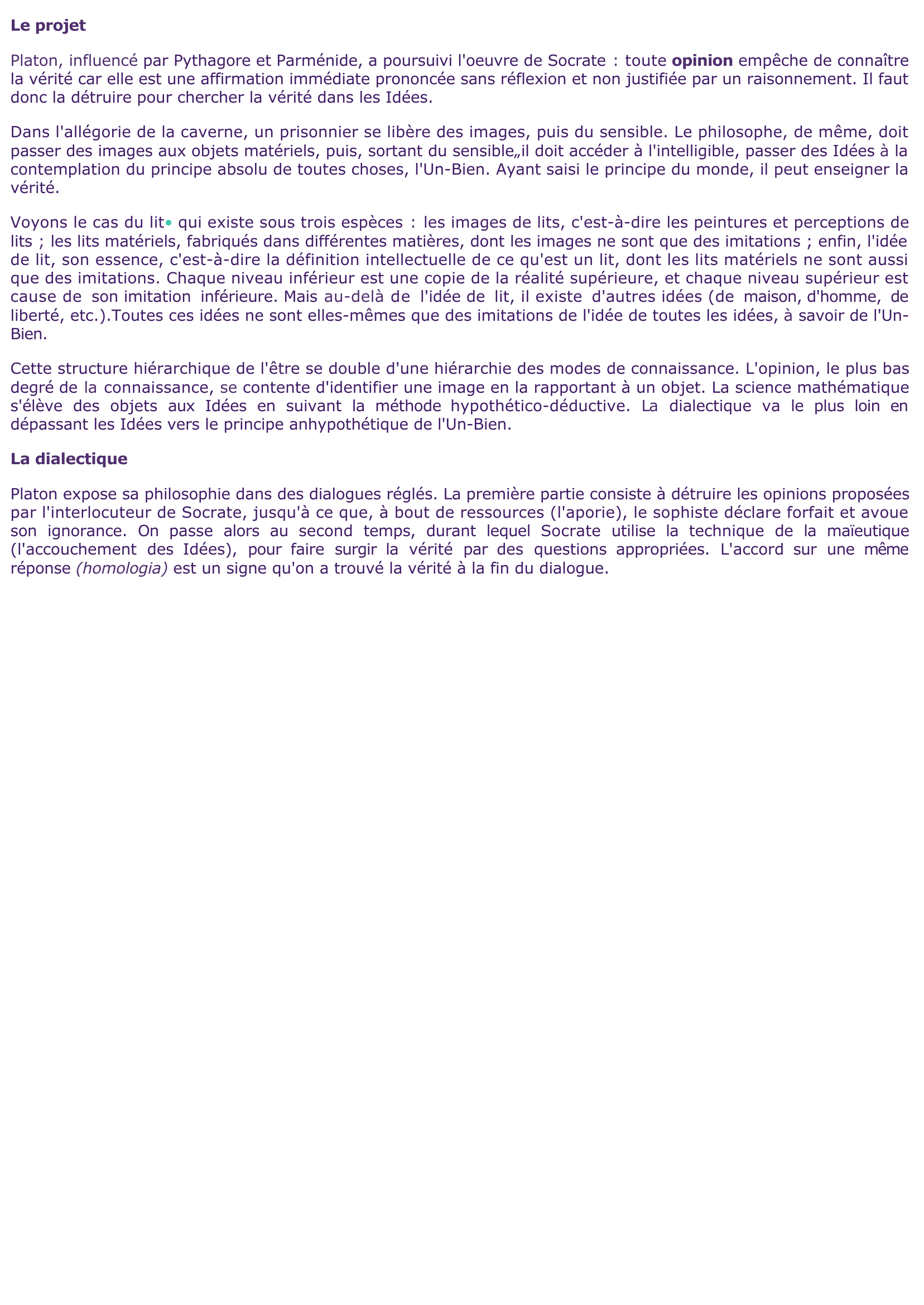Qu'est-ce que le platonisme ?
Publié le 11/01/2010

Extrait du document
I. LES IDÉES ET LES OMBRES — A — De la sensation à l'Idée. Les contradictions des sensations et les insuffisances de la connaissance sensible (Cf. le Théétète) conduisent Platon à chercher la vérité au-delà du monde sensible dans le monde intelligible ou monde des Idées. Il ne saurait y avoir de vérité, en effet, dans cet écoulement perpétuel qui s'offre à nos sens. Le vrai d'une chose, c'est son essence, immuable et parfaite, que Ton ne peut saisir qu'avec l'intelligence seule. « Nous avons coutume de poser une idée distincte pour chacune des multitudes auxquelles nous donnons le même nom « (Phèdre). Le caractère essentiel de cette idée est d'être « une dans une multitude « (Rep. X). Ce sont les Idées du monde intelligible qui donnent un sens aux apparences du monde sensible (Mythe de la caverne, Rep. VII). Aussi longtemps que l'on s'en tient aux apparences, on reste dans le domaine de l'opinion, et l'opinion vraie n'est pas encore la science (symbole de la ligne, Rep. VI). — B — La réminiscence. Savoir vraiment c'est savoir par les causes c'est-à-dire expliquer par les principes, rendre raison. Mais, tandis que le savant pose les principes pour expliquer les apparences, le dialecticien part de ces principes pour s'élever jusqu'aux Idées qui les fondent et à l'Idée suprême qui est l'Idée du Bien. Ces Idées, nous les connaissons lorsque « l'œil de l'âme « se tourne vers elles, ou plutôt nous les reconnaissons parce que l'âme a vécu dans le monde des Idées avant de s'incarner dans un corps et de tomber dans le monde sensible (mythe de l'attelage ailé dans le Phèdre). Ainsi la connaissance vraie est réminiscence : « chercher et apprendre n'est autre chose que se souvenir « (Ménon). Par exemple c'est en nous ressouvenant de l'Égalité en soi que nous pouvons dire que des choses sensibles sont égales, car elles ne le sont jamais parfaitement (Cf. le Phédon). C'est notamment l'amour des belles choses qui nous arrache du monde sensible pour nous élever jusqu'au monde des Idées, si bien que «l'amour est philosophe « (Banquet) et que c'est au contact de la beauté que les ailes de l'âme commencent à repousser (Cf. Phèdre).
«
Le projet
Platon, influencé par Pythagore et Parménide, a poursuivi l'oeuvre de Socrate : toute opinion empêche de connaître la vérité car elle est une affirmation immédiate prononcée sans réflexion et non justifiée par un raisonnement.
Il fautdonc la détruire pour chercher la vérité dans les Idées.
Dans l'allégorie de la caverne, un prisonnier se libère des images, puis du sensible.
Le philosophe, de même, doitpasser des images aux objets matériels, puis, sortant du sensible„il doit accéder à l'intelligible, passer des Idées à la contemplation du principe absolu de toutes choses, l'Un-Bien.
Ayant saisi le principe du monde, il peut enseigner lavérité.
Voyons le cas du lit • qui existe sous trois espèces : les images de lits, c'est-à-dire les peintures et perceptions de lits ; les lits matériels, fabriqués dans différentes matières, dont les images ne sont que des imitations ; enfin, l'idée de lit, son essence, c'est-à-dire la définition intellectuelle de ce qu'est un lit, dont les lits matériels ne sont aussique des imitations.
Chaque niveau inférieur est une copie de la réalité supérieure, et chaque niveau supérieur estcause de son imitation inférieure.
Mais au-delà de l'idée de lit, il existe d'autres idées (de maison, d'homme, de liberté, etc.).Toutes ces idées ne sont elles-mêmes que des imitations de l'idée de toutes les idées, à savoir de l'Un- Bien.
Cette structure hiérarchique de l'être se double d'une hiérarchie des modes de connaissance.
L'opinion, le plus basdegré de la connaissance, se contente d'identifier une image en la rapportant à un objet.
La science mathématique s'élève des objets aux Idées en suivant la méthode hypothético-déductive. La dialectique va le plus loin en dépassant les Idées vers le principe anhypothétique de l'Un-Bien.
La dialectique
Platon expose sa philosophie dans des dialogues réglés.
La première partie consiste à détruire les opinions proposéespar l'interlocuteur de Socrate, jusqu'à ce que, à bout de ressources (l'aporie), le sophiste déclare forfait et avoueson ignorance.
On passe alors au second temps, durant lequel Socrate utilise la technique de la maïeutique(l'accouchement des Idées), pour faire surgir la vérité par des questions appropriées.
L'accord sur une mêmeréponse (homologia) est un signe qu'on a trouvé la vérité à la fin du dialogue..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Platonisme (résumé et analyse)
- L'anti-platonisme moderne · Nietzsche et Platon
- Le néo-platonisme
- LE NÉO-PLATONISME DANS LES PREMIERS APRÈS SIÈCLES J.-C.
- le platonisme