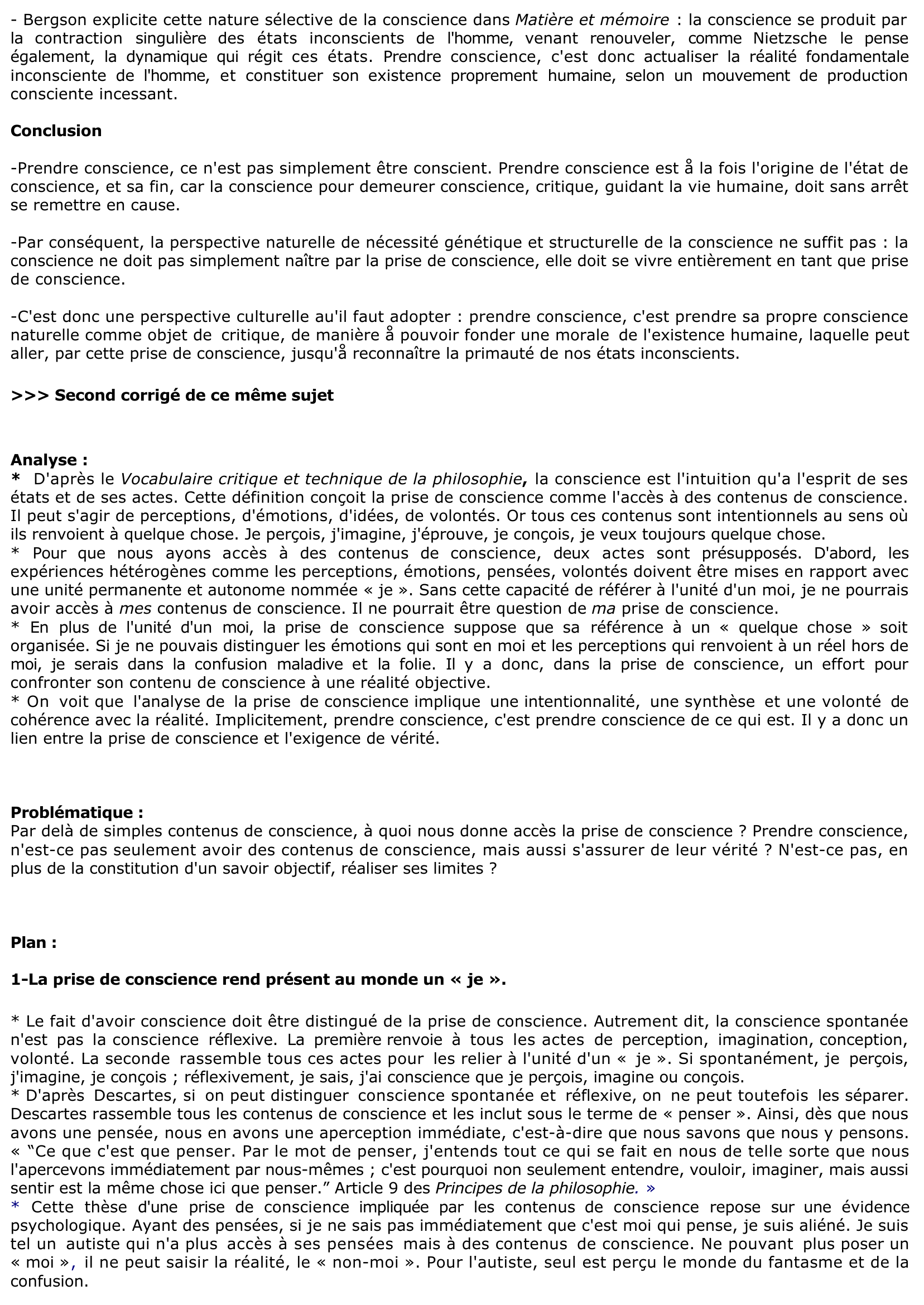Qu'est-ce que prendre conscience ?
Publié le 27/02/2005

Extrait du document

La conscience nous apparaît comme un phénomène spontané : nous nous découvrons immédiatement comme conscients. Cependant, le terme de “prendre conscience semble bien indiquer que cette conscience est l’objet d’une activité, malgré l’immédiateté apparente de ce phénomène. De plus, le donné de la conscience n’est peut-être pas suffisant pour définir complètement toute prise de consience. Prendre conscience, n’est-ce pas ainsi s’élever au-delå de notre simple état de conscience naturel, pour décider d’une tâche propre å cette conscience ? Comment le donné immédiat de la conscience, et sa production, s’articulent-t-ils å une possible tâche morale de la conscience ?

«
- Bergson explicite cette nature sélective de la conscience dans Matière et mémoire : la conscience se produit par la contraction singulière des états inconscients de l'homme, venant renouveler, comme Nietzsche le penseégalement, la dynamique qui régit ces états.
Prendre conscience, c'est donc actualiser la réalité fondamentaleinconsciente de l'homme, et constituer son existence proprement humaine, selon un mouvement de productionconsciente incessant.
Conclusion -Prendre conscience, ce n'est pas simplement être conscient.
Prendre conscience est å la fois l'origine de l'état deconscience, et sa fin, car la conscience pour demeurer conscience, critique, guidant la vie humaine, doit sans arrêtse remettre en cause.
-Par conséquent, la perspective naturelle de nécessité génétique et structurelle de la conscience ne suffit pas : laconscience ne doit pas simplement naître par la prise de conscience, elle doit se vivre entièrement en tant que prisede conscience.
-C'est donc une perspective culturelle au'il faut adopter : prendre conscience, c'est prendre sa propre consciencenaturelle comme objet de critique, de manière å pouvoir fonder une morale de l'existence humaine, laquelle peutaller, par cette prise de conscience, jusqu'å reconnaître la primauté de nos états inconscients.
>>> Second corrigé de ce même sujet Analyse :* D'après le Vocabulaire critique et technique de la philosophie , la conscience est l'intuition qu'a l'esprit de ses états et de ses actes.
Cette définition conçoit la prise de conscience comme l'accès à des contenus de conscience.Il peut s'agir de perceptions, d'émotions, d'idées, de volontés.
Or tous ces contenus sont intentionnels au sens oùils renvoient à quelque chose.
Je perçois, j'imagine, j'éprouve, je conçois, je veux toujours quelque chose.* Pour que nous ayons accès à des contenus de conscience, deux actes sont présupposés.
D'abord, lesexpériences hétérogènes comme les perceptions, émotions, pensées, volontés doivent être mises en rapport avecune unité permanente et autonome nommée « je ».
Sans cette capacité de référer à l'unité d'un moi, je ne pourraisavoir accès à mes contenus de conscience.
Il ne pourrait être question de ma prise de conscience. * En plus de l'unité d'un moi, la prise de conscience suppose que sa référence à un « quelque chose » soitorganisée.
Si je ne pouvais distinguer les émotions qui sont en moi et les perceptions qui renvoient à un réel hors demoi, je serais dans la confusion maladive et la folie.
Il y a donc, dans la prise de conscience, un effort pourconfronter son contenu de conscience à une réalité objective.* On voit que l'analyse de la prise de conscience implique une intentionnalité, une synthèse et une volonté decohérence avec la réalité.
Implicitement, prendre conscience, c'est prendre conscience de ce qui est.
Il y a donc unlien entre la prise de conscience et l'exigence de vérité.
Problématique :Par delà de simples contenus de conscience, à quoi nous donne accès la prise de conscience ? Prendre conscience,n'est-ce pas seulement avoir des contenus de conscience, mais aussi s'assurer de leur vérité ? N'est-ce pas, enplus de la constitution d'un savoir objectif, réaliser ses limites ? Plan : 1-La prise de conscience rend présent au monde un « je ».
* Le fait d'avoir conscience doit être distingué de la prise de conscience.
Autrement dit, la conscience spontanéen'est pas la conscience réflexive.
La première renvoie à tous les actes de perception, imagination, conception,volonté.
La seconde rassemble tous ces actes pour les relier à l'unité d'un « je ».
Si spontanément, je perçois,j'imagine, je conçois ; réflexivement, je sais, j'ai conscience que je perçois, imagine ou conçois.* D'après Descartes, si on peut distinguer conscience spontanée et réflexive, on ne peut toutefois les séparer.Descartes rassemble tous les contenus de conscience et les inclut sous le terme de « penser ».
Ainsi, dès que nousavons une pensée, nous en avons une aperception immédiate, c'est-à-dire que nous savons que nous y pensons.« “Ce que c'est que penser.
Par le mot de penser, j'entends tout ce qui se fait en nous de telle sorte que nousl'apercevons immédiatement par nous-mêmes ; c'est pourquoi non seulement entendre, vouloir, imaginer, mais aussisentir est la même chose ici que penser.” Article 9 des Principes de la philosophie .
» * Cette thèse d'une prise de conscience impliquée par les contenus de conscience repose sur une évidence psychologique.
Ayant des pensées, si je ne sais pas immédiatement que c'est moi qui pense, je suis aliéné.
Je suistel un autiste qui n'a plus accès à ses pensées mais à des contenus de conscience.
Ne pouvant plus poser un« moi » , il ne peut saisir la réalité, le « non-moi ».
Pour l'autiste, seul est perçu le monde du fantasme et de la confusion..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- prendre conscience de soi nous change t-il en un autre ?
- Prendre conscience de soi
- Qu'est ce que prendre conscience ?
- Suffit-il de prendre conscience de ce qui nous détermine pour nous en libérer ?
- Faut-il changer pour prendre conscience de soi ?