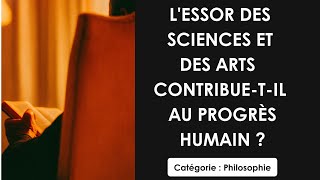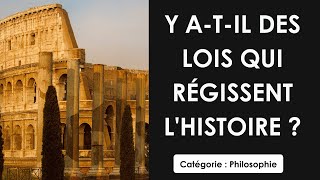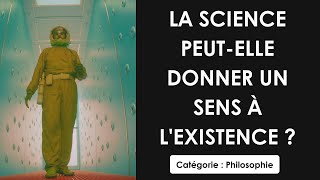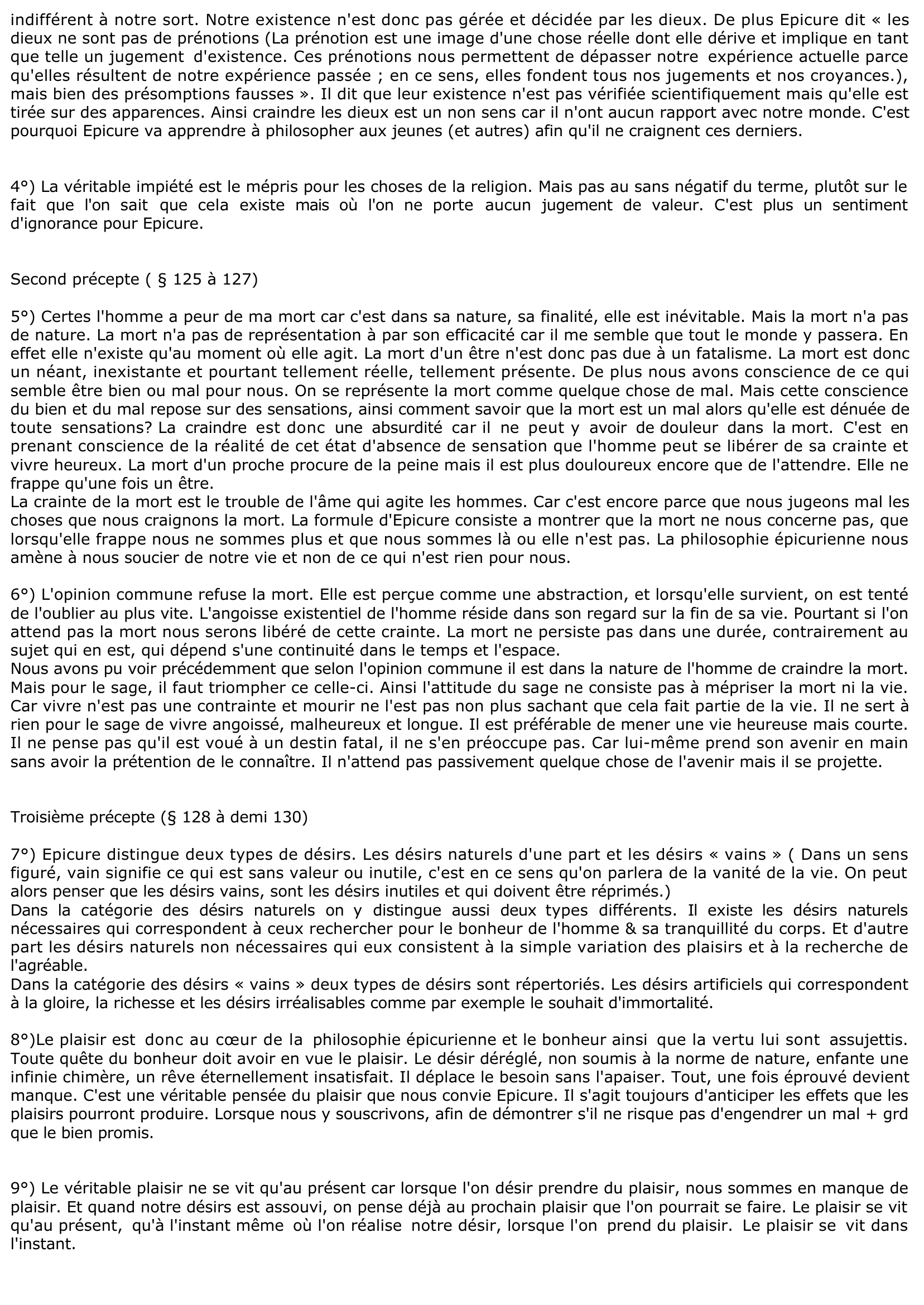Questionnaire sur la Lettre à Ménécée d’Epicure
Publié le 06/03/2011

Extrait du document
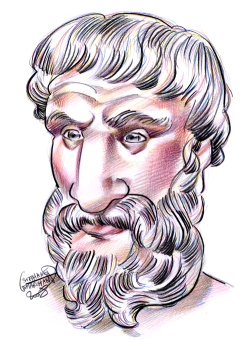
Préambule ( § 122 ) 1°) Epicure relie ici par le principe de causalité l’acte de philosopher et le bonheur: pour être heureux il faut pulvériser (réduire en poudre, atomisme) les opinions vaines qui, comme des fantômes nous font souffrir. Ce préambule promet beaucoup: rien de moins que la possibilité d’être heureux dans ce monde, offerte à tous ceux qui souffrent moralement et physiquement: c’est la promesse d’un bonheur terrestre donné dans l’existence, ici et maintenant! Pour ainsi dire on attend Epicure « au tournant «: le texte va-t-il tenir ses promesses et l’acte de réflexion sera-t-il capable de détruire nos peurs en les « bombardant « (atomisme).
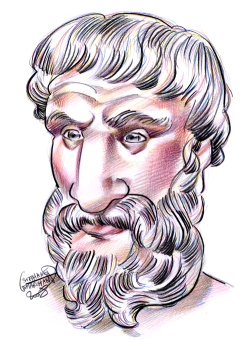
«
indifférent à notre sort.
Notre existence n'est donc pas gérée et décidée par les dieux.
De plus Epicure dit « lesdieux ne sont pas de prénotions (La prénotion est une image d'une chose réelle dont elle dérive et implique en tantque telle un jugement d'existence.
Ces prénotions nous permettent de dépasser notre expérience actuelle parcequ'elles résultent de notre expérience passée ; en ce sens, elles fondent tous nos jugements et nos croyances.),mais bien des présomptions fausses ».
Il dit que leur existence n'est pas vérifiée scientifiquement mais qu'elle esttirée sur des apparences.
Ainsi craindre les dieux est un non sens car il n'ont aucun rapport avec notre monde.
C'estpourquoi Epicure va apprendre à philosopher aux jeunes (et autres) afin qu'il ne craignent ces derniers.
4°) La véritable impiété est le mépris pour les choses de la religion.
Mais pas au sans négatif du terme, plutôt sur lefait que l'on sait que cela existe mais où l'on ne porte aucun jugement de valeur.
C'est plus un sentimentd'ignorance pour Epicure.
Second précepte ( § 125 à 127)
5°) Certes l'homme a peur de ma mort car c'est dans sa nature, sa finalité, elle est inévitable.
Mais la mort n'a pasde nature.
La mort n'a pas de représentation à par son efficacité car il me semble que tout le monde y passera.
Eneffet elle n'existe qu'au moment où elle agit.
La mort d'un être n'est donc pas due à un fatalisme.
La mort est doncun néant, inexistante et pourtant tellement réelle, tellement présente.
De plus nous avons conscience de ce quisemble être bien ou mal pour nous.
On se représente la mort comme quelque chose de mal.
Mais cette consciencedu bien et du mal repose sur des sensations, ainsi comment savoir que la mort est un mal alors qu'elle est dénuée detoute sensations? La craindre est donc une absurdité car il ne peut y avoir de douleur dans la mort.
C'est enprenant conscience de la réalité de cet état d'absence de sensation que l'homme peut se libérer de sa crainte etvivre heureux.
La mort d'un proche procure de la peine mais il est plus douloureux encore que de l'attendre.
Elle nefrappe qu'une fois un être.La crainte de la mort est le trouble de l'âme qui agite les hommes.
Car c'est encore parce que nous jugeons mal leschoses que nous craignons la mort.
La formule d'Epicure consiste a montrer que la mort ne nous concerne pas, quelorsqu'elle frappe nous ne sommes plus et que nous sommes là ou elle n'est pas.
La philosophie épicurienne nousamène à nous soucier de notre vie et non de ce qui n'est rien pour nous.
6°) L'opinion commune refuse la mort.
Elle est perçue comme une abstraction, et lorsqu'elle survient, on est tentéde l'oublier au plus vite.
L'angoisse existentiel de l'homme réside dans son regard sur la fin de sa vie.
Pourtant si l'onattend pas la mort nous serons libéré de cette crainte.
La mort ne persiste pas dans une durée, contrairement ausujet qui en est, qui dépend s'une continuité dans le temps et l'espace.Nous avons pu voir précédemment que selon l'opinion commune il est dans la nature de l'homme de craindre la mort.Mais pour le sage, il faut triompher ce celle-ci.
Ainsi l'attitude du sage ne consiste pas à mépriser la mort ni la vie.Car vivre n'est pas une contrainte et mourir ne l'est pas non plus sachant que cela fait partie de la vie.
Il ne sert àrien pour le sage de vivre angoissé, malheureux et longue.
Il est préférable de mener une vie heureuse mais courte.Il ne pense pas qu'il est voué à un destin fatal, il ne s'en préoccupe pas.
Car lui-même prend son avenir en mainsans avoir la prétention de le connaître.
Il n'attend pas passivement quelque chose de l'avenir mais il se projette.
Troisième précepte (§ 128 à demi 130)
7°) Epicure distingue deux types de désirs.
Les désirs naturels d'une part et les désirs « vains » ( Dans un sensfiguré, vain signifie ce qui est sans valeur ou inutile, c'est en ce sens qu'on parlera de la vanité de la vie.
On peutalors penser que les désirs vains, sont les désirs inutiles et qui doivent être réprimés.)Dans la catégorie des désirs naturels on y distingue aussi deux types différents.
Il existe les désirs naturelsnécessaires qui correspondent à ceux rechercher pour le bonheur de l'homme & sa tranquillité du corps.
Et d'autrepart les désirs naturels non nécessaires qui eux consistent à la simple variation des plaisirs et à la recherche del'agréable.Dans la catégorie des désirs « vains » deux types de désirs sont répertoriés.
Les désirs artificiels qui correspondentà la gloire, la richesse et les désirs irréalisables comme par exemple le souhait d'immortalité.
8°)Le plaisir est donc au cœur de la philosophie épicurienne et le bonheur ainsi que la vertu lui sont assujettis.Toute quête du bonheur doit avoir en vue le plaisir.
Le désir déréglé, non soumis à la norme de nature, enfante uneinfinie chimère, un rêve éternellement insatisfait.
Il déplace le besoin sans l'apaiser.
Tout, une fois éprouvé devientmanque.
C'est une véritable pensée du plaisir que nous convie Epicure.
Il s'agit toujours d'anticiper les effets que lesplaisirs pourront produire.
Lorsque nous y souscrivons, afin de démontrer s'il ne risque pas d'engendrer un mal + grdque le bien promis.
9°) Le véritable plaisir ne se vit qu'au présent car lorsque l'on désir prendre du plaisir, nous sommes en manque deplaisir.
Et quand notre désirs est assouvi, on pense déjà au prochain plaisir que l'on pourrait se faire.
Le plaisir se vitqu'au présent, qu'à l'instant même où l'on réalise notre désir, lorsque l'on prend du plaisir.
Le plaisir se vit dansl'instant..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Fiche lecture : Epicure - Lettre à Ménécée
- Epicure, explication de texte, Lettre à Ménécée
- Epicure. [341- 270 BC] Lettres et Maximes Lettre à Ménécée.
- Lettre a Ménécée-Epicure
- Lettre à Ménécée Epicure Extrait 128-132 : sur le plaisir Et c'est pourquoi nous disons que le plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse.