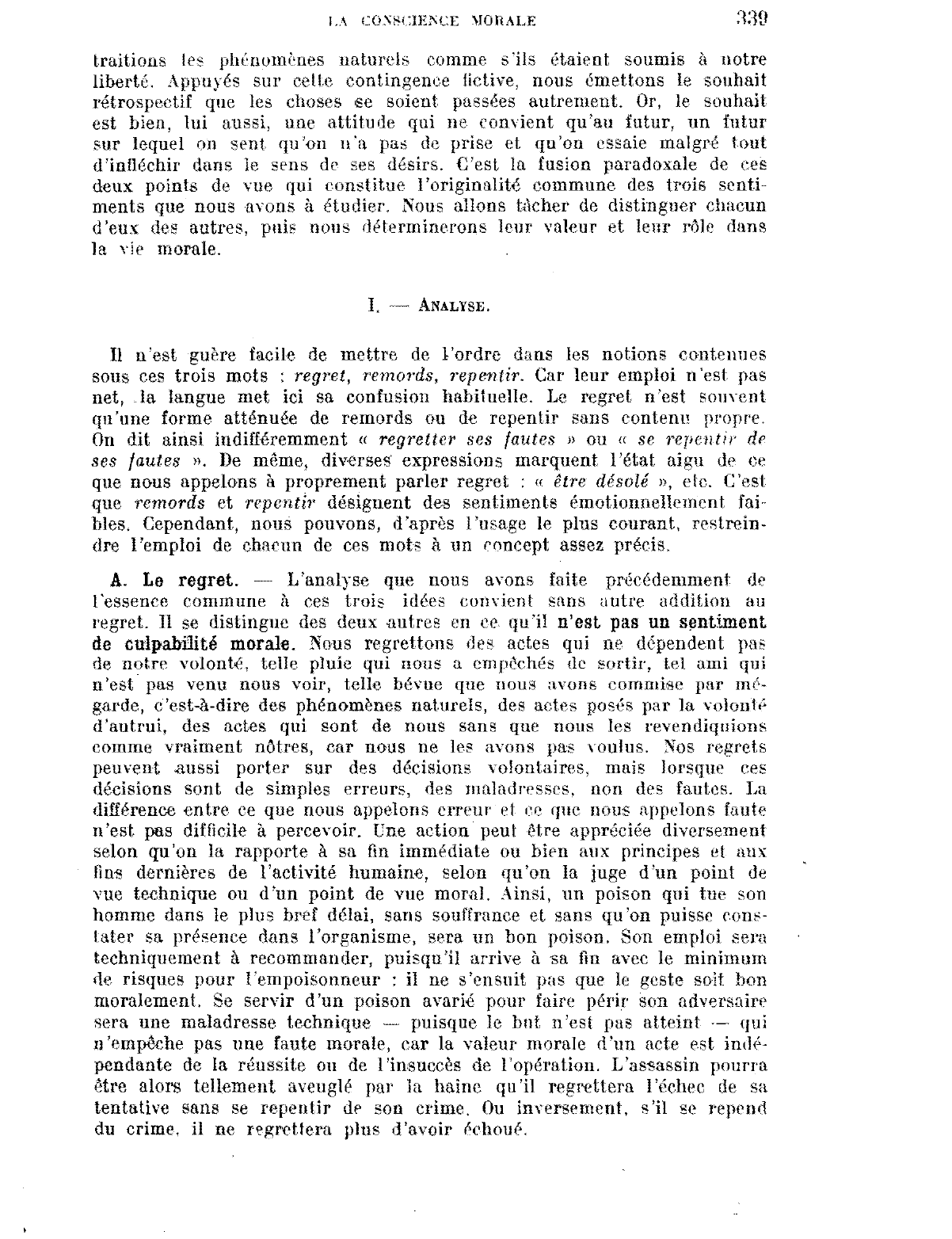Regret, remords. repentir : Leur place respective dans la vie morale.
Publié le 16/09/2014

Extrait du document


«
traitions les phénom(•nes naturels comme s ïls étaient soumis à notre
liberté.
Appuyés sur cette contingence lictive, nous émettons le souhait 1·étrospectif que les choses se soient passées autrement.
Or, le souhait est bien, lui aussi, une attitude qui ne convient qu'au futur, un futur sur lequel on sent qu'on 11 'a pa,; de prise et qu'on essaie malgré tout d'infléchir dans le sens de ses désirs.
C'est la fusion paradoxale de ces deux points de vue qui constitue l'originalité commune des trois senti ments que nous avons à étudier.
Nous allons ti\cher de distinguer chacun d'eux des autres, puis nous déterminerons leur valeur et leur rôle dans la Yie morale.
J.
ANALYSE.
Il n'est guère facile de mettre de l'ordre dans les notions contenues sons ces trois mots : regr·et, remords, repentir.
Car leur emploi n'est pas
net, la langue met ici sa confusion habituelle.
Le regret n'est souYent qu'une forme atténuée de remords ou de repentir sans contenn propre.
On dit ainsi indifféremment.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Analyser le remords et le repentir; appréciez quelle place il convient de leur faire dans la vie morale. PLAN.
- Le remords est-il nécessaire à la vie morale?
- Madame de Staël écrit on 1800 dans De la Littérature (Première Partie, chap. 11 ) : « Ce que l'homme a fait de plus grand, il le doit au sentiment douloureux de l'incomplet de sa destinée. Les esprits médiocres sont, en général, assez satisfaits de la vie commune: ils arrondissent, pour ainsi dire, leur existence, et suppléent a ce qui peut leur manquer encore par les illusions de la vanité: mais le sublime de l'esprit, des sentiments et des actions doit son essor au besoin d'échapper
- La place du devoir dans la vie morale ?
- Quelle place faut-il faire au corps dans la vie morale ? (Plan détaillé)