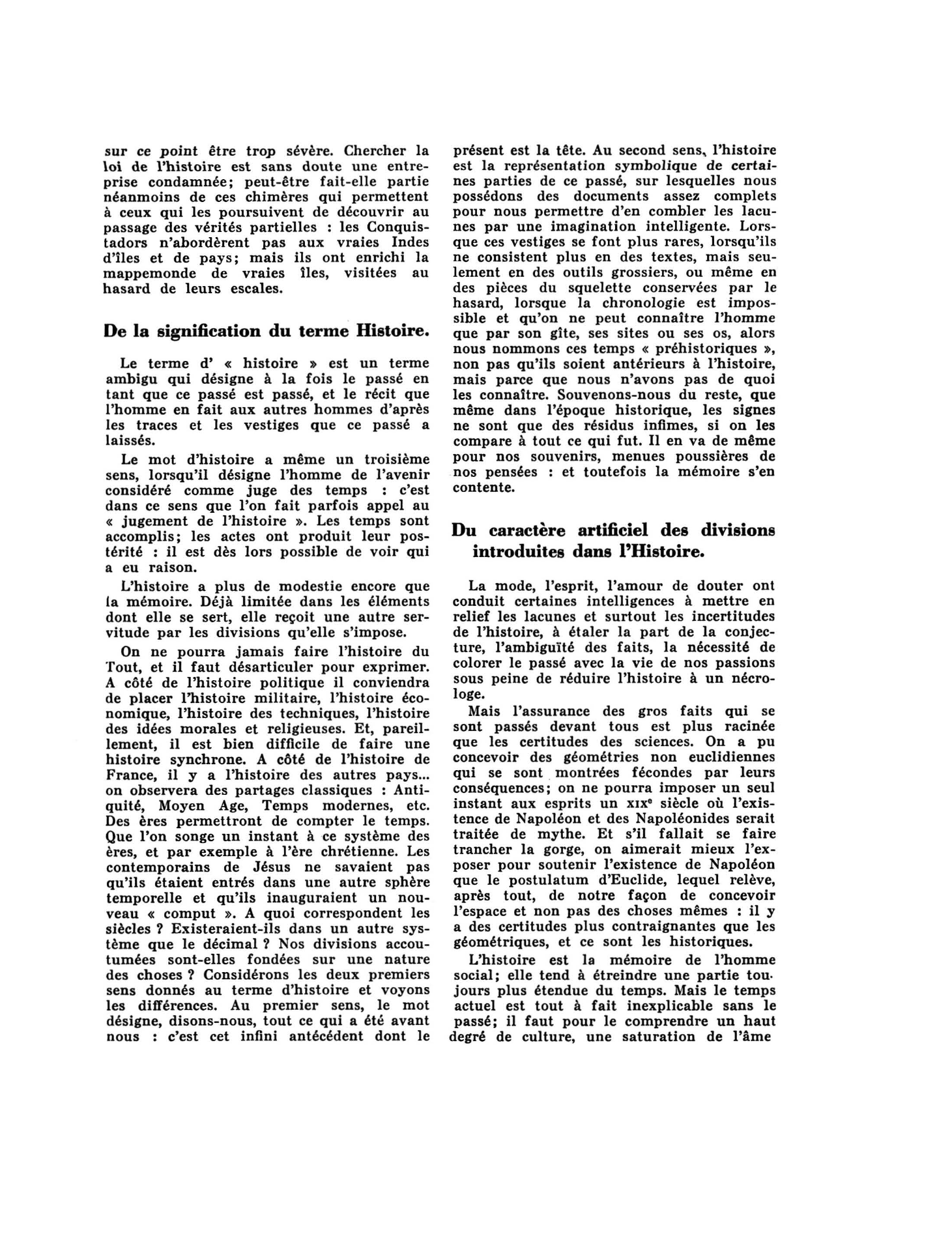Remarques et réflexions sur l'Histoire
Publié le 20/10/2011
Extrait du document

Le terme d' « histoire :. est un terme ambigu qui désigne à la fois le passé en tant que ce passé est passé, et le récit que l'homme en fait aux autres hommes d'après les traces et les vestiges que ce passé a laissés.
Le mot d'histoire a même un troisième sens, lorsqu'il désigne l'homme de l'avenir considéré comme juge des temps : c'est dans ce sens que l'on fait parfois appel au « jugement de l'histoire «. Les temps sont accomplis; les actes ont produit leur postérité : il est dès lors possible de voir qui a eu raison.

«
sur ce point être trop sévère.
Chercher la loi de l'histoire est sans doute une entre prise condamnée; peut-être fait-elle partie néanmoins de ces chimères qui permettent à ceux qui les poursuivent de découvrir au passage des vérités partielles : les Conquis tadors n'abordèrent pas aux vraies Indes d'îles et de pays; mais ils ont enrichi la mappemonde de vraies iles, visitées au hasard de leurs escales.
De la signification du terme Histoire.
Le terme d' « histoire :.
est un terme ambigu qui désigne à la fois le passé en tant que ce passé est passé, et le récit que l'homme en fait aux autres hommes d'après les traces et les vestiges que ce passé a laissés.
Le mot d'histoire a même un troisième sens, lorsqu'il désigne l'homme de l'avenir considéré comme juge des temps : c'est dans ce sens que l'on fait parfois appel au « jugement de l'histoire ».
Les temps sont accomplis; les actes ont produit leur pos térité : il est dès lors possible de voir qui a eu raison.
L'histoire a plus de modestie encore que la mémoire.
Déjà limitée dans les éléments dont elle se sert, elle reçoit une autre ser vitude par les divisions qu'elle s'impose.
On ne pourra jamais faire l'histoire du Tout, et il faut désarticuler pour exprimer.
A côté de l'histoire politique il conviendra de placer l'histoire militaire, l'histoire éco nomique, l'histoire des techniques, l'histoire des idées morales et religieuses .
Et, pareil lement, il est bien difficile de faire une histoire synchrone.
A côté de l'histoire de France, il y a l'histoire des autres pays ...
on observera des partages classiques : Anti quité, Moyen Age, Temps modernes, etc .
Des ères permettront de compter le temps.
Que l'on songe un instant à ·ce système des ères, et par exemple à l'ère chrétienne.
Les contemporains de Jésus ne savaient pas qu'ils étaient entrés dans une autre sphère temporelle et qu'ils inauguraient un nou veau « comput ».
A quoi correspondent les siècles ? Existeraient-ils dans un autre sys tème que le décimal ? Nos divisions accou tumées sont-elles fondées sur une nature des choses ? Considérons les deux premiers sens donnés au terme d'histoire et voyons les différences.
Au premier sens, le mot désigne, disons-nous, tout ce qui a été avant nous : c'est cet infini antécédent dont le
présent est la tête.
Au second sens, l'histoire est la représentation symbolique de certai nes parties de ce passé, sur lesquelles nous possédons des documents assez complets pour nous permettre d'en combler les lacu nes par une imagination intelligente.
Lors que ces vestiges se font plus rares, lorsqu'ils ne consistent plus en des textes, mais seu lement en des outils grossiers, ou même en des pièces du squelette conservées par le hasard, lorsque la chronologie est impos sible et qu'on ne peut connaître l'homme que par son gîte, ses sites ou ses os, alors nous nommons ces temps « préhistoriques :., non pas qu'ils soient antérieurs à l'histoire, mais parce que nous n'avons pas de quoi les connaitre.
Souvenons-nous du reste, que même dans l'époque historique, les signes ne sont que des résidus infimes, si on les compare à tout ce qui fut.
Il en va de même pour nos souvenirs, menues poussières de nos pensées : et toutefois la mémoire s'en contente.
Du caractère artificiel des divisions
introduites dans l'Histoire.
La mode, l'esprit, l'amour de douter ont conduit certaines intelligences à mettre en relief les lacunes et surtout les incertitudes de l'histoire, à étaler la part de la conjec ture, l'ambiguïté des faits, la nécessité de colorer le passé avec la vie de nos passions sous peine de réduire l'histoire à un nécro loge.
Mais l'assurance des gros faits qui se sont passés devant tous est plus racinée que les certitudes des sciences.
On a pu concevoir des géométries non euclidiennes qui se sont .
montrées fécondes par leurs conséquences; on ne pourra imposer un seul instant aux esprits un x1x• siècle où l'exis tence de Napoléon et des Napoléonides serait traitée de mythe.
Et s'il fallait se faire trancher la gorge, on aimerait mieux l'ex poser pour soutenir l'existence de Napoléon que le postulatum d'Euclide, lequel relève, après tout, de notre façon de concevoir l'espace et non pas des choses mêmes : il y
a des certitudes plus contraignantes que les géométriques, et ce sont les historiques.
L'histoire est la mémoire de l'homme social; elle tend à étreindre une partie tou.
jours plus étendue du temps.
Mais le temps actuel est tout à fait inexplicable sans le passé; il faut pour le comprendre un haut degré de culture, une saturation de l'âme.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « Les héros de cette histoire appartiennent à la fiction romanesque, et toute ressemblance avec des contemporains vivants ou morts est entièrement fortuite. » Quelles réflexions vous inspire une telle formule? Vous vous appuierez sur des exemples précis (romans, films, théâtre, spectacles télévisés). même problème : celui de la vérité en littérature (et en général dans l’art).
- En vous référant aux pièces de théâtre que vous avez lues, étudiées, ou vu jouer, dites les réflexions que vous inspirent ces remarques d'un directeur de troupe théâtrale : « Notre volonté est de mettre sur scène la société, la présenter et provoquer vis-à-vis d'elle des regards critiques. C'est une fonction du théâtre. Elle n'est pas nouvelle. Molière l'avait bien compris. Mais dans le même temps, le théâtre doit être un lieu où se libèrent les forces de l'imagination, où s'organise l
- En vous référant aux pièces de théâtre que vous avez lues, étudiées ou vu jouer, dites les réflexions que vous inspirent ces remarques d'un directeur de troupe théâtrale de province : « Notre volonté est de mettre sur scène la société, la présenter et provoquer vis-à-vis d'elle des regards critiques. C'est une fonction du théâtre. Elle n'est pas nouvelle. Molière, et bien avant lui, Sophocle l'avaient ainsi comprise. Mais dans le même temps, le théâtre doit être un lieu où se libèrent
- A la Rochefoucauld (1613-1680) qui déclare : « Il est plus nécessaire d'étudier les hommes que les livres », George Sand (1804-1876) semble répliquer lorsque, dans son roman Mauprat (1837), elle recommande comme moyen de formation « l'étude des lettres, qui n'est autre que l'étude des hommes ». Quelles réflexions vous suggèrent ces prises de position? Vous illustrerez votre argumentation d'exemples variés, empruntés aux œuvres littéraires, et de faits de la vie courante ou de l'histoi
- «Pour douer notre littérature d'une action efficace, il fallait trouver le secret de l'action sur les esprits : ce secret est la clarté. Comprenons ce mot : il faut évidemment le soustraire à des interprétations grossièrement faciles. Paul Valéry a insisté souvent sur le fait que de nombreuses gens la confondent avec leur propre paresse d'esprit. Il ne s'agit pas d'être compris par les distraits. La clarté de Racine n'est qu'une apparence ; je défie un lecteur moyen d'expliquer tout ce