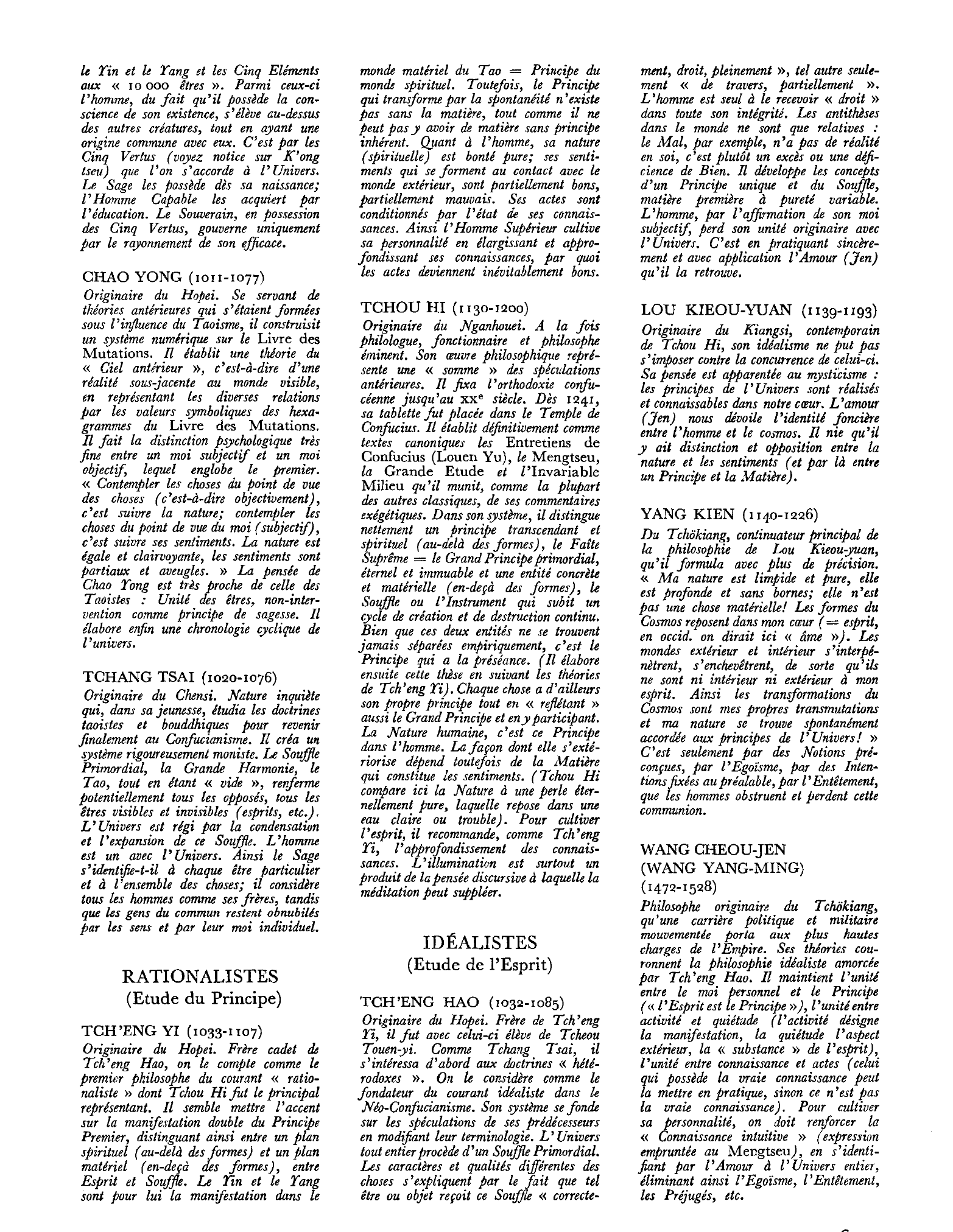sable.
Publié le 21/10/2012

Extrait du document
«
le Yin et le Yang et les Cinq Eléments
aux « ro ooo êtres ».
Parmi ceux-ci
l'lwmme, du fait qu'il possède la con science de son existence, s'élève au-dessus des autres créatures, tout en ayant une origine commune avec eux.
C'est par les Cinq Vertus (voyez notice sur K'ong
tseu) que l'on s'accorde à l'Univers.
Le Sage les possède dès sa naissance;
l'Homme Capable les acquiert par
l'éducation.
Le Souverain,
en possession des Cinq Vertus, gouverne uniquement
par le rayonnement de son efficace.
CHAO YONG (roii-ro77)
Originaire du Hopei.
Se servant de théories antérieures qui s'étaient formées
sous l'irifluence du Taoïsme, il construisit
un système numérique sur le Livre des
Mutations.
Il établit une théorie du « Ciel antérieur », c'est-à-dire d'une
réalité sous-jacente au monde visible, en représentant les diverses relations
par les valeurs symboliques des hexa
grammes du Livre des Mutations.
Il fait la distinction psyclwlogique très fine entre un moi subjectif et un moi
objectif, lequel englobe le premier.
« Contempler les clwses du point de vue des clwses (c'est-à-dire objectivement),
c'est suivre la nature; contempler les clwses du point de vue du moi (subjectif),
c'est suivre ses sentiments.
La nature est
égale et clairvoyante, les sentiments sont
partiaux et aveugles.
» La pensée de Chao Tong est très proche de celle des Taoïstes : Unité des êtres, non-inter
vention comme principe de sagesse.
Il élabore enfin une chronologie cyclique de l'univers.
TCHANG TSAI (1020-1076)
Originaire du Chensi.
Nature inquiète
qui, dans sa jeunesse, étudia les doctrines taoïstes et bouddhiques pour revenir
finalement au Confucianisme.
Il créa un système rigoureusement moniste.
Le Souffle
Primordial, la Grande Harmonie, le Tao, tout en étant « vide », renferme
potentiellement tous les opposés, tous les êtres visibles et invisibles (esprits, etc.).
L' Univers est régi par la condensation
et l'expansion de ce Souffle.
L'lwmme
est un avec l'Univers.
Ainsi le Sage s'identifie-t-il à chaque être particulier
et à l'ensemble des choses; il considère tous les lwmmes comme ses frères, tandis que les gens du commun restent obnubilés
par les sens et par leur moi individuel.
RATIONALISTES
(Etude du Principe)
TCH'ENG YI (1033-1 107)
Originaire du Hopei.
Frère cadet de Tch'eng Hao, on le compte comme le premier philosophe du courant « ratio
naliste » dont Tchou Hi fut le principal
représentant.
Il semble mettre l'accent
sur la manifestation double du Principe
Premier, distinguant ainsi entre un plan
spirituel (au-delà des formes) et un plan
matériel (en-deçà des formes), entre
Esprit et Souffle.
Le Yin et le Yang sont pour lui la manifestation dans le
monde matériel du Tao = Principe du monde spirituel.
Toutefois, le Principe
qui transforme par la spontanéité n'existe
pas sans la matière, tout
comme il ne peut pas y avoir de matière sans principe
inhérent.
Quant à l'lwmme, sa nature
(spirituelle) est bonté pure; ses senti
ments qui se forment au contact avec le monde extérieur, sont partiellement bons, partiellement mauvais.
Ses actes sont
conditionnés par l'état de ses connais
sances.
Ainsi l'Homme Supérieur cultive
sa personnalité en élargissant et appro
fondissant ses connaissances, par quoi les actes deviennent inévitablement bons.
TCHOU HI (1130-1200)
Originaire du Nganhouei.
A la fois philologue, fonctionnaire et philosophe
éminent.
Son œuvre philosophique repré sente une « somme » des spéculations
antérieures.
Il fixa l' ortlwdoxie confu céenne jusqu'au xx• siècle.
Dès 1241, sa tablette fut placée dans le Temple de Confucius.
Il établit définitivement comme textes canoniques les Entretiens de
Confucius (Louen Yu), le Mengtseu, la Grande Etude et l'Invariable Milieu qu'il munit, comme la plupart des autres classiques, de ses commentaires
exégétiques.
Dans son système, il distingue
nettement un principe transcendant et
spirituel {au-delà des formes), le Faîte
Suprême = le Grand Principe primordial,
éternel et immuable et une entité concrète et matérielle (en-deçà des formes), le Souffle ou l'Instrument qui subit un cycle de création et de destruction continu.
Bien que ces deux entités ne se trouvent
jamais séparées empiriquement, c'est le Principe qui a la préséance.
(Il élabore ensuite cette thèse en suivant les théories de Teh' eng Yi).
Chaque clwse a d'ailleurs son propre principe tout en « reflétant » aussi le Grand Principe et en y participant.
La Nature humaine, c'est ce Principe
dans l'lwmme.
Lafaçon dont elle s'exté
riorise dépend toutefois de la Matière
qui constitue les sentiments.
( Tclwu Hi compare ici la Nature à une perle éter
nellement pure, laquelle repose dans une eau claire ou trouble).
Pour cultiver
l'esprit, il recommande, comme Tch'eng Yi, l' apprqfondissement des connais
sances.
L'illumination est surtout un produit de la pensée discursive à laquelle la méditation peut suppléer.
IDÉALISTES
(Etude de l'Esprit)
TCH'ENG HAO (1032-1085)
Originaire du Hopei.
Frère de Tch'eng Yi, il fut avec celui-ci élève de Tcheou Touen-yi.
Comme Tchang Tsai, il
s'intéressa d'abord aux doctrines « hété rodoxes ».
On le considère comme le fondateur du courant idéaliste dans le Néo-Confucianisme.
Son système se fonde
sur les spéculations de ses prédécesseurs en modifiant leur terminologie.
L'Univers tout entier procède d'un Souffle Primordial.
Les caractères et qualités différentes des choses s'expliquent par le fait que tel être ou objet reçoit ce Souffle « correcte-
ment, droit, pleinement », tel autre seule
ment « de travers, partiellement ».
L' lwmme est seul à le recevoir « droit » dans toute son intégrité.
Les antithèses
dans le monde ne sont que relatives : le Mal, par exemple, n'a pas de réalité en soi, c'est plutôt un excès ou une défi cience de Bien.
Il développe les concepts d'un Principe unique et du Souffle, matière première à pureté variable.
L'lwmme, par l'affirmation de son moi
subjectif, perd son unité originaire avec l'Univers.
C'est en pratiquant sincère
ment et avec application l'Amour (]en) qu'il la retrouve.
LOU KIEOU-YUAN (II39-II93)
Originaire du Kiangsi, contemporain de Tclwu Hi, son idéalisme ne put pas
s'imposer contre la concurrence de celui-ci.
Sa pensée est apparentée au mysticisme :
les principes de l'Univers sont réalisés
et connaissables dans notre cœur.
L'amour (]en) nous dévoile l'identité foncière entre l'lwmme et le cosmos.
Il nie qu'il y ait distinction et opposition entre la nature et les sentiments (et par là entre un Principe et la Matière).
YANG KIEN (1 140-1226)
Du TchOkiang, continuateur principal de la philosophie de Lou Kieou-yuan, qu'il formula avec plus de précision.
« Ma nature est limpide et pure, elle
est profonde et sans bornes; elle n'est
pas une clwse matérielle! Les formes du Cosmos reposent dans mon cœur ( = esprit, en oc cid.
on dirait ici « âme »).
Les
mondes extérieur et intérieur s' interpé
nètrent, s'enchevêtrent, de sorte qu'ils ne sont ni intérieur ni extérieur à mon esprit.
Ainsi les transformations du Cosmos sont mes propres transmutations
et ma nature se trouve spontanément accordée aux principes de l' Univers! » C'est seulement par des Notions pré conçues, par l'Egoïsme, par des Inten
tions fixées au préalable, par l'Entêtement, que les lwmmes obstruent et perdent cette communion.
WANG CHEOU-JEN
(WANG YANG-MING)
( I4 72-1 528)
Philosophe originaire du Tclzijkiang, qu'une carrière politique et militaire mouvementée porta aux plus hautes charges de l'Empire.
Ses théories cou ronnent la philosophie idéaliste amorcée par Tch'eng Hao.
Il maintient l'unité entre le moi personnel et le Principe («l'Esprit est le Principe»), l'unité entre
activité et quiétude (l'activité désigne la manifestation, la quiétude l'aspect
extérieur, la « substance » de l'esprit),
l'unité entre connaissance et actes (celui
qui possède la vraie connaissance peut
la mettre en pratique, sinon ce n'est pas la vraie connaissance).
Pour cultiver sa personnalité, on doit renforcer la « Connaissance intuitive » (expression
empruntée au MengtseuJ, en s'identi
fiant par l'Amour à l'Univers entier,
éliminant ainsi l'Egoïsme, l'Entêtement,
les Préjugés, etc..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- MINUTES DE SABLE MÉMORIAL (Les) d’Alfred Jarry - résumé, analyse
- MARCHES DE SABLE (Les) d'Andrée Chédid (résumé)
- L'enfant de sable de Tahar Ben Jelloun (résumé & analyse)
- Le contact avec l'oeuvre d'art s'impose-t-il comme moyen indispen¬sable pour faire l'expérience de la beauté ?
- sable.