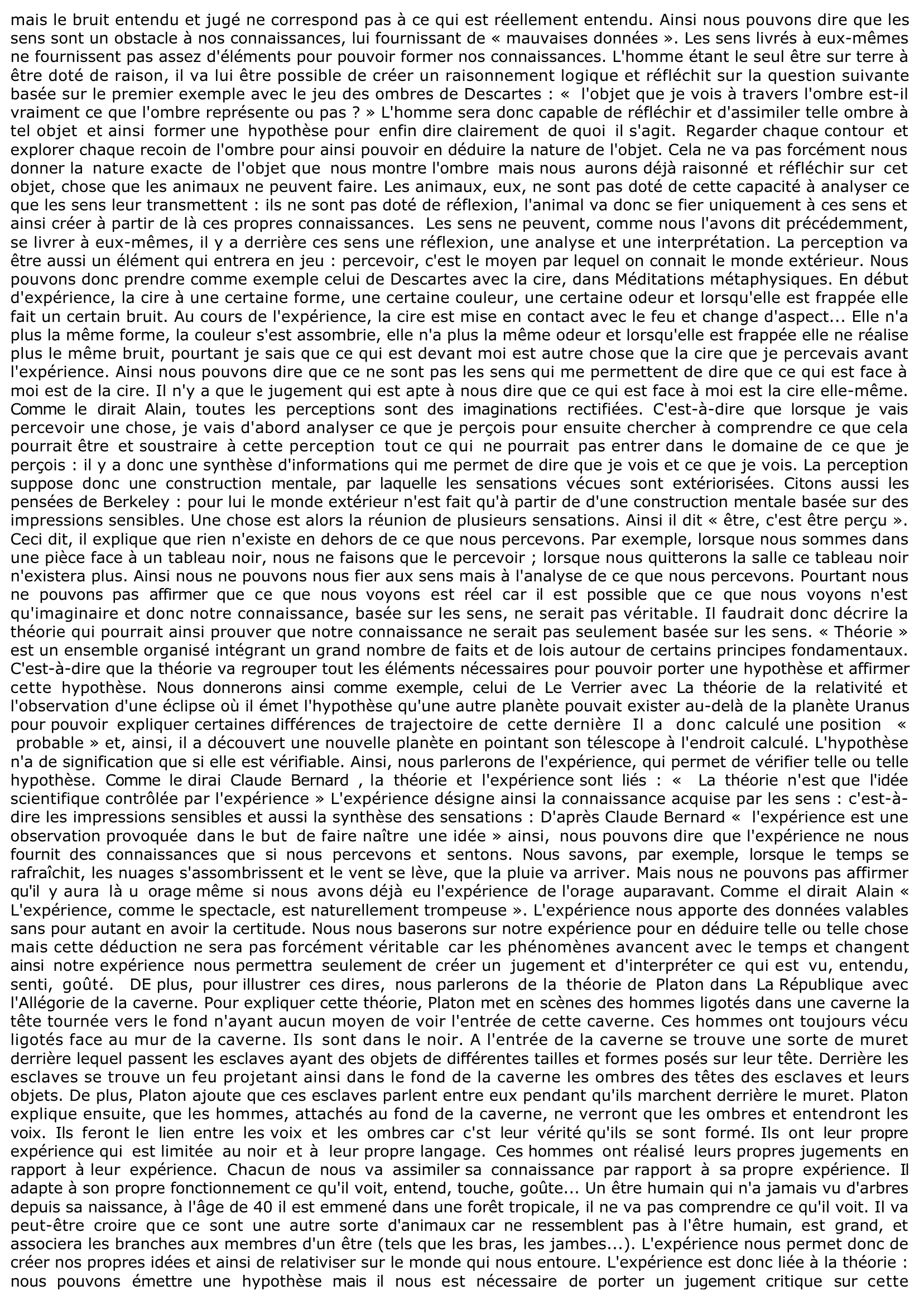Sens comme critère de la connaissance ?
Publié le 05/02/2012

Extrait du document
Les idées et les pensées rationnelles permettent de mieux connaître la vérité que les sens. De plus, nous savons que notre pensée est aussi vide qu'un tableau noir avant de connaître l'expérience. L'expérience existe grâce au cinq sens : l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat et le goût. Ces cinq sens apportent des informations qui sont ensuite assimilées et jugées. A partir de là, notre expérience se forme peu à peu. Ces informations apportées pas les cinq sens ne sont pas forcément véritables, pour cela ces informations seront « triées «, « synthétisées «. Nous ne pouvons pas nous baser sur les sens car les sens sont relativement trompeurs comme peut l'être la théorie, l'expérience (revenons à la citation d'Alain « L'expérience, comme le spectacle, est naturellement trompeuse «), ainsi que la perception... Mais il nous est indispensable de relié chaque élément pour nous pouvoir ainsi créer notre connaissance. De plus, un homme ayant au minimum un voire deux sens ne sera donc pas doté de moins de connaissance qu'un être humain dit « normal «. Ainsi, pour en revenir au questionnement du début (« ... nous pouvons nous demander si les sens seraient suffisants pour nous fournir toutes nos connaissances. «) nous pouvons dire que les sens ne sont pas suffisants pour fournir toute notre connaissance mais ils font partie d'un ensemble d'éléments tels que la perception, la théorie et l'expérience. Ces quatre éléments reliés entre eux permettront de créer ce que l'on appelle « connaissance «.
«
mais le bruit entendu et jugé ne correspond pas à ce qui est réellement entendu.
Ainsi nous pouvons dire que lessens sont un obstacle à nos connaissances, lui fournissant de « mauvaises données ».
Les sens livrés à eux-mêmesne fournissent pas assez d'éléments pour pouvoir former nos connaissances.
L'homme étant le seul être sur terre àêtre doté de raison, il va lui être possible de créer un raisonnement logique et réfléchit sur la question suivantebasée sur le premier exemple avec le jeu des ombres de Descartes : « l'objet que je vois à travers l'ombre est-ilvraiment ce que l'ombre représente ou pas ? » L'homme sera donc capable de réfléchir et d'assimiler telle ombre àtel objet et ainsi former une hypothèse pour enfin dire clairement de quoi il s'agit.
Regarder chaque contour etexplorer chaque recoin de l'ombre pour ainsi pouvoir en déduire la nature de l'objet.
Cela ne va pas forcément nousdonner la nature exacte de l'objet que nous montre l'ombre mais nous aurons déjà raisonné et réfléchir sur cetobjet, chose que les animaux ne peuvent faire.
Les animaux, eux, ne sont pas doté de cette capacité à analyser ceque les sens leur transmettent : ils ne sont pas doté de réflexion, l'animal va donc se fier uniquement à ces sens etainsi créer à partir de là ces propres connaissances.
Les sens ne peuvent, comme nous l'avons dit précédemment,se livrer à eux-mêmes, il y a derrière ces sens une réflexion, une analyse et une interprétation.
La perception vaêtre aussi un élément qui entrera en jeu : percevoir, c'est le moyen par lequel on connait le monde extérieur.
Nouspouvons donc prendre comme exemple celui de Descartes avec la cire, dans Méditations métaphysiques.
En débutd'expérience, la cire à une certaine forme, une certaine couleur, une certaine odeur et lorsqu'elle est frappée ellefait un certain bruit.
Au cours de l'expérience, la cire est mise en contact avec le feu et change d'aspect...
Elle n'aplus la même forme, la couleur s'est assombrie, elle n'a plus la même odeur et lorsqu'elle est frappée elle ne réaliseplus le même bruit, pourtant je sais que ce qui est devant moi est autre chose que la cire que je percevais avantl'expérience.
Ainsi nous pouvons dire que ce ne sont pas les sens qui me permettent de dire que ce qui est face àmoi est de la cire.
Il n'y a que le jugement qui est apte à nous dire que ce qui est face à moi est la cire elle-même.Comme le dirait Alain, toutes les perceptions sont des imaginations rectifiées.
C'est-à-dire que lorsque je vaispercevoir une chose, je vais d'abord analyser ce que je perçois pour ensuite chercher à comprendre ce que celapourrait être et soustraire à cette perception tout ce qui ne pourrait pas entrer dans le domaine de ce que jeperçois : il y a donc une synthèse d'informations qui me permet de dire que je vois et ce que je vois.
La perceptionsuppose donc une construction mentale, par laquelle les sensations vécues sont extériorisées.
Citons aussi lespensées de Berkeley : pour lui le monde extérieur n'est fait qu'à partir de d'une construction mentale basée sur desimpressions sensibles.
Une chose est alors la réunion de plusieurs sensations.
Ainsi il dit « être, c'est être perçu ».Ceci dit, il explique que rien n'existe en dehors de ce que nous percevons.
Par exemple, lorsque nous sommes dansune pièce face à un tableau noir, nous ne faisons que le percevoir ; lorsque nous quitterons la salle ce tableau noirn'existera plus.
Ainsi nous ne pouvons nous fier aux sens mais à l'analyse de ce que nous percevons.
Pourtant nousne pouvons pas affirmer que ce que nous voyons est réel car il est possible que ce que nous voyons n'estqu'imaginaire et donc notre connaissance, basée sur les sens, ne serait pas véritable.
Il faudrait donc décrire lathéorie qui pourrait ainsi prouver que notre connaissance ne serait pas seulement basée sur les sens.
« Théorie »est un ensemble organisé intégrant un grand nombre de faits et de lois autour de certains principes fondamentaux.C'est-à-dire que la théorie va regrouper tout les éléments nécessaires pour pouvoir porter une hypothèse et affirmercette hypothèse.
Nous donnerons ainsi comme exemple, celui de Le Verrier avec La théorie de la relativité etl'observation d'une éclipse où il émet l'hypothèse qu'une autre planète pouvait exister au-delà de la planète Uranuspour pouvoir expliquer certaines différences de trajectoire de cette dernière Il a donc calculé une position « probable » et, ainsi, il a découvert une nouvelle planète en pointant son télescope à l'endroit calculé.
L'hypothèsen'a de signification que si elle est vérifiable.
Ainsi, nous parlerons de l'expérience, qui permet de vérifier telle ou tellehypothèse.
Comme le dirai Claude Bernard , la théorie et l'expérience sont liés : « La théorie n'est que l'idéescientifique contrôlée par l'expérience » L'expérience désigne ainsi la connaissance acquise par les sens : c'est-à-dire les impressions sensibles et aussi la synthèse des sensations : D'après Claude Bernard « l'expérience est uneobservation provoquée dans le but de faire naître une idée » ainsi, nous pouvons dire que l'expérience ne nousfournit des connaissances que si nous percevons et sentons.
Nous savons, par exemple, lorsque le temps serafraîchit, les nuages s'assombrissent et le vent se lève, que la pluie va arriver.
Mais nous ne pouvons pas affirmerqu'il y aura là u orage même si nous avons déjà eu l'expérience de l'orage auparavant.
Comme el dirait Alain «L'expérience, comme le spectacle, est naturellement trompeuse ».
L'expérience nous apporte des données valablessans pour autant en avoir la certitude.
Nous nous baserons sur notre expérience pour en déduire telle ou telle chosemais cette déduction ne sera pas forcément véritable car les phénomènes avancent avec le temps et changentainsi notre expérience nous permettra seulement de créer un jugement et d'interpréter ce qui est vu, entendu,senti, goûté.
DE plus, pour illustrer ces dires, nous parlerons de la théorie de Platon dans La République avecl'Allégorie de la caverne.
Pour expliquer cette théorie, Platon met en scènes des hommes ligotés dans une caverne latête tournée vers le fond n'ayant aucun moyen de voir l'entrée de cette caverne.
Ces hommes ont toujours véculigotés face au mur de la caverne.
Ils sont dans le noir.
A l'entrée de la caverne se trouve une sorte de muretderrière lequel passent les esclaves ayant des objets de différentes tailles et formes posés sur leur tête.
Derrière lesesclaves se trouve un feu projetant ainsi dans le fond de la caverne les ombres des têtes des esclaves et leursobjets.
De plus, Platon ajoute que ces esclaves parlent entre eux pendant qu'ils marchent derrière le muret.
Platonexplique ensuite, que les hommes, attachés au fond de la caverne, ne verront que les ombres et entendront lesvoix.
Ils feront le lien entre les voix et les ombres car c'st leur vérité qu'ils se sont formé.
Ils ont leur propreexpérience qui est limitée au noir et à leur propre langage.
Ces hommes ont réalisé leurs propres jugements enrapport à leur expérience.
Chacun de nous va assimiler sa connaissance par rapport à sa propre expérience.
Iladapte à son propre fonctionnement ce qu'il voit, entend, touche, goûte...
Un être humain qui n'a jamais vu d'arbresdepuis sa naissance, à l'âge de 40 il est emmené dans une forêt tropicale, il ne va pas comprendre ce qu'il voit.
Il vapeut-être croire que ce sont une autre sorte d'animaux car ne ressemblent pas à l'être humain, est grand, etassociera les branches aux membres d'un être (tels que les bras, les jambes...).
L'expérience nous permet donc decréer nos propres idées et ainsi de relativiser sur le monde qui nous entoure.
L'expérience est donc liée à la théorie :nous pouvons émettre une hypothèse mais il nous est nécessaire de porter un jugement critique sur cette.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- SUJET : Commenter cette pensée d'Emile Boutroux : L’esprit scientifique, c'est essentiellement le sens du fait, comme source, règle, mesure et contrôle de toute connaissance. PLAN.
- Langage, pensée et connaissance: Introduction du sens chez Frege
- LA CONNAISSANCE ET LES SENS I.
- La recherche de vérité n'a-t-elle de sens que dans le domaine de la connaissance théorique ?
- Sens et connaissance