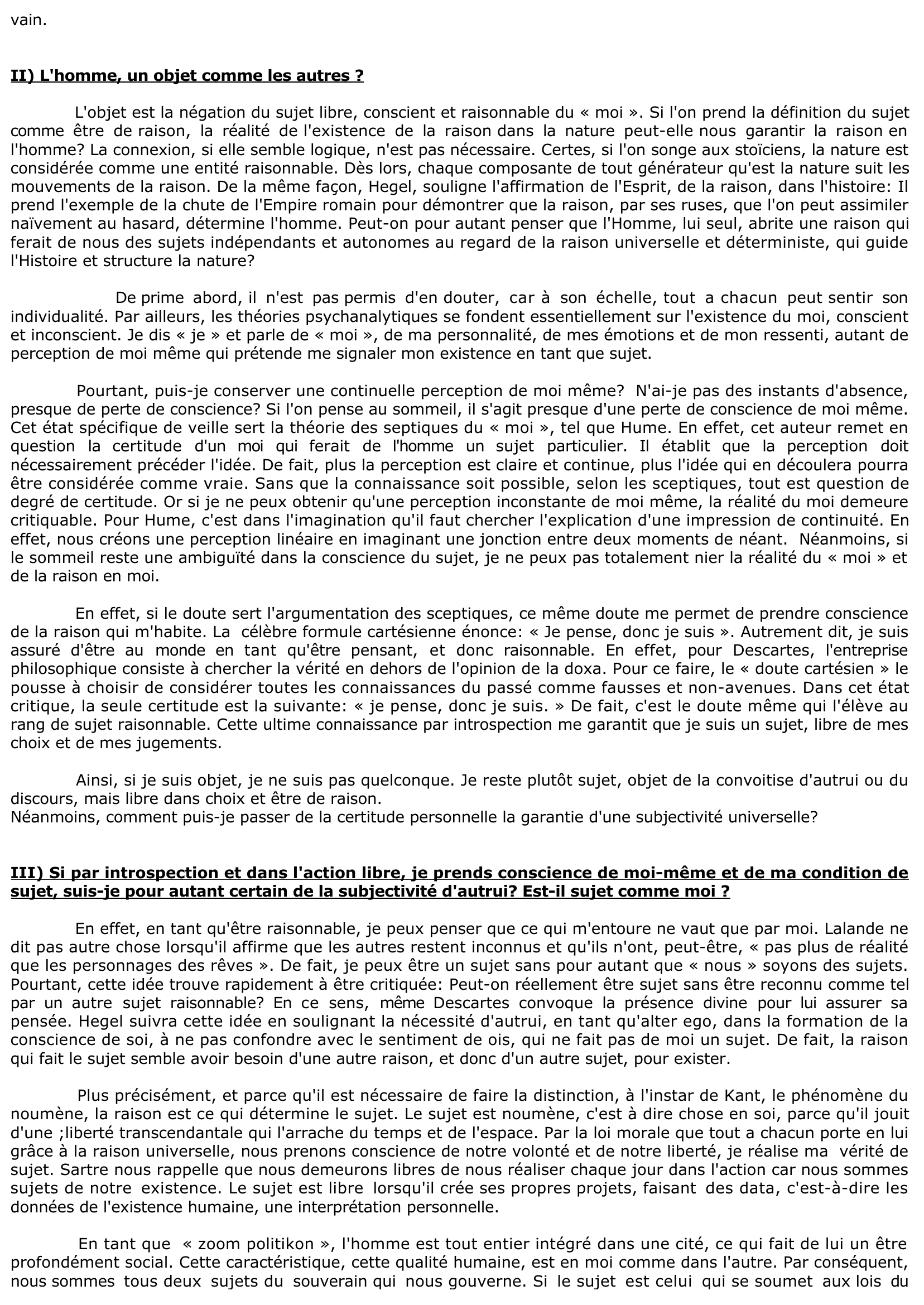Sommes-nous des sujets ?
Publié le 07/11/2009

Extrait du document
Plus précisément, et parce qu'il est nécessaire de faire la distinction, à l'instar de Kant, le phénomène du noumène, la raison est ce qui détermine le sujet. Le sujet est noumène, c'est à dire chose en soi, parce qu'il jouit d'une ;liberté transcendantale qui l'arrache du temps et de l'espace. Par la loi morale que tout a chacun porte en lui grâce à la raison universelle, nous prenons conscience de notre volonté et de notre liberté, je réalise ma vérité de sujet. Sartre nous rappelle que nous demeurons libres de nous réaliser chaque jour dans l'action car nous sommes sujets de notre existence. Le sujet est libre lorsqu'il crée ses propres projets, faisant des data, c'est-à-dire les données de l'existence humaine, une interprétation personnelle.
En tant que « zoom politikon «, l'homme est tout entier intégré dans une cité, ce qui fait de lui un être profondément social. Cette caractéristique, cette qualité humaine, est en moi comme dans l'autre. Par conséquent, nous sommes tous deux sujets du souverain qui nous gouverne. Si le sujet est celui qui se soumet aux lois du souverain, alors nous sommes tous sujets. Dans l'esprit des lois, Montesquieu rappelle que la raison primitive impose des lois, la nature comme aux hommes. Nous sommes donc sujets des lois du souverain, qui reste le peuple en démocratie, et des lois de la raison primitive. Néanmoins, Montesquieu souligne la spécificité humaine en précisant que les « êtres intelligents « peuvent créer leurs propres lois et s'y soumettre, dans la liberté. C'est donc en démocratie que l'homme reste un sujet libre.
«
vain.
II) L'homme, un objet comme les autres ? L'objet est la négation du sujet libre, conscient et raisonnable du « moi ».
Si l'on prend la définition du sujetcomme être de raison, la réalité de l'existence de la raison dans la nature peut-elle nous garantir la raison enl'homme? La connexion, si elle semble logique, n'est pas nécessaire.
Certes, si l'on songe aux stoïciens, la nature estconsidérée comme une entité raisonnable.
Dès lors, chaque composante de tout générateur qu'est la nature suit lesmouvements de la raison.
De la même façon, Hegel, souligne l'affirmation de l'Esprit, de la raison, dans l'histoire: Ilprend l'exemple de la chute de l'Empire romain pour démontrer que la raison, par ses ruses, que l'on peut assimilernaïvement au hasard, détermine l'homme.
Peut-on pour autant penser que l'Homme, lui seul, abrite une raison quiferait de nous des sujets indépendants et autonomes au regard de la raison universelle et déterministe, qui guidel'Histoire et structure la nature? De prime abord, il n'est pas permis d'en douter, car à son échelle, tout a chacun peut sentir sonindividualité.
Par ailleurs, les théories psychanalytiques se fondent essentiellement sur l'existence du moi, conscientet inconscient.
Je dis « je » et parle de « moi », de ma personnalité, de mes émotions et de mon ressenti, autant deperception de moi même qui prétende me signaler mon existence en tant que sujet.
Pourtant, puis-je conserver une continuelle perception de moi même? N'ai-je pas des instants d'absence,presque de perte de conscience? Si l'on pense au sommeil, il s'agit presque d'une perte de conscience de moi même.Cet état spécifique de veille sert la théorie des septiques du « moi », tel que Hume.
En effet, cet auteur remet enquestion la certitude d'un moi qui ferait de l'homme un sujet particulier.
Il établit que la perception doitnécessairement précéder l'idée.
De fait, plus la perception est claire et continue, plus l'idée qui en découlera pourraêtre considérée comme vraie.
Sans que la connaissance soit possible, selon les sceptiques, tout est question dedegré de certitude.
Or si je ne peux obtenir qu'une perception inconstante de moi même, la réalité du moi demeurecritiquable.
Pour Hume, c'est dans l'imagination qu'il faut chercher l'explication d'une impression de continuité.
Eneffet, nous créons une perception linéaire en imaginant une jonction entre deux moments de néant.
Néanmoins, sile sommeil reste une ambiguïté dans la conscience du sujet, je ne peux pas totalement nier la réalité du « moi » etde la raison en moi.
En effet, si le doute sert l'argumentation des sceptiques, ce même doute me permet de prendre consciencede la raison qui m'habite.
La célèbre formule cartésienne énonce: « Je pense, donc je suis ».
Autrement dit, je suisassuré d'être au monde en tant qu'être pensant, et donc raisonnable.
En effet, pour Descartes, l'entreprisephilosophique consiste à chercher la vérité en dehors de l'opinion de la doxa.
Pour ce faire, le « doute cartésien » lepousse à choisir de considérer toutes les connaissances du passé comme fausses et non-avenues.
Dans cet étatcritique, la seule certitude est la suivante: « je pense, donc je suis.
» De fait, c'est le doute même qui l'élève aurang de sujet raisonnable.
Cette ultime connaissance par introspection me garantit que je suis un sujet, libre de meschoix et de mes jugements.
Ainsi, si je suis objet, je ne suis pas quelconque.
Je reste plutôt sujet, objet de la convoitise d'autrui ou dudiscours, mais libre dans choix et être de raison.Néanmoins, comment puis-je passer de la certitude personnelle la garantie d'une subjectivité universelle? III) Si par introspection et dans l'action libre, je prends conscience de moi-même et de ma condition desujet, suis-je pour autant certain de la subjectivité d'autrui? Est-il sujet comme moi ? En effet, en tant qu'être raisonnable, je peux penser que ce qui m'entoure ne vaut que par moi.
Lalande nedit pas autre chose lorsqu'il affirme que les autres restent inconnus et qu'ils n'ont, peut-être, « pas plus de réalitéque les personnages des rêves ».
De fait, je peux être un sujet sans pour autant que « nous » soyons des sujets.Pourtant, cette idée trouve rapidement à être critiquée: Peut-on réellement être sujet sans être reconnu comme telpar un autre sujet raisonnable? En ce sens, même Descartes convoque la présence divine pour lui assurer sapensée.
Hegel suivra cette idée en soulignant la nécessité d'autrui, en tant qu'alter ego, dans la formation de laconscience de soi, à ne pas confondre avec le sentiment de ois, qui ne fait pas de moi un sujet.
De fait, la raisonqui fait le sujet semble avoir besoin d'une autre raison, et donc d'un autre sujet, pour exister.
Plus précisément, et parce qu'il est nécessaire de faire la distinction, à l'instar de Kant, le phénomène dunoumène, la raison est ce qui détermine le sujet.
Le sujet est noumène, c'est à dire chose en soi, parce qu'il jouitd'une ;liberté transcendantale qui l'arrache du temps et de l'espace.
Par la loi morale que tout a chacun porte en luigrâce à la raison universelle, nous prenons conscience de notre volonté et de notre liberté, je réalise ma vérité desujet.
Sartre nous rappelle que nous demeurons libres de nous réaliser chaque jour dans l'action car nous sommessujets de notre existence.
Le sujet est libre lorsqu'il crée ses propres projets, faisant des data, c'est-à-dire lesdonnées de l'existence humaine, une interprétation personnelle.
En tant que « zoom politikon », l'homme est tout entier intégré dans une cité, ce qui fait de lui un êtreprofondément social.
Cette caractéristique, cette qualité humaine, est en moi comme dans l'autre.
Par conséquent,nous sommes tous deux sujets du souverain qui nous gouverne.
Si le sujet est celui qui se soumet aux lois du.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- PHILO SUJETS ET CORRIGES
- Correction DS d'histoire-géographie SUJETS DE TYPE COMPARATIF
- Discussion : Peut-on parler de sujets sérieux en faisant rire ?
- SUJETS CONCOURS PE 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Types de questions McDO /santé................
- ODES SUR DIVERS SUJETS DESCRIPTIFS ET ALLÉGORIQUES William Collins - résumé, analyse