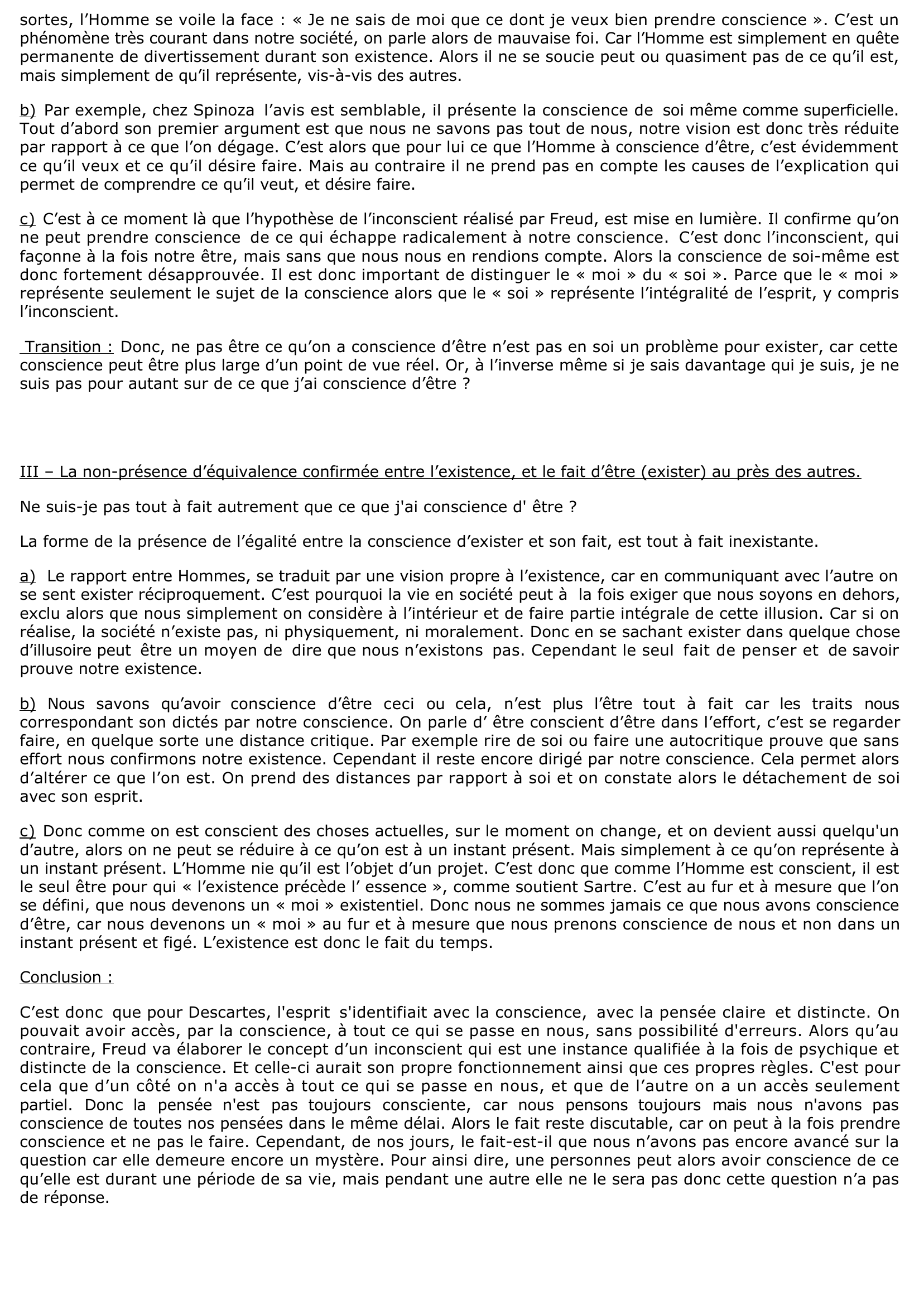Suis-je ce que j'ai conscience d'être ?
Publié le 10/12/2011

Extrait du document


«
sortes, l’Homme se voile la face : « Je ne sais de moi que ce dont je veux bien prendre conscience ».
C’est unphénomène très courant dans notre société, on parle alors de mauvaise foi.
Car l’Homme est simplement en quêtepermanente de divertissement durant son existence.
Alors il ne se soucie peut ou quasiment pas de ce qu’il est,mais simplement de qu’il représente, vis-à-vis des autres.
b) Par exemple, chez Spinoza l’avis est semblable, il présente la conscience de soi même comme superficielle. Tout d’abord son premier argument est que nous ne savons pas tout de nous, notre vision est donc très réduitepar rapport à ce que l’on dégage.
C’est alors que pour lui ce que l’Homme à conscience d’être, c’est évidemmentce qu’il veux et ce qu’il désire faire.
Mais au contraire il ne prend pas en compte les causes de l’explication quipermet de comprendre ce qu’il veut, et désire faire.
c) C’est à ce moment là que l’hypothèse de l’inconscient réalisé par Freud, est mise en lumière.
Il confirme qu’onne peut prendre conscience de ce qui échappe radicalement à notre conscience.
C’est donc l’inconscient, quifaçonne à la fois notre être, mais sans que nous nous en rendions compte.
Alors la conscience de soi-même estdonc fortement désapprouvée.
Il est donc important de distinguer le « moi » du « soi ».
Parce que le « moi »représente seulement le sujet de la conscience alors que le « soi » représente l’intégralité de l’esprit, y comprisl’inconscient.
Transition : Donc, ne pas être ce qu’on a conscience d’être n’est pas en soi un problème pour exister, car cette conscience peut être plus large d’un point de vue réel.
Or, à l’inverse même si je sais davantage qui je suis, je nesuis pas pour autant sur de ce que j’ai conscience d’être ?
III – La non-présence d’équivalence confirmée entre l’existence, et le fait d’être (exister) au près des autres.
Ne suis-je pas tout à fait autrement que ce que j'ai conscience d' être ?
La forme de la présence de l’égalité entre la conscience d’exister et son fait, est tout à fait inexistante.
a) Le rapport entre Hommes, se traduit par une vision propre à l’existence, car en communiquant avec l’autre onse sent exister réciproquement.
C’est pourquoi la vie en société peut à la fois exiger que nous soyons en dehors,exclu alors que nous simplement on considère à l’intérieur et de faire partie intégrale de cette illusion.
Car si onréalise, la société n’existe pas, ni physiquement, ni moralement.
Donc en se sachant exister dans quelque chosed’illusoire peut être un moyen de dire que nous n’existons pas.
Cependant le seul fait de penser et de savoirprouve notre existence.
b) Nous savons qu’avoir conscience d’être ceci ou cela, n’est plus l’être tout à fait car les traits nous correspondant son dictés par notre conscience.
On parle d’ être conscient d’être dans l’effort, c’est se regarderfaire, en quelque sorte une distance critique.
Par exemple rire de soi ou faire une autocritique prouve que sanseffort nous confirmons notre existence.
Cependant il reste encore dirigé par notre conscience.
Cela permet alorsd’altérer ce que l’on est.
On prend des distances par rapport à soi et on constate alors le détachement de soiavec son esprit.
c) Donc comme on est conscient des choses actuelles, sur le moment on change, et on devient aussi quelqu'und’autre, alors on ne peut se réduire à ce qu’on est à un instant présent.
Mais simplement à ce qu’on représente àun instant présent.
L’Homme nie qu’il est l’objet d’un projet.
C’est donc que comme l’Homme est conscient, il estle seul être pour qui « l’existence précède l’ essence », comme soutient Sartre.
C’est au fur et à mesure que l’onse défini, que nous devenons un « moi » existentiel.
Donc nous ne sommes jamais ce que nous avons conscienced’être, car nous devenons un « moi » au fur et à mesure que nous prenons conscience de nous et non dans uninstant présent et figé.
L’existence est donc le fait du temps.
Conclusion :
C’est donc que pour Descartes, l'esprit s'identifiait avec la conscience, avec la pensée claire et distincte.
Onpouvait avoir accès, par la conscience, à tout ce qui se passe en nous, sans possibilité d'erreurs.
Alors qu’aucontraire, Freud va élaborer le concept d’un inconscient qui est une instance qualifiée à la fois de psychique etdistincte de la conscience.
Et celle-ci aurait son propre fonctionnement ainsi que ces propres règles.
C'est pourcela que d’un côté on n'a accès à tout ce qui se passe en nous, et que de l’autre on a un accès seulementpartiel.
Donc la pensée n'est pas toujours consciente, car nous pensons toujours mais nous n'avons pasconscience de toutes nos pensées dans le même délai.
Alors le fait reste discutable, car on peut à la fois prendreconscience et ne pas le faire.
Cependant, de nos jours, le fait-est-il que nous n’avons pas encore avancé sur laquestion car elle demeure encore un mystère.
Pour ainsi dire, une personnes peut alors avoir conscience de cequ’elle est durant une période de sa vie, mais pendant une autre elle ne le sera pas donc cette question n’a pasde réponse..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La conscience de soi rend-elle libre ? (Corrigé) Problématisation
- Commentaire Texte Bergson L'évolution créatrice, l'élan vital et la conscience
- expose sur la conscience
- La conscience de soi suppose-t-elle autrui ?
- LA CONSCIENCE (résumé)