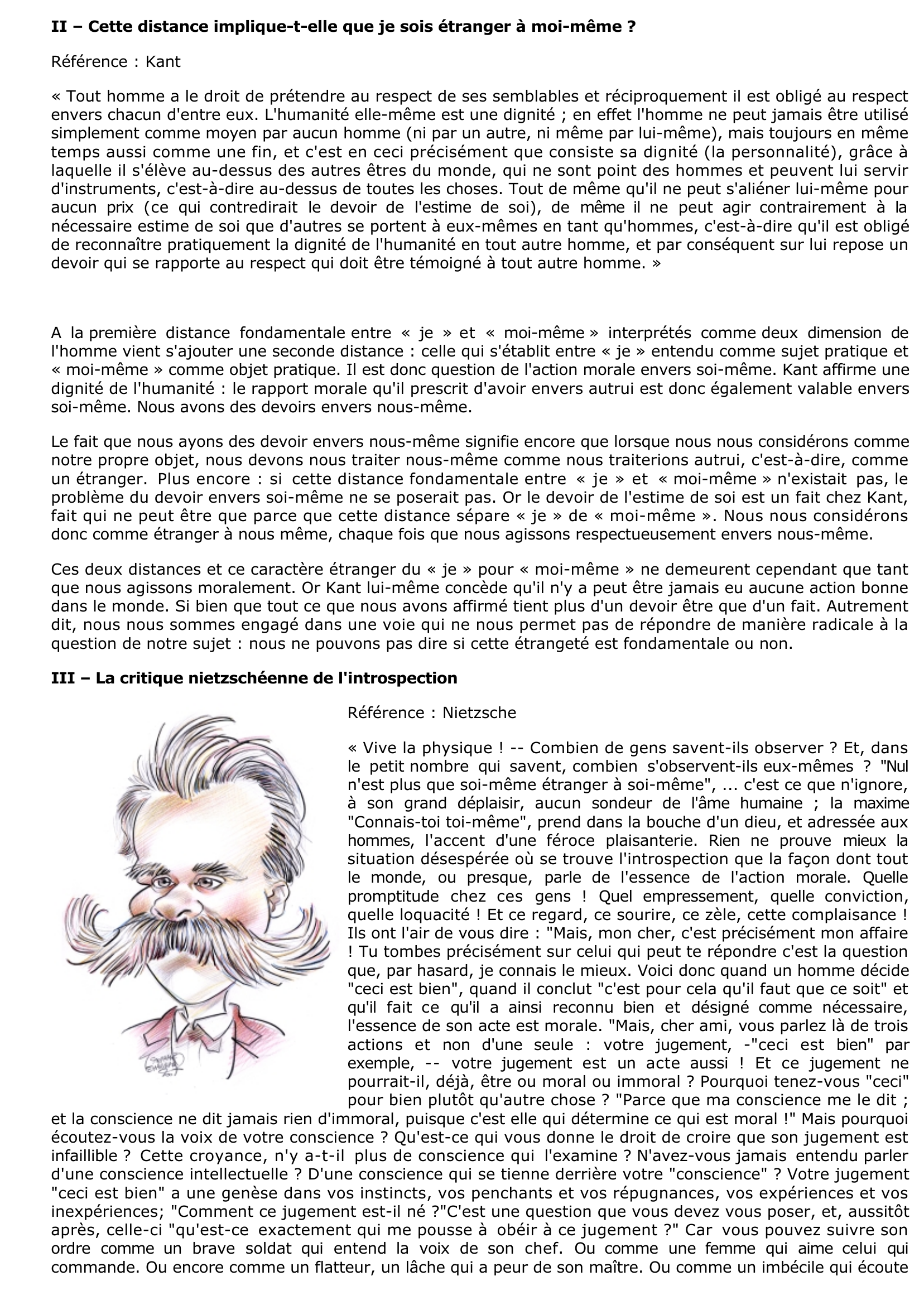Suis-je pour moi-même un étranger ?
Publié le 27/02/2005

Extrait du document
La dissertation consiste, rappelons-le, à apporter une réponse à la question qui nous est posée : comment ? Il faut établir un ordre dans lequel résoudre les problèmes qui nous empêchent de fournir une réponse à la question : cet ordre constitue la problématique.
Le premier problème auquel nous nous trouvons confrontés est le suivant :
- Y a-t-il une distance entre je et moi-même ?
Une fois ce problème résolu, nous devons nous demander :
- Cette distance implique-t-elle que je sois étranger à moi-même ? [il se pourrait très bien que malgré cette distance, je ne sois pas étranger mais ami de moi-même par exemple]
«
II – Cette distance implique-t-elle que je sois étranger à moi-même ?
Référence : Kant
« Tout homme a le droit de prétendre au respect de ses semblables et réciproquement il est obligé au respectenvers chacun d'entre eux.
L'humanité elle-même est une dignité ; en effet l'homme ne peut jamais être utilisésimplement comme moyen par aucun homme (ni par un autre, ni même par lui-même), mais toujours en mêmetemps aussi comme une fin, et c'est en ceci précisément que consiste sa dignité (la personnalité), grâce àlaquelle il s'élève au-dessus des autres êtres du monde, qui ne sont point des hommes et peuvent lui servird'instruments, c'est-à-dire au-dessus de toutes les choses.
Tout de même qu'il ne peut s'aliéner lui-même pouraucun prix (ce qui contredirait le devoir de l'estime de soi), de même il ne peut agir contrairement à lanécessaire estime de soi que d'autres se portent à eux-mêmes en tant qu'hommes, c'est-à-dire qu'il est obligéde reconnaître pratiquement la dignité de l'humanité en tout autre homme, et par conséquent sur lui repose undevoir qui se rapporte au respect qui doit être témoigné à tout autre homme.
»
A la première distance fondamentale entre « je » et « moi-même » interprétés comme deux dimension del'homme vient s'ajouter une seconde distance : celle qui s'établit entre « je » entendu comme sujet pratique et« moi-même » comme objet pratique.
Il est donc question de l'action morale envers soi-même.
Kant affirme unedignité de l'humanité : le rapport morale qu'il prescrit d'avoir envers autrui est donc également valable enverssoi-même.
Nous avons des devoirs envers nous-même.
Le fait que nous ayons des devoir envers nous-même signifie encore que lorsque nous nous considérons commenotre propre objet, nous devons nous traiter nous-même comme nous traiterions autrui, c'est-à-dire, commeun étranger.
Plus encore : si cette distance fondamentale entre « je » et « moi-même » n'existait pas, leproblème du devoir envers soi-même ne se poserait pas.
Or le devoir de l'estime de soi est un fait chez Kant,fait qui ne peut être que parce que cette distance sépare « je » de « moi-même ».
Nous nous considéronsdonc comme étranger à nous même, chaque fois que nous agissons respectueusement envers nous-même.
Ces deux distances et ce caractère étranger du « je » pour « moi-même » ne demeurent cependant que tantque nous agissons moralement.
Or Kant lui-même concède qu'il n'y a peut être jamais eu aucune action bonnedans le monde.
Si bien que tout ce que nous avons affirmé tient plus d'un devoir être que d'un fait.
Autrementdit, nous nous sommes engagé dans une voie qui ne nous permet pas de répondre de manière radicale à laquestion de notre sujet : nous ne pouvons pas dire si cette étrangeté est fondamentale ou non.
III – La critique nietzschéenne de l'introspection
Référence : Nietzsche
« Vive la physique ! -- Combien de gens savent-ils observer ? Et, dansle petit nombre qui savent, combien s'observent-ils eux-mêmes ? "Nuln'est plus que soi-même étranger à soi-même", ...
c'est ce que n'ignore,à son grand déplaisir, aucun sondeur de l'âme humaine ; la maxime"Connais-toi toi-même", prend dans la bouche d'un dieu, et adressée auxhommes, l'accent d'une féroce plaisanterie.
Rien ne prouve mieux lasituation désespérée où se trouve l'introspection que la façon dont toutle monde, ou presque, parle de l'essence de l'action morale.
Quellepromptitude chez ces gens ! Quel empressement, quelle conviction,quelle loquacité ! Et ce regard, ce sourire, ce zèle, cette complaisance !Ils ont l'air de vous dire : "Mais, mon cher, c'est précisément mon affaire! Tu tombes précisément sur celui qui peut te répondre c'est la questionque, par hasard, je connais le mieux.
Voici donc quand un homme décide"ceci est bien", quand il conclut "c'est pour cela qu'il faut que ce soit" etqu'il fait ce qu'il a ainsi reconnu bien et désigné comme nécessaire,l'essence de son acte est morale.
"Mais, cher ami, vous parlez là de troisactions et non d'une seule : votre jugement, -"ceci est bien" parexemple, -- votre jugement est un acte aussi ! Et ce jugement nepourrait-il, déjà, être ou moral ou immoral ? Pourquoi tenez-vous "ceci"pour bien plutôt qu'autre chose ? "Parce que ma conscience me le dit ; et la conscience ne dit jamais rien d'immoral, puisque c'est elle qui détermine ce qui est moral !" Mais pourquoiécoutez-vous la voix de votre conscience ? Qu'est-ce qui vous donne le droit de croire que son jugement estinfaillible ? Cette croyance, n'y a-t-il plus de conscience qui l'examine ? N'avez-vous jamais entendu parlerd'une conscience intellectuelle ? D'une conscience qui se tienne derrière votre "conscience" ? Votre jugement"ceci est bien" a une genèse dans vos instincts, vos penchants et vos répugnances, vos expériences et vosinexpériences; "Comment ce jugement est-il né ?"C'est une question que vous devez vous poser, et, aussitôtaprès, celle-ci "qu'est-ce exactement qui me pousse à obéir à ce jugement ?" Car vous pouvez suivre sonordre comme un brave soldat qui entend la voix de son chef.
Ou comme une femme qui aime celui quicommande.
Ou encore comme un flatteur, un lâche qui a peur de son maître.
Ou comme un imbécile qui écoute.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'étranger
- ÉTRANGER (L') de Knap
- ÉTRANGER (L’) de Karaosmanoglu (résumé) Yakup Kadri Karaosmanoglu
- Le conjoint est étranger.
- Corpus Thérèse Raquin Emile Zola, La Condition Humaine André Malraux, L’étranger Albert Camus