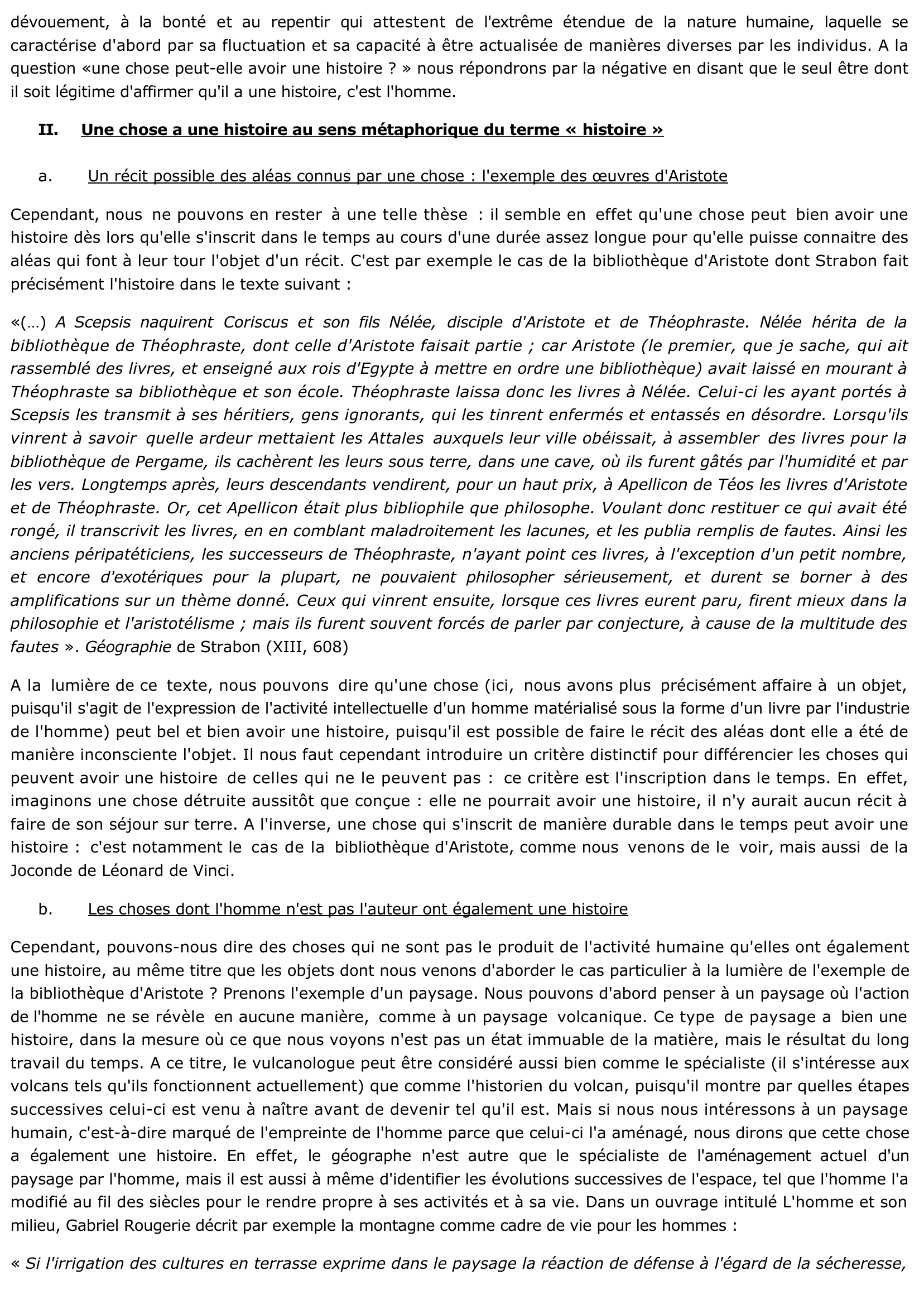Une chose peut elle avoir une histoire ?
Publié le 03/09/2006

Extrait du document

Une chose est un être inanimé, qui s’oppose par définition à ce qui est vivant. En un sens plus philosophique, celui de « la chose en soi « telle que conceptualisée par Kant, une chose est la réalité telle qu’en elle-même, en dehors de la représentation humaine, donc inconnaissable.
Le mot « Histoire « désigne toute connaissance basée sur l’observation, la description de faits advenus dans le passé. Il y a lieu de distinguer entre l’histoire, récit véridique du passé, et l’Histoire, comme réalité historique, totalité de ce qui a eu lieu et de ce qui aura lieu dans l’avenir.
A première vue, la question « une chose peut-elle avoir une histoire ? « ne peut que nous surprendre. En effet, nous ne parlons jamais de l’histoire des choses, mais toujours de l’histoire des êtres humains. Il peut en effet nous sembler que l’expression « histoire d’une chose « est tout à fait métaphorique, qu’elle ne fonctionne que par comparaison avec ce dont on fait proprement l’histoire, à savoir des hommes et des produits de leur activité. Cependant, n’y a-t-il pas néanmoins un sens à donner à l’expression « histoire d’une chose «, de sorte que nous puissions dire qu’une chose a bien une histoire, à savoir une inscription dont le temps dont on peut faire le récit, comme c’est le cas de nombre de choses qui ont fasciné les historiens, tels que la Joconde ou les ouvrages d’Aristote. Enfin, nous verrons que si une chose peut bel et bien avoir une histoire, il semble avant tout que les choses servent à l’histoire, puisqu’il n’y a pas d’histoire qui puisse s’écrire sans le support d’un document matériel, que celui-ci soit un produit de l’activité humaine ou seulement la matière dans laquelle s’inscrit, à l’état de trace, le souvenir de ce qui fut le passé de l’homme.
La question au centre de notre travail sera donc de déterminer s’il n’existe qu’une histoire de l’homme et si le seul rôle historique des choses est de servir à cette histoire à titre de documents.

«
dévouement, à la bonté et au repentir qui attestent de l'extrême étendue de la nature humaine, laquelle secaractérise d'abord par sa fluctuation et sa capacité à être actualisée de manières diverses par les individus.
A laquestion «une chose peut-elle avoir une histoire ? » nous répondrons par la négative en disant que le seul être dontil soit légitime d'affirmer qu'il a une histoire, c'est l'homme.
II.
Une chose a une histoire au sens métaphorique du terme « histoire » a.
Un récit possible des aléas connus par une chose : l'exemple des œuvres d'Aristote
Cependant, nous ne pouvons en rester à une telle thèse : il semble en effet qu'une chose peut bien avoir unehistoire dès lors qu'elle s'inscrit dans le temps au cours d'une durée assez longue pour qu'elle puisse connaitre desaléas qui font à leur tour l'objet d'un récit.
C'est par exemple le cas de la bibliothèque d'Aristote dont Strabon faitprécisément l'histoire dans le texte suivant :
«(…) A Scepsis naquirent Coriscus et son fils Nélée, disciple d'Aristote et de Théophraste.
Nélée hérita de la bibliothèque de Théophraste, dont celle d'Aristote faisait partie ; car Aristote (le premier, que je sache, qui aitrassemblé des livres, et enseigné aux rois d'Egypte à mettre en ordre une bibliothèque) avait laissé en mourant àThéophraste sa bibliothèque et son école.
Théophraste laissa donc les livres à Nélée.
Celui-ci les ayant portés àScepsis les transmit à ses héritiers, gens ignorants, qui les tinrent enfermés et entassés en désordre.
Lorsqu'ilsvinrent à savoir quelle ardeur mettaient les Attales auxquels leur ville obéissait, à assembler des livres pour labibliothèque de Pergame, ils cachèrent les leurs sous terre, dans une cave, où ils furent gâtés par l'humidité et parles vers.
Longtemps après, leurs descendants vendirent, pour un haut prix, à Apellicon de Téos les livres d'Aristoteet de Théophraste.
Or, cet Apellicon était plus bibliophile que philosophe.
Voulant donc restituer ce qui avait étérongé, il transcrivit les livres, en en comblant maladroitement les lacunes, et les publia remplis de fautes.
Ainsi lesanciens péripatéticiens, les successeurs de Théophraste, n'ayant point ces livres, à l'exception d'un petit nombre,et encore d'exotériques pour la plupart, ne pouvaient philosopher sérieusement, et durent se borner à desamplifications sur un thème donné.
Ceux qui vinrent ensuite, lorsque ces livres eurent paru, firent mieux dans laphilosophie et l'aristotélisme ; mais ils furent souvent forcés de parler par conjecture, à cause de la multitude desfautes ».
Géographie de Strabon (XIII, 608)
A la lumière de ce texte, nous pouvons dire qu'une chose (ici, nous avons plus précisément affaire à un objet,puisqu'il s'agit de l'expression de l'activité intellectuelle d'un homme matérialisé sous la forme d'un livre par l'industriede l'homme) peut bel et bien avoir une histoire, puisqu'il est possible de faire le récit des aléas dont elle a été demanière inconsciente l'objet.
Il nous faut cependant introduire un critère distinctif pour différencier les choses quipeuvent avoir une histoire de celles qui ne le peuvent pas : ce critère est l'inscription dans le temps.
En effet,imaginons une chose détruite aussitôt que conçue : elle ne pourrait avoir une histoire, il n'y aurait aucun récit àfaire de son séjour sur terre.
A l'inverse, une chose qui s'inscrit de manière durable dans le temps peut avoir unehistoire : c'est notamment le cas de la bibliothèque d'Aristote, comme nous venons de le voir, mais aussi de laJoconde de Léonard de Vinci.
b.
Les choses dont l'homme n'est pas l'auteur ont également une histoire
Cependant, pouvons-nous dire des choses qui ne sont pas le produit de l'activité humaine qu'elles ont égalementune histoire, au même titre que les objets dont nous venons d'aborder le cas particulier à la lumière de l'exemple dela bibliothèque d'Aristote ? Prenons l'exemple d'un paysage.
Nous pouvons d'abord penser à un paysage où l'actionde l'homme ne se révèle en aucune manière, comme à un paysage volcanique.
Ce type de paysage a bien unehistoire, dans la mesure où ce que nous voyons n'est pas un état immuable de la matière, mais le résultat du longtravail du temps.
A ce titre, le vulcanologue peut être considéré aussi bien comme le spécialiste (il s'intéresse auxvolcans tels qu'ils fonctionnent actuellement) que comme l'historien du volcan, puisqu'il montre par quelles étapessuccessives celui-ci est venu à naître avant de devenir tel qu'il est.
Mais si nous nous intéressons à un paysagehumain, c'est-à-dire marqué de l'empreinte de l'homme parce que celui-ci l'a aménagé, nous dirons que cette chosea également une histoire.
En effet, le géographe n'est autre que le spécialiste de l'aménagement actuel d'unpaysage par l'homme, mais il est aussi à même d'identifier les évolutions successives de l'espace, tel que l'homme l'amodifié au fil des siècles pour le rendre propre à ses activités et à sa vie.
Dans un ouvrage intitulé L'homme et sonmilieu, Gabriel Rougerie décrit par exemple la montagne comme cadre de vie pour les hommes :
« Si l'irrigation des cultures en terrasse exprime dans le paysage la réaction de défense à l'égard de la sécheresse,.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- PETIT CHOSE, HISTOIRE D’UN ENFANT (Le) Alphonse Daudet : Fiche de lecture
- Dans une lettre à un ami, après un rapide examen de la manière dont l'histoire était comprise avant lui, Augustin Thierry expose sa propre manière de la concevoir et de la traiter. © Tu te rappelles l’enthousiasme que provoqua chez moi la lecture du sixième livre des Martyrs. Ce moment a été décisif pour ma vocation. Je serai historien, mais je veux faire quelque chose de tout à fait nouveau.
- L'homme est-il pleinement l'agent de son devenir ou bien l'histoire est-elle faite par autre chose que l'action humaine ? L'histoire des hommes est-elle leur histoire ?
- L'élaboration de l'histoire comporte-t-elle quelque chose de scientifique ?
- Faut-il attendre de l'histoire qu'elle nous apprenne quelque chose sur l'homme ?