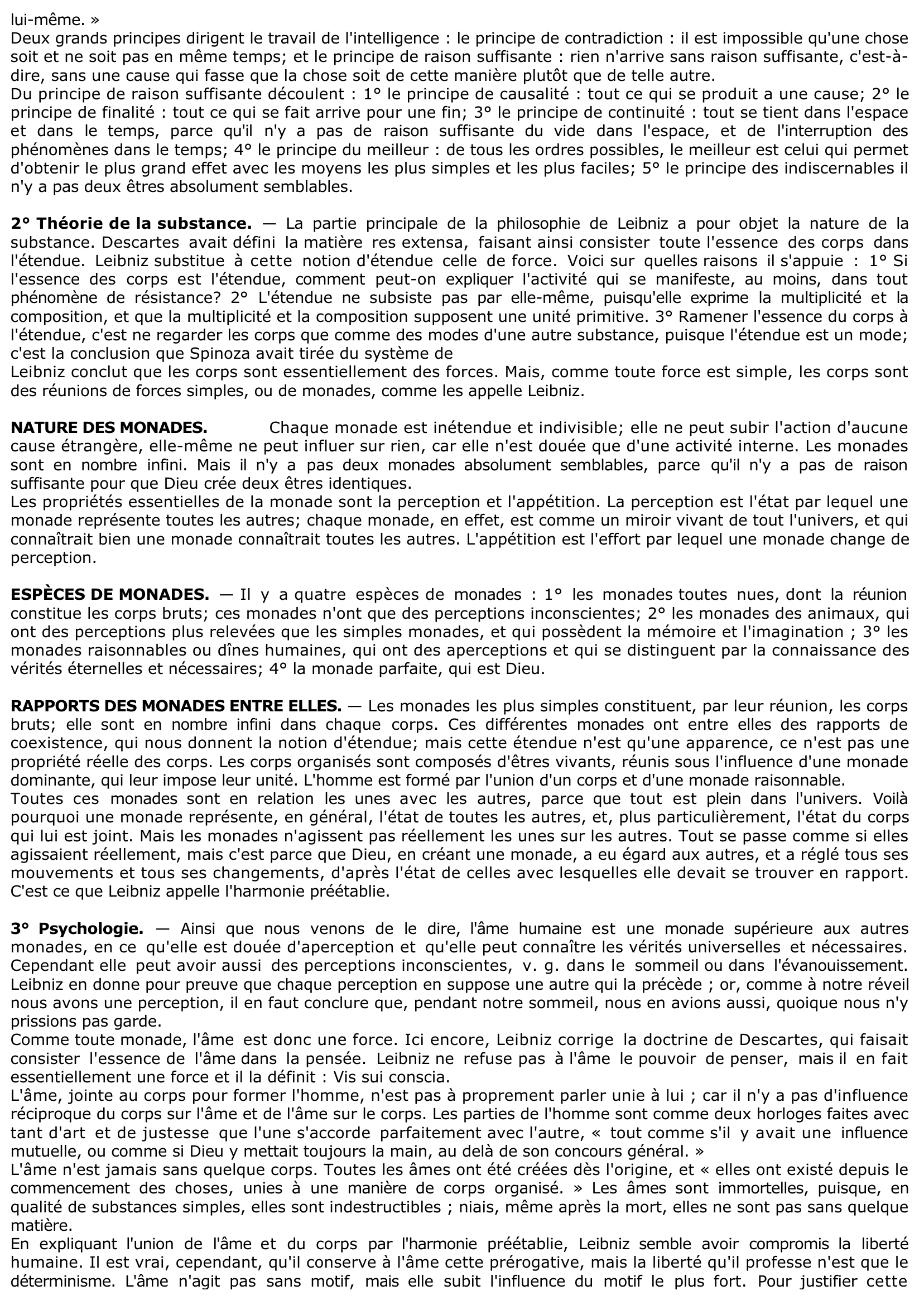Vie et philosophie de LEIBNIZ ?
Publié le 24/05/2009

Extrait du document

Leibniz, né à Leipzig, en 1646, était fils d'un professeur de philosophie à l'université de cette ville. Dès l'âge de huit ans, il montrait une ardeur extrême pour l'étude, et il passait la plus grande partie de son temps dans une bibliothèque, où il dévorait au hasard tous les livres qui lui tombaient sous la main. A quinze ans, il avait parcouru le cercle ordinaire des humanités. Il se mit alors à étudier Platon et Aristote; puis, des anciens, il passa aux modernes. Mais il ne se borna pas à la philosophie, il aborda en même temps la théologie, la physique, les mathématiques, le droit, l'histoire et la philologie. A vingt un ans, il se présenta à l'université de Leipzig pour y prendre le titre de docteur. Refusé à cause de son âge, il alla se faire recevoir à Altdorf, en Bavière.

«
lui-même.
»Deux grands principes dirigent le travail de l'intelligence : le principe de contradiction : il est impossible qu'une chosesoit et ne soit pas en même temps; et le principe de raison suffisante : rien n'arrive sans raison suffisante, c'est-à-dire, sans une cause qui fasse que la chose soit de cette manière plutôt que de telle autre.Du principe de raison suffisante découlent : 1° le principe de causalité : tout ce qui se produit a une cause; 2° leprincipe de finalité : tout ce qui se fait arrive pour une fin; 3° le principe de continuité : tout se tient dans l'espaceet dans le temps, parce qu'il n'y a pas de raison suffisante du vide dans l'espace, et de l'interruption desphénomènes dans le temps; 4° le principe du meilleur : de tous les ordres possibles, le meilleur est celui qui permetd'obtenir le plus grand effet avec les moyens les plus simples et les plus faciles; 5° le principe des indiscernables iln'y a pas deux êtres absolument semblables.
2° Théorie de la substance. — La partie principale de la philosophie de Leibniz a pour objet la nature de la substance.
Descartes avait défini la matière res extensa, faisant ainsi consister toute l'essence des corps dansl'étendue.
Leibniz substitue à cette notion d'étendue celle de force.
Voici sur quelles raisons il s'appuie : 1° Sil'essence des corps est l'étendue, comment peut-on expliquer l'activité qui se manifeste, au moins, dans toutphénomène de résistance? 2° L'étendue ne subsiste pas par elle-même, puisqu'elle exprime la multiplicité et lacomposition, et que la multiplicité et la composition supposent une unité primitive.
3° Ramener l'essence du corps àl'étendue, c'est ne regarder les corps que comme des modes d'une autre substance, puisque l'étendue est un mode;c'est la conclusion que Spinoza avait tirée du système deLeibniz conclut que les corps sont essentiellement des forces.
Mais, comme toute force est simple, les corps sontdes réunions de forces simples, ou de monades, comme les appelle Leibniz.
NATURE DES MONADES. Chaque monade est inétendue et indivisible; elle ne peut subir l'action d'aucune cause étrangère, elle-même ne peut influer sur rien, car elle n'est douée que d'une activité interne.
Les monadessont en nombre infini.
Mais il n'y a pas deux monades absolument semblables, parce qu'il n'y a pas de raisonsuffisante pour que Dieu crée deux êtres identiques.Les propriétés essentielles de la monade sont la perception et l'appétition.
La perception est l'état par lequel unemonade représente toutes les autres; chaque monade, en effet, est comme un miroir vivant de tout l'univers, et quiconnaîtrait bien une monade connaîtrait toutes les autres.
L'appétition est l'effort par lequel une monade change deperception.
ESPÈCES DE MONADES. — Il y a quatre espèces de monades : 1° les monades toutes nues, dont la réunion constitue les corps bruts; ces monades n'ont que des perceptions inconscientes; 2° les monades des animaux, quiont des perceptions plus relevées que les simples monades, et qui possèdent la mémoire et l'imagination ; 3° lesmonades raisonnables ou dînes humaines, qui ont des aperceptions et qui se distinguent par la connaissance desvérités éternelles et nécessaires; 4° la monade parfaite, qui est Dieu.
RAPPORTS DES MONADES ENTRE ELLES. — Les monades les plus simples constituent, par leur réunion, les corps bruts; elle sont en nombre infini dans chaque corps.
Ces différentes monades ont entre elles des rapports decoexistence, qui nous donnent la notion d'étendue; mais cette étendue n'est qu'une apparence, ce n'est pas unepropriété réelle des corps.
Les corps organisés sont composés d'êtres vivants, réunis sous l'influence d'une monadedominante, qui leur impose leur unité.
L'homme est formé par l'union d'un corps et d'une monade raisonnable.Toutes ces monades sont en relation les unes avec les autres, parce que tout est plein dans l'univers.
Voilàpourquoi une monade représente, en général, l'état de toutes les autres, et, plus particulièrement, l'état du corpsqui lui est joint.
Mais les monades n'agissent pas réellement les unes sur les autres.
Tout se passe comme si ellesagissaient réellement, mais c'est parce que Dieu, en créant une monade, a eu égard aux autres, et a réglé tous sesmouvements et tous ses changements, d'après l'état de celles avec lesquelles elle devait se trouver en rapport.C'est ce que Leibniz appelle l'harmonie préétablie.
3° Psychologie. — Ainsi que nous venons de le dire, l'âme humaine est une monade supérieure aux autres monades, en ce qu'elle est douée d'aperception et qu'elle peut connaître les vérités universelles et nécessaires.Cependant elle peut avoir aussi des perceptions inconscientes, v.
g.
dans le sommeil ou dans l'évanouissement.Leibniz en donne pour preuve que chaque perception en suppose une autre qui la précède ; or, comme à notre réveilnous avons une perception, il en faut conclure que, pendant notre sommeil, nous en avions aussi, quoique nous n'yprissions pas garde.Comme toute monade, l'âme est donc une force.
Ici encore, Leibniz corrige la doctrine de Descartes, qui faisaitconsister l'essence de l'âme dans la pensée.
Leibniz ne refuse pas à l'âme le pouvoir de penser, mais il en faitessentiellement une force et il la définit : Vis sui conscia.L'âme, jointe au corps pour former l'homme, n'est pas à proprement parler unie à lui ; car il n'y a pas d'influenceréciproque du corps sur l'âme et de l'âme sur le corps.
Les parties de l'homme sont comme deux horloges faites avectant d'art et de justesse que l'une s'accorde parfaitement avec l'autre, « tout comme s'il y avait une influencemutuelle, ou comme si Dieu y mettait toujours la main, au delà de son concours général.
»L'âme n'est jamais sans quelque corps.
Toutes les âmes ont été créées dès l'origine, et « elles ont existé depuis lecommencement des choses, unies à une manière de corps organisé.
» Les âmes sont immortelles, puisque, enqualité de substances simples, elles sont indestructibles ; niais, même après la mort, elles ne sont pas sans quelquematière.En expliquant l'union de l'âme et du corps par l'harmonie préétablie, Leibniz semble avoir compromis la libertéhumaine.
Il est vrai, cependant, qu'il conserve à l'âme cette prérogative, mais la liberté qu'il professe n'est que ledéterminisme.
L'âme n'agit pas sans motif, mais elle subit l'influence du motif le plus fort.
Pour justifier cette.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Master 2 de philosophie Le devoir de vivre sur la base de la vie comme une dette
- HOMME ET LA TECHNIQUE (L ), contribution à une philosophie de la vie Oswald Spengler
- Dissertation de philosophie Sujet : Pour réussir sa vie, doit-on suivre ses passions ou sa raison ?
- Philosophie et réussite financière - Richesse et Bonheur - Vie réussie et réussite matérielle
- La philosophie de Kant par rapport à Leibniz