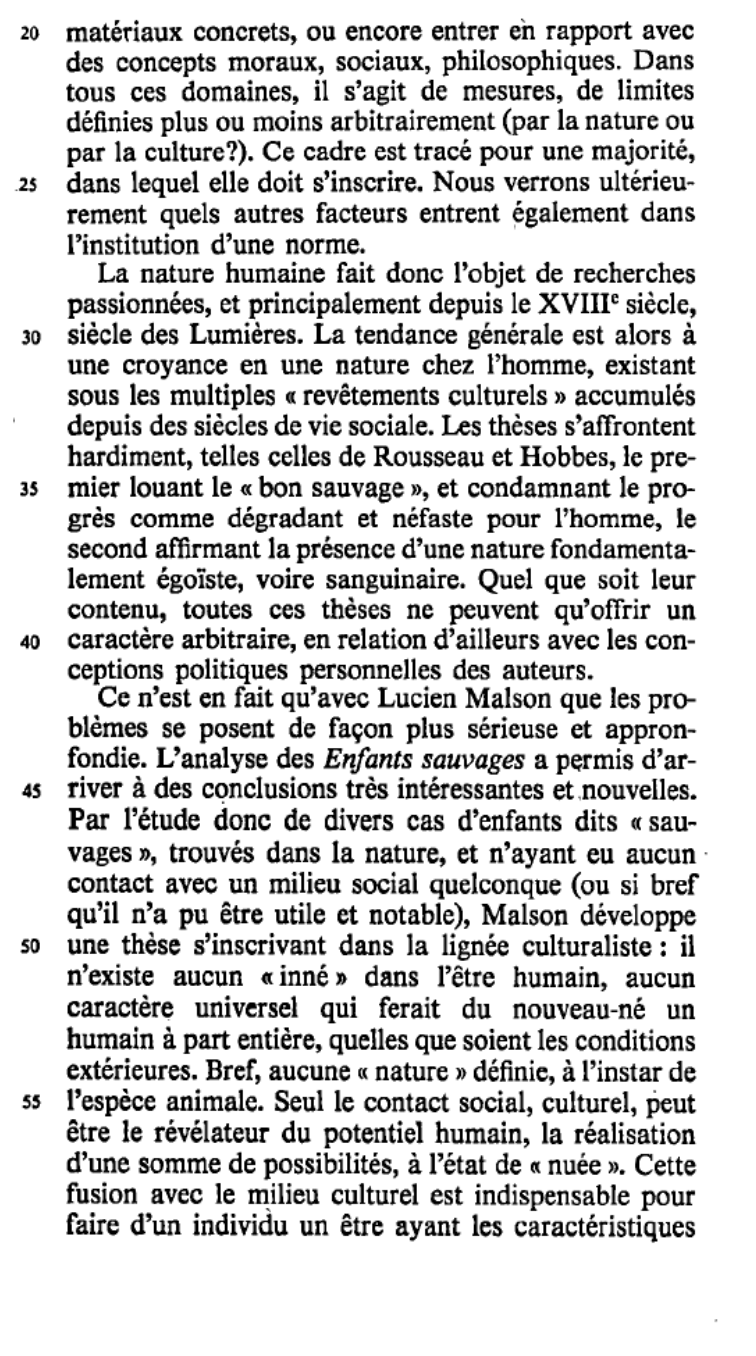Y-a-t-il des nomes naturelles?
Publié le 26/01/2020

Extrait du document
d’un humain. Ce potentiel n’est lui-même défini ni limité, il s’agit d’un éternel « jaillissement » (Maison).
Toutes les études culturalistes tendent donc à prouver l’absence d’une nature : l’homme n’est rien sans la culture.
Autre courant, relativement neuf, rejoignant sur ce point Maison et les culturalistes : l’existentialisme, philosophie de l’absurde, concevant l’existence comme un hasard dénué de toute raison profonde et de sens. Il n’existe pas de valeurs humaines absolues et précédant l’existence en tant que concept fixe. L’homme doit (et c’est là le but de son existence) trouver seul ses «repères», et les considérer comme seuls valables. « Ma subjectivité, c’est ma vérité » (Sartre). L’individu est seul en face de lui-même, sans Dieu transcendant pour le guider. Enfin, pour ne mentionner que les courants les plus importants, Freud et la psychanalyse ont fait effectuer à la psychologie un pas gigantesque en même temps qu’ils réduisaient à néant des préjugés et tabous séculaires. Le XIXe siècle a été scandalisé d’entendre dire par Freud et ses contemporains que le « normal » n’existe pas, que les « perversions » sont en fait purement culturelles et non innées. La psychanalyse a prouvé l’influence déterminante et fondamentale du champ social sur le psychisme de l’individu. Aucun homme n’est semblable à un autre, parce que tous ont subi des conditions extérieures différentes. D’une façon générale, la pensée contemporaine s’oriente vers le culturalisme, et vers une négation de toute valeur absolue, en même temps qu’elle s’intéresse davantage à l’individu même.
Quelle doit donc être une position rationnelle à l’égard de ce problème? L’influence de la culture sur l’homme paraît indéniable, mais elle ne nie pas la possibilité d’une nature. Il est tout aussi hasardeux et arbitraire d’affirmer la présence de «normes naturelles» que d’en affirmer l’absence, si l’on se place d’un point de vue strictement scientifique et objectif. Ici donc doit entrer la subjectivité, afin de pouvoir poursuivre l’analyse.
Une telle connaissance des théories des ethnologues concernant les différents univers culturels était la meilleure base pour construire une réflexion circonspecte sur l’universalité des normes, qu’il s’agissait bien de remettre en question, et sur leur rapport avec la « nature humaine », qu’il était souhaitable de suspecter dans son existence objective.
Un très bon travail donc, où les qualités l’emportent de très loin sur les quelques imperfections minimes qui y sont décelables - notamment le fait de rapporter trop univoquement l’existentialisme à une philosophie de l’absurde.
Travail d'étude à partir de ce devoir
- On recherchera la définition et l’illustration de tous les concepts utilisés dans ce devoir, ainsi que des théories dont ils procèdent, dans l’ouvrage intitulé Sciences humaines et philosophie en Afrique : la différence culturelle, Hatier, 1978, ouvrage interdisciplinaire destiné à un enseignement de la philosophie intégrant l’étude des sciences humaines. On s’exercera à disserter sur les sujets contenus dans la rubrique thèmes de travaux.
- Norme, Règle et Loi : comment les distinguer?
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Fig. 17 Carte des nomes de Haute-Égypte. les Égyptiens sepat, puis qâh
- Les divinités des nomes la Moyenne-Égypte
- Les divinités des nomes : la Haute-Egypte
- Les divinités des nomes : le delta du Nil