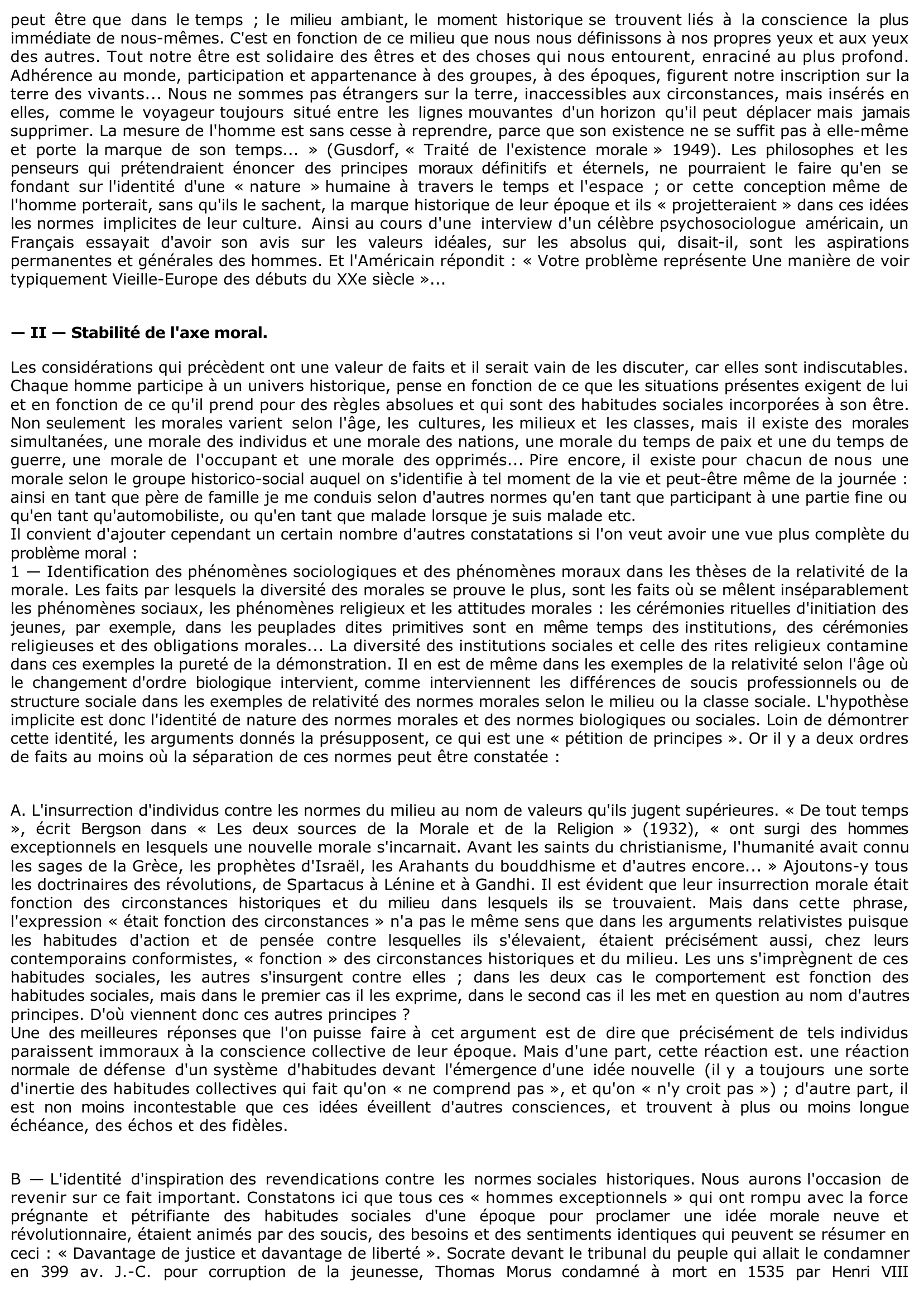Y a-t-il une morale ou des morales ?
Publié le 27/02/2008

Extrait du document


«
peut être que dans le temps ; le milieu ambiant, le moment historique se trouvent liés à la conscience la plusimmédiate de nous-mêmes.
C'est en fonction de ce milieu que nous nous définissons à nos propres yeux et aux yeuxdes autres.
Tout notre être est solidaire des êtres et des choses qui nous entourent, enraciné au plus profond.Adhérence au monde, participation et appartenance à des groupes, à des époques, figurent notre inscription sur laterre des vivants...
Nous ne sommes pas étrangers sur la terre, inaccessibles aux circonstances, mais insérés enelles, comme le voyageur toujours situé entre les lignes mouvantes d'un horizon qu'il peut déplacer mais jamaissupprimer.
La mesure de l'homme est sans cesse à reprendre, parce que son existence ne se suffit pas à elle-mêmeet porte la marque de son temps...
» (Gusdorf, « Traité de l'existence morale » 1949).
Les philosophes et lespenseurs qui prétendraient énoncer des principes moraux définitifs et éternels, ne pourraient le faire qu'en sefondant sur l'identité d'une « nature » humaine à travers le temps et l'espace ; or cette conception même del'homme porterait, sans qu'ils le sachent, la marque historique de leur époque et ils « projetteraient » dans ces idéesles normes implicites de leur culture.
Ainsi au cours d'une interview d'un célèbre psychosociologue américain, unFrançais essayait d'avoir son avis sur les valeurs idéales, sur les absolus qui, disait-il, sont les aspirationspermanentes et générales des hommes.
Et l'Américain répondit : « Votre problème représente Une manière de voirtypiquement Vieille-Europe des débuts du XXe siècle »...
— II — Stabilité de l'axe moral.
Les considérations qui précèdent ont une valeur de faits et il serait vain de les discuter, car elles sont indiscutables.Chaque homme participe à un univers historique, pense en fonction de ce que les situations présentes exigent de luiet en fonction de ce qu'il prend pour des règles absolues et qui sont des habitudes sociales incorporées à son être.Non seulement les morales varient selon l'âge, les cultures, les milieux et les classes, mais il existe des moralessimultanées, une morale des individus et une morale des nations, une morale du temps de paix et une du temps deguerre, une morale de l'occupant et une morale des opprimés...
Pire encore, il existe pour chacun de nous unemorale selon le groupe historico-social auquel on s'identifie à tel moment de la vie et peut-être même de la journée :ainsi en tant que père de famille je me conduis selon d'autres normes qu'en tant que participant à une partie fine ouqu'en tant qu'automobiliste, ou qu'en tant que malade lorsque je suis malade etc.Il convient d'ajouter cependant un certain nombre d'autres constatations si l'on veut avoir une vue plus complète duproblème moral :1 — Identification des phénomènes sociologiques et des phénomènes moraux dans les thèses de la relativité de lamorale.
Les faits par lesquels la diversité des morales se prouve le plus, sont les faits où se mêlent inséparablementles phénomènes sociaux, les phénomènes religieux et les attitudes morales : les cérémonies rituelles d'initiation desjeunes, par exemple, dans les peuplades dites primitives sont en même temps des institutions, des cérémoniesreligieuses et des obligations morales...
La diversité des institutions sociales et celle des rites religieux contaminedans ces exemples la pureté de la démonstration.
Il en est de même dans les exemples de la relativité selon l'âge oùle changement d'ordre biologique intervient, comme interviennent les différences de soucis professionnels ou destructure sociale dans les exemples de relativité des normes morales selon le milieu ou la classe sociale.
L'hypothèseimplicite est donc l'identité de nature des normes morales et des normes biologiques ou sociales.
Loin de démontrercette identité, les arguments donnés la présupposent, ce qui est une « pétition de principes ».
Or il y a deux ordresde faits au moins où la séparation de ces normes peut être constatée :
A.
L'insurrection d'individus contre les normes du milieu au nom de valeurs qu'ils jugent supérieures.
« De tout temps», écrit Bergson dans « Les deux sources de la Morale et de la Religion » (1932), « ont surgi des hommesexceptionnels en lesquels une nouvelle morale s'incarnait.
Avant les saints du christianisme, l'humanité avait connules sages de la Grèce, les prophètes d'Israël, les Arahants du bouddhisme et d'autres encore...
» Ajoutons-y tousles doctrinaires des révolutions, de Spartacus à Lénine et à Gandhi.
Il est évident que leur insurrection morale étaitfonction des circonstances historiques et du milieu dans lesquels ils se trouvaient.
Mais dans cette phrase,l'expression « était fonction des circonstances » n'a pas le même sens que dans les arguments relativistes puisqueles habitudes d'action et de pensée contre lesquelles ils s'élevaient, étaient précisément aussi, chez leurscontemporains conformistes, « fonction » des circonstances historiques et du milieu.
Les uns s'imprègnent de ceshabitudes sociales, les autres s'insurgent contre elles ; dans les deux cas le comportement est fonction deshabitudes sociales, mais dans le premier cas il les exprime, dans le second cas il les met en question au nom d'autresprincipes.
D'où viennent donc ces autres principes ?Une des meilleures réponses que l'on puisse faire à cet argument est de dire que précisément de tels individusparaissent immoraux à la conscience collective de leur époque.
Mais d'une part, cette réaction est.
une réactionnormale de défense d'un système d'habitudes devant l'émergence d'une idée nouvelle (il y a toujours une sorted'inertie des habitudes collectives qui fait qu'on « ne comprend pas », et qu'on « n'y croit pas ») ; d'autre part, ilest non moins incontestable que ces idées éveillent d'autres consciences, et trouvent à plus ou moins longueéchéance, des échos et des fidèles.
B — L'identité d'inspiration des revendications contre les normes sociales historiques.
Nous aurons l'occasion derevenir sur ce fait important.
Constatons ici que tous ces « hommes exceptionnels » qui ont rompu avec la forceprégnante et pétrifiante des habitudes sociales d'une époque pour proclamer une idée morale neuve etrévolutionnaire, étaient animés par des soucis, des besoins et des sentiments identiques qui peuvent se résumer enceci : « Davantage de justice et davantage de liberté ».
Socrate devant le tribunal du peuple qui allait le condamneren 399 av.
J.-C.
pour corruption de la jeunesse, Thomas Morus condamné à mort en 1535 par Henri VIII.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Quelles conclusions est-il raisonnable de tirer des variations de la conscience morale? On a souvent souligné que les prescriptions morales varient selon les temps et les lieux. Faut-il en conclure qu'il n'y a pas de vérités morales universelles?
- « La personnalité morale n'est rien d'autre que la liberté d'un être raisonnable sous les lois morales. » Kant, Métaphysique des moeurs, 1797. Commentez.
- Commentez et discutez ces lignes de Baudelaire : «L'art est-il utile? Oui. Pourquoi? Parce qu'il est l'art. Y a-t-il un art pernicieux? Oui. C'est celui qui dérange les conditions de la vie. Le vice est séduisant, il faut le peindre séduisant; mais il traîne avec lui des maladies et des douleurs morales singulières; il faut les décrire. Etudiez toutes les plaies comme un médecin qui fait son service dans un hôpital, et l'école du bon sens, l'école exclusivement morale, ne trouvera plus
- Robespierre: Discours du 18 pluviôse an II (7 février 1794) Sur les principes de morale politique qui doivent guider la Convention dans l'administration intérieure de la République Discours du 18 floréal an II (7 mai 1794) _ Sur les rapports des idées religieuses et morales avec les principes républicains, et sur les fêtes nationales
- Les morales et la Morale