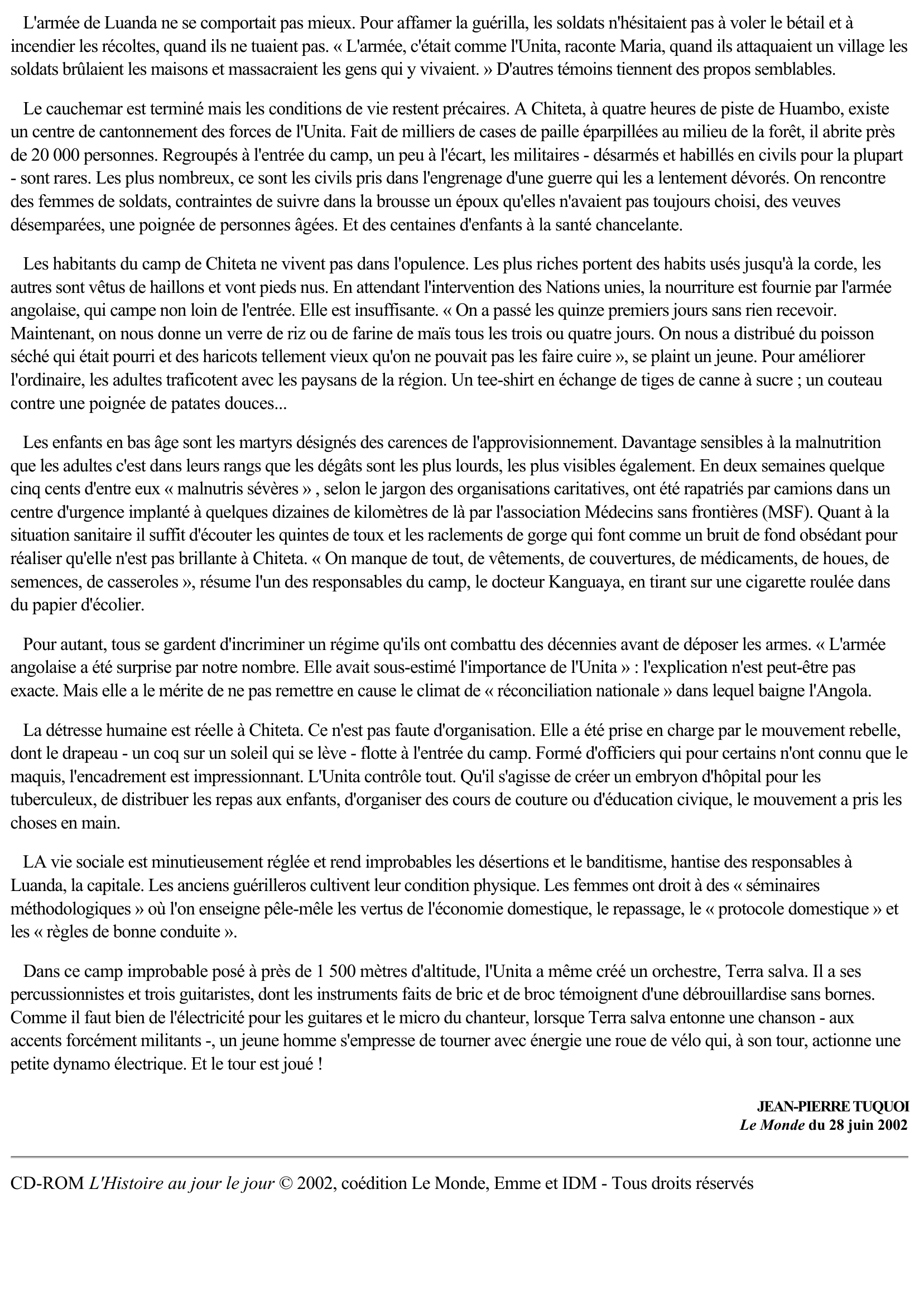Drôle de paix en Angola
Publié le 17/01/2022

Extrait du document
«
L'armée de Luanda ne se comportait pas mieux.
Pour affamer la guérilla, les soldats n'hésitaient pas à voler le bétail et àincendier les récoltes, quand ils ne tuaient pas.
« L'armée, c'était comme l'Unita, raconte Maria, quand ils attaquaient un village lessoldats brûlaient les maisons et massacraient les gens qui y vivaient.
» D'autres témoins tiennent des propos semblables.
Le cauchemar est terminé mais les conditions de vie restent précaires.
A Chiteta, à quatre heures de piste de Huambo, existeun centre de cantonnement des forces de l'Unita.
Fait de milliers de cases de paille éparpillées au milieu de la forêt, il abrite prèsde 20 000 personnes.
Regroupés à l'entrée du camp, un peu à l'écart, les militaires - désarmés et habillés en civils pour la plupart- sont rares.
Les plus nombreux, ce sont les civils pris dans l'engrenage d'une guerre qui les a lentement dévorés.
On rencontredes femmes de soldats, contraintes de suivre dans la brousse un époux qu'elles n'avaient pas toujours choisi, des veuvesdésemparées, une poignée de personnes âgées.
Et des centaines d'enfants à la santé chancelante.
Les habitants du camp de Chiteta ne vivent pas dans l'opulence.
Les plus riches portent des habits usés jusqu'à la corde, lesautres sont vêtus de haillons et vont pieds nus.
En attendant l'intervention des Nations unies, la nourriture est fournie par l'arméeangolaise, qui campe non loin de l'entrée.
Elle est insuffisante.
« On a passé les quinze premiers jours sans rien recevoir.Maintenant, on nous donne un verre de riz ou de farine de maïs tous les trois ou quatre jours.
On nous a distribué du poissonséché qui était pourri et des haricots tellement vieux qu'on ne pouvait pas les faire cuire », se plaint un jeune.
Pour améliorerl'ordinaire, les adultes traficotent avec les paysans de la région.
Un tee-shirt en échange de tiges de canne à sucre ; un couteaucontre une poignée de patates douces...
Les enfants en bas âge sont les martyrs désignés des carences de l'approvisionnement.
Davantage sensibles à la malnutritionque les adultes c'est dans leurs rangs que les dégâts sont les plus lourds, les plus visibles également.
En deux semaines quelquecinq cents d'entre eux « malnutris sévères » , selon le jargon des organisations caritatives, ont été rapatriés par camions dans uncentre d'urgence implanté à quelques dizaines de kilomètres de là par l'association Médecins sans frontières (MSF).
Quant à lasituation sanitaire il suffit d'écouter les quintes de toux et les raclements de gorge qui font comme un bruit de fond obsédant pourréaliser qu'elle n'est pas brillante à Chiteta.
« On manque de tout, de vêtements, de couvertures, de médicaments, de houes, desemences, de casseroles », résume l'un des responsables du camp, le docteur Kanguaya, en tirant sur une cigarette roulée dansdu papier d'écolier.
Pour autant, tous se gardent d'incriminer un régime qu'ils ont combattu des décennies avant de déposer les armes.
« L'arméeangolaise a été surprise par notre nombre.
Elle avait sous-estimé l'importance de l'Unita » : l'explication n'est peut-être pasexacte.
Mais elle a le mérite de ne pas remettre en cause le climat de « réconciliation nationale » dans lequel baigne l'Angola.
La détresse humaine est réelle à Chiteta.
Ce n'est pas faute d'organisation.
Elle a été prise en charge par le mouvement rebelle,dont le drapeau - un coq sur un soleil qui se lève - flotte à l'entrée du camp.
Formé d'officiers qui pour certains n'ont connu que lemaquis, l'encadrement est impressionnant.
L'Unita contrôle tout.
Qu'il s'agisse de créer un embryon d'hôpital pour lestuberculeux, de distribuer les repas aux enfants, d'organiser des cours de couture ou d'éducation civique, le mouvement a pris leschoses en main.
LA vie sociale est minutieusement réglée et rend improbables les désertions et le banditisme, hantise des responsables àLuanda, la capitale.
Les anciens guérilleros cultivent leur condition physique.
Les femmes ont droit à des « séminairesméthodologiques » où l'on enseigne pêle-mêle les vertus de l'économie domestique, le repassage, le « protocole domestique » etles « règles de bonne conduite ».
Dans ce camp improbable posé à près de 1 500 mètres d'altitude, l'Unita a même créé un orchestre, Terra salva.
Il a sespercussionnistes et trois guitaristes, dont les instruments faits de bric et de broc témoignent d'une débrouillardise sans bornes.Comme il faut bien de l'électricité pour les guitares et le micro du chanteur, lorsque Terra salva entonne une chanson - auxaccents forcément militants -, un jeune homme s'empresse de tourner avec énergie une roue de vélo qui, à son tour, actionne unepetite dynamo électrique.
Et le tour est joué !
JEAN-PIERRE TUQUOILe Monde du 28 juin 2002
CD-ROM L'Histoire au jour le jour © 2002, coédition Le Monde, Emme et IDM - Tous droits réservés.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Années 1940 - 1949: De la « drôle de guerre » à la « drôle de paix »
- Israël Palestine Spé HGGSP/ T / Thème 2- Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et modes de résolution / Fiche memo de balisage indispensable
- ONU et paix durable ?
- DANS QUELLE MESURE LA CRÉATION DE L’ONU PERMET-ELLE DE CONSTRUIRE LA PAIX ?
- exposé: conflits et paix en Afrique du XXIe siècle