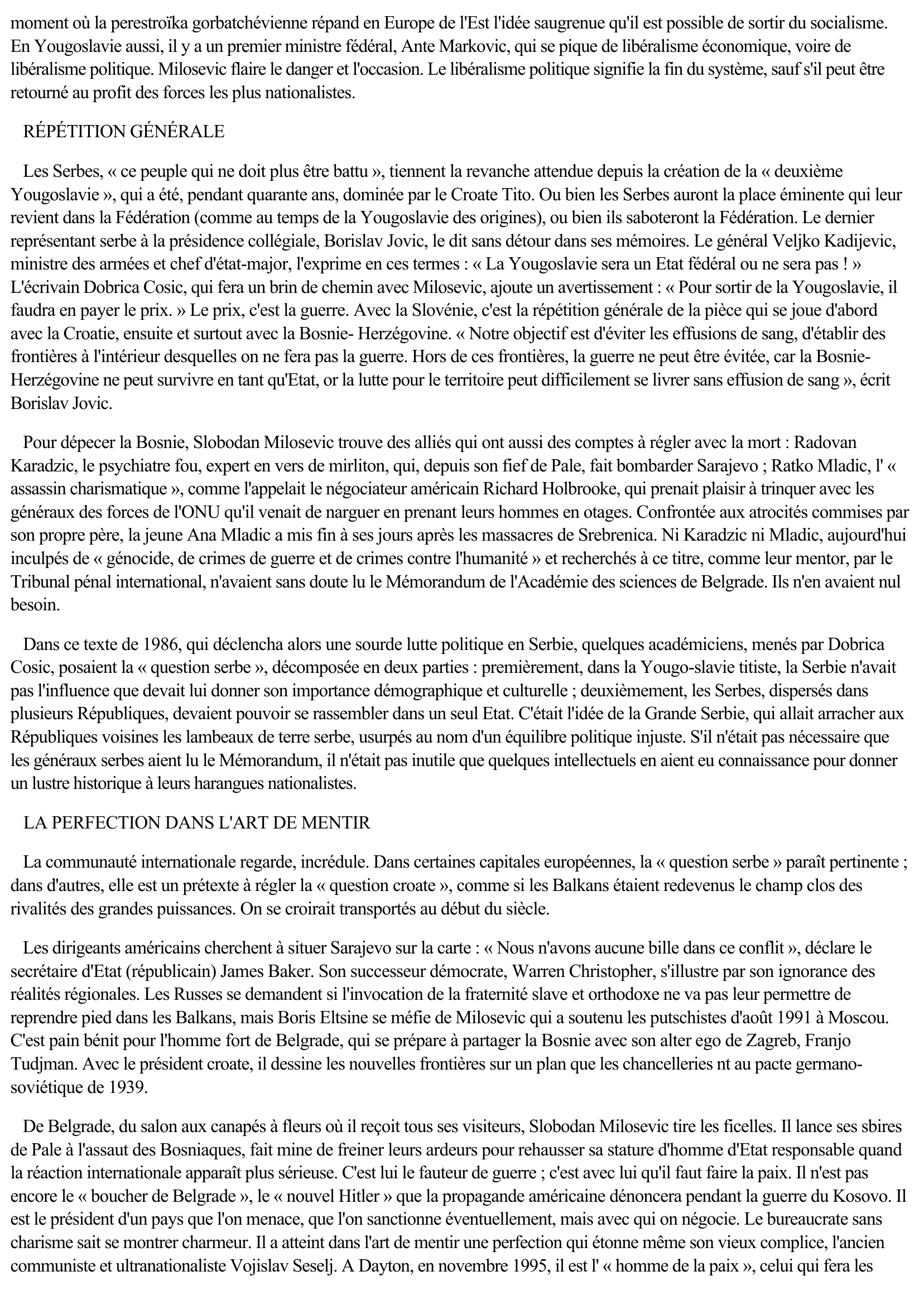Milosevic, l'homme du malheur serbe
Publié le 17/01/2022

Extrait du document
«
moment où la perestroïka gorbatchévienne répand en Europe de l'Est l'idée saugrenue qu'il est possible de sortir du socialisme.En Yougoslavie aussi, il y a un premier ministre fédéral, Ante Markovic, qui se pique de libéralisme économique, voire delibéralisme politique.
Milosevic flaire le danger et l'occasion.
Le libéralisme politique signifie la fin du système, sauf s'il peut êtreretourné au profit des forces les plus nationalistes.
RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Les Serbes, « ce peuple qui ne doit plus être battu », tiennent la revanche attendue depuis la création de la « deuxièmeYougoslavie », qui a été, pendant quarante ans, dominée par le Croate Tito.
Ou bien les Serbes auront la place éminente qui leurrevient dans la Fédération (comme au temps de la Yougoslavie des origines), ou bien ils saboteront la Fédération.
Le dernierreprésentant serbe à la présidence collégiale, Borislav Jovic, le dit sans détour dans ses mémoires.
Le général Veljko Kadijevic,ministre des armées et chef d'état-major, l'exprime en ces termes : « La Yougoslavie sera un Etat fédéral ou ne sera pas ! »L'écrivain Dobrica Cosic, qui fera un brin de chemin avec Milosevic, ajoute un avertissement : « Pour sortir de la Yougoslavie, ilfaudra en payer le prix.
» Le prix, c'est la guerre.
Avec la Slovénie, c'est la répétition générale de la pièce qui se joue d'abordavec la Croatie, ensuite et surtout avec la Bosnie- Herzégovine.
« Notre objectif est d'éviter les effusions de sang, d'établir desfrontières à l'intérieur desquelles on ne fera pas la guerre.
Hors de ces frontières, la guerre ne peut être évitée, car la Bosnie-Herzégovine ne peut survivre en tant qu'Etat, or la lutte pour le territoire peut difficilement se livrer sans effusion de sang », écritBorislav Jovic.
Pour dépecer la Bosnie, Slobodan Milosevic trouve des alliés qui ont aussi des comptes à régler avec la mort : RadovanKaradzic, le psychiatre fou, expert en vers de mirliton, qui, depuis son fief de Pale, fait bombarder Sarajevo ; Ratko Mladic, l' «assassin charismatique », comme l'appelait le négociateur américain Richard Holbrooke, qui prenait plaisir à trinquer avec lesgénéraux des forces de l'ONU qu'il venait de narguer en prenant leurs hommes en otages.
Confrontée aux atrocités commises parson propre père, la jeune Ana Mladic a mis fin à ses jours après les massacres de Srebrenica.
Ni Karadzic ni Mladic, aujourd'huiinculpés de « génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité » et recherchés à ce titre, comme leur mentor, par leTribunal pénal international, n'avaient sans doute lu le Mémorandum de l'Académie des sciences de Belgrade.
Ils n'en avaient nulbesoin.
Dans ce texte de 1986, qui déclencha alors une sourde lutte politique en Serbie, quelques académiciens, menés par DobricaCosic, posaient la « question serbe », décomposée en deux parties : premièrement, dans la Yougo-slavie titiste, la Serbie n'avaitpas l'influence que devait lui donner son importance démographique et culturelle ; deuxièmement, les Serbes, dispersés dansplusieurs Républiques, devaient pouvoir se rassembler dans un seul Etat.
C'était l'idée de la Grande Serbie, qui allait arracher auxRépubliques voisines les lambeaux de terre serbe, usurpés au nom d'un équilibre politique injuste.
S'il n'était pas nécessaire queles généraux serbes aient lu le Mémorandum, il n'était pas inutile que quelques intellectuels en aient eu connaissance pour donnerun lustre historique à leurs harangues nationalistes.
LA PERFECTION DANS L'ART DE MENTIR
La communauté internationale regarde, incrédule.
Dans certaines capitales européennes, la « question serbe » paraît pertinente ;dans d'autres, elle est un prétexte à régler la « question croate », comme si les Balkans étaient redevenus le champ clos desrivalités des grandes puissances.
On se croirait transportés au début du siècle.
Les dirigeants américains cherchent à situer Sarajevo sur la carte : « Nous n'avons aucune bille dans ce conflit », déclare lesecrétaire d'Etat (républicain) James Baker.
Son successeur démocrate, Warren Christopher, s'illustre par son ignorance desréalités régionales.
Les Russes se demandent si l'invocation de la fraternité slave et orthodoxe ne va pas leur permettre dereprendre pied dans les Balkans, mais Boris Eltsine se méfie de Milosevic qui a soutenu les putschistes d'août 1991 à Moscou.C'est pain bénit pour l'homme fort de Belgrade, qui se prépare à partager la Bosnie avec son alter ego de Zagreb, FranjoTudjman.
Avec le président croate, il dessine les nouvelles frontières sur un plan que les chancelleries nt au pacte germano-soviétique de 1939.
De Belgrade, du salon aux canapés à fleurs où il reçoit tous ses visiteurs, Slobodan Milosevic tire les ficelles.
Il lance ses sbiresde Pale à l'assaut des Bosniaques, fait mine de freiner leurs ardeurs pour rehausser sa stature d'homme d'Etat responsable quandla réaction internationale apparaît plus sérieuse.
C'est lui le fauteur de guerre ; c'est avec lui qu'il faut faire la paix.
Il n'est pasencore le « boucher de Belgrade », le « nouvel Hitler » que la propagande américaine dénoncera pendant la guerre du Kosovo.
Ilest le président d'un pays que l'on menace, que l'on sanctionne éventuellement, mais avec qui on négocie.
Le bureaucrate sanscharisme sait se montrer charmeur.
Il a atteint dans l'art de mentir une perfection qui étonne même son vieux complice, l'anciencommuniste et ultranationaliste Vojislav Seselj.
A Dayton, en novembre 1995, il est l' « homme de la paix », celui qui fera les.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Milosevic Slobodan Homme d'Etat serbe
- Dissertation : Le travail fait-il le malheur de l’Homme ?
- La conscience fait-elle le malheur de l'Homme
- La conscience et le malheur de l'homme
- L'imagination fait-elle le malheur de l'homme ?