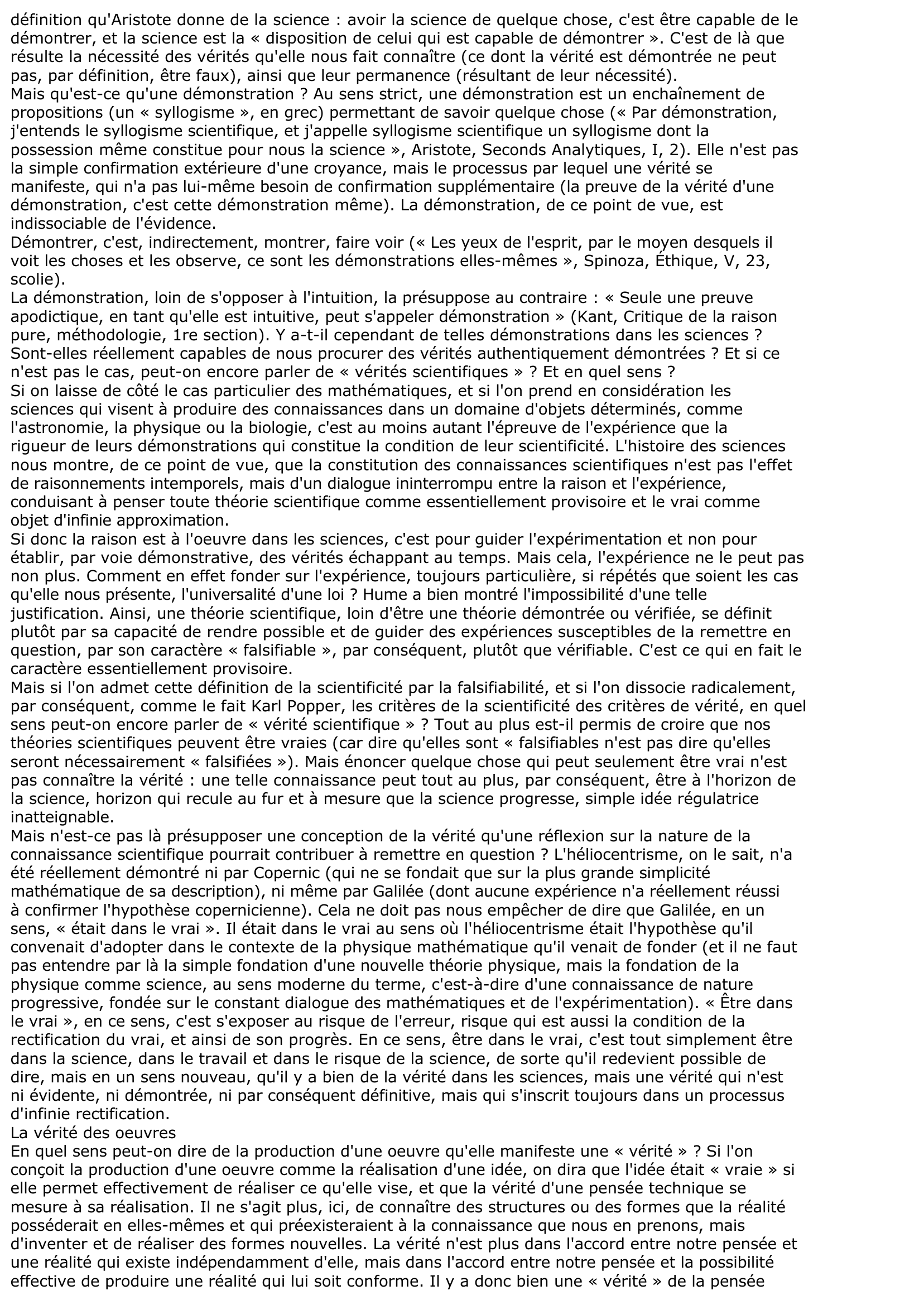Qu'est-ce que la vérité ?
Publié le 17/01/2022

Extrait du document
On peut entendre par là, selon les cas, la conformité de la pensée avec la réalité (« connaître la
vérité «), la conformité de nos paroles avec nos pensées (« dire la vérité «), ou encore la conformité
d'une chose à l'apparence qu'elle nous donne (« de l'or véritable «). Dans tous les cas, la vérité ne
doit pas être confondue avec la réalité. Elle n'est pas une chose, mais une relation : relation de
conformité ou d'accord entre nos pensées, nos paroles et la réalité. On peut, si l'on veut, parler plutôt
de « véracité «, pour désigner l'accord de nos paroles avec nos pensées (le contraire du mensonge),
et réserver le terme de « vérité « à l'accord de nos pensées avec la réalité (le contraire de l'erreur).
Dans ce dernier cas, la « vérité « est essentiellement une propriété de nos jugements (ou des
énoncés qui les formulent), et non une qualité des choses elles-mêmes (le cas de l'or « véritable «
n'est qu'une exception apparente : la fausseté n'est pas dans la chose, mais dans le jugement que
nous portons sur elle).
Lorsque l'on demande, en effet, « Qu'est-ce que la vérité ? «, on veut plutôt savoir ce qui permet de la
reconnaître ou de l'identifier comme telle : on cherche alors un « critère « de la vérité. Mais comment
ne pas tomber alors dans un cercle vicieux ? Comment reconnaître la vérité d'un critère de vérité, si
l'on ne dispose pas déjà de lui ? Et comment pourrait-il y avoir un critère universel de vérité,
abstraction faite de son objet, si la vérité consiste justement dans l'accord d'une connaissance avec
son objet, et ne doit donc pas en faire abstraction ? Le seul critère universel, purement formel, est la
non-contradiction, mais ce n'est qu'une condition nécessaire, et non suffisante, de la vérité. De là au
scepticisme, le pas est vite franchi, et d'autant plus aisément que la prétention à détenir la vérité peut
sembler une marque d'intolérance.
Mais peut-on si facilement renoncer à la vérité, et se contenter d'être sceptique ou relativiste ?
Si croire détenir la vérité peut être l'expression d'une attitude dogmatique, fermée au dialogue, et
pouvant conduire au fanatisme, la vérité est aussi un idéal qui anime la recherche philosophique ou
scientifique et possède une vertu critique indéniable6. Mais la vérité n'est pas seulement un idéal de
philosophe ou de savant : elle se manifeste à nous, parfois, lors d'expériences, comme celle de la
désillusion, qui nous font prendre conscience d'un mensonge ou d'une imposture, ou qui nous
révèlent des aspects de nous-mêmes qui nous étaient inconnus. Quel sens et quelle valeur faut-il
accorder à ces expériences de la vérité ? Faut-il en faire des figures de la vérité moins « vraies « que
celle à laquelle la science prétend nous faire accéder ?7 Faut-il au contraire distinguer plusieurs
formes irréductibles de « vérité «, correspondant aux différentes modalités de notre rapport au réel ?
Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, distingue cinq manières d'accéder à la vérité : « Les états par
lesquels l'âme énonce ce qui est vrai sous une forme affirmative ou négative sont au nombre de cinq :
ce sont l'art, la science, la prudence, la sagesse et la raison intuitive, car par le jugement et l'opinion, il
peut arriver que nous soyons induits en erreur «8. Remarquons tout d'abord que l'opinion est exclue
du domaine de la vérité proprement dite : elle peut sans doute être parfois vraie, mais peut aussi nous
tromper. Or, je ne peux me dire en possession d'une vérité, tant que l'erreur est possible. On peut,
sans doute, « dire vrai « sans le savoir, mais on ne peut dire alors que l'on « sait la vérité «. Mais, et
c'est ce qu'il faut remarquer ensuite, le savoir ne se réduit pas à la science, et c'est ce qui permet de
comprendre que la science ne soit, pour Aristote, que l'une des cinq formes de manifestation de la
vérité qu'il distingue.
Enfin, ces cinq formes de vérités peuvent se réduire à trois types de savoir9 : le savoir théorique, qui
vise la connaissance désintéressée de vérités qui échappent au temps et à la contingence (qui inclut
la « science « proprement dite, mais aussi la « raison intuitive « et la « sagesse «), le savoir-faire de
celui qui est capable de produire une oeuvre de manière réglée (le savoir que possède celui qui
maîtrise un art ou une technique), et le « savoir «, enfin, susceptible d'orienter notre action dans le
domaine éthique et politique en vue d'une vie humainement accomplie (en vue du « bonheur «). À ces
trois types de savoir et aux formes de « vérités « qui leur sont associées, correspondent trois types de
« réalités « spécifiquement différentes (la réalité de nos rapports à nous-mêmes et à autrui dans la vie
éthique et politique ; la réalité du monde des oeuvres que nous sommes capables de produire par
l'art et la technique ; la réalité de ce que nous sommes capables de connaître par la science), trois
formes de rationalité qu'il ne faut pas confondre (rationalité de l'action, de la production et de la
connaissance), et ainsi trois modalités du rapport de la raison et du réel. Nous prendrons cette
distinction comme fil conducteur, pour interroger, dans chacun de ces trois rapports, le sens et les
limites des prétentions à la vérité qu'ils impliquent.
La vérité scientifique
Lorsque l'on parle de « vérité scientifique «, on entend généralement par là une vérité possédant un
caractère de permanence, d'universalité et de nécessité (qui distingue un théorème de géométrie ou
une loi de physique d'un énoncé comme : « il pleut «). Comme seul ce qui est démontrable semble
pouvoir présenter ces caractères, on dira qu'une vérité scientifique est une vérité démontrée. C'est la
définition qu'Aristote donne de la science : avoir la science de quelque chose, c'est être capable de le
démontrer, et la science est la « disposition de celui qui est capable de démontrer «. C'est de là que
résulte la nécessité des vérités qu'elle nous fait connaître (ce dont la vérité est démontrée ne peut
pas, par définition, être faux), ainsi que leur permanence (résultant de leur nécessité).
Mais qu'est-ce qu'une démonstration ? Au sens strict, une démonstration est un enchaînement de
propositions (un « syllogisme «, en grec) permettant de savoir quelque chose (« Par démonstration,
j'entends le syllogisme scientifique, et j'appelle syllogisme scientifique un syllogisme dont la
possession même constitue pour nous la science «, Aristote, Seconds Analytiques, I, 2). Elle n'est pas
la simple confirmation extérieure d'une croyance, mais le processus par lequel une vérité se
manifeste, qui n'a pas lui-même besoin de confirmation supplémentaire (la preuve de la vérité d'une
démonstration, c'est cette démonstration même). La démonstration, de ce point de vue, est
indissociable de l'évidence.
Démontrer, c'est, indirectement, montrer, faire voir (« Les yeux de l'esprit, par le moyen desquels il
voit les choses et les observe, ce sont les démonstrations elles-mêmes «, Spinoza, Éthique, V, 23,
scolie).
La démonstration, loin de s'opposer à l'intuition, la présuppose au contraire : « Seule une preuve
apodictique, en tant qu'elle est intuitive, peut s'appeler démonstration « (Kant, Critique de la raison
pure, méthodologie, 1re section). Y a-t-il cependant de telles démonstrations dans les sciences ?
Sont-elles réellement capables de nous procurer des vérités authentiquement démontrées ? Et si ce
n'est pas le cas, peut-on encore parler de « vérités scientifiques « ? Et en quel sens ?
Si on laisse de côté le cas particulier des mathématiques, et si l'on prend en considération les
sciences qui visent à produire des connaissances dans un domaine d'objets déterminés, comme
l'astronomie, la physique ou la biologie, c'est au moins autant l'épreuve de l'expérience que la
rigueur de leurs démonstrations qui constitue la condition de leur scientificité. L'histoire des sciences
nous montre, de ce point de vue, que la constitution des connaissances scientifiques n'est pas l'effet
de raisonnements intemporels, mais d'un dialogue ininterrompu entre la raison et l'expérience,
conduisant à penser toute théorie scientifique comme essentiellement provisoire et le vrai comme
objet d'infinie approximation.
Si donc la raison est à l'oeuvre dans les sciences, c'est pour guider l'expérimentation et non pour
établir, par voie démonstrative, des vérités échappant au temps. Mais cela, l'expérience ne le peut pas
non plus. Comment en effet fonder sur l'expérience, toujours particulière, si répétés que soient les cas
qu'elle nous présente, l'universalité d'une loi ? Hume a bien montré l'impossibilité d'une telle
justification. Ainsi, une théorie scientifique, loin d'être une théorie démontrée ou vérifiée, se définit
plutôt par sa capacité de rendre possible et de guider des expériences susceptibles de la remettre en
question, par son caractère « falsifiable «, par conséquent, plutôt que vérifiable. C'est ce qui en fait le
caractère essentiellement provisoire.
Mais si l'on admet cette définition de la scientificité par la falsifiabilité, et si l'on dissocie radicalement,
par conséquent, comme le fait Karl Popper, les critères de la scientificité des critères de vérité, en quel
sens peut-on encore parler de « vérité scientifique « ? Tout au plus est-il permis de croire que nos
théories scientifiques peuvent être vraies (car dire qu'elles sont « falsifiables n'est pas dire qu'elles
seront nécessairement « falsifiées «). Mais énoncer quelque chose qui peut seulement être vrai n'est
pas connaître la vérité : une telle connaissance peut tout au plus, par conséquent, être à l'horizon de
la science, horizon qui recule au fur et à mesure que la science progresse, simple idée régulatrice
inatteignable.
Mais n'est-ce pas là présupposer une conception de la vérité qu'une réflexion sur la nature de la
connaissance scientifique pourrait contribuer à remettre en question ? L'héliocentrisme, on le sait, n'a
été réellement démontré ni par Copernic (qui ne se fondait que sur la plus grande simplicité
mathématique de sa description), ni même par Galilée (dont aucune expérience n'a réellement réussi
à confirmer l'hypothèse copernicienne). Cela ne doit pas nous empêcher de dire que Galilée, en un
sens, « était dans le vrai «. Il était dans le vrai au sens où l'héliocentrisme était l'hypothèse qu'il
convenait d'adopter dans le contexte de la physique mathématique qu'il venait de fonder (et il ne faut
pas entendre par là la simple fondation d'une nouvelle théorie physique, mais la fondation de la
physique comme science, au sens moderne du terme, c'est-à-dire d'une connaissance de nature
progressive, fondée sur le constant dialogue des mathématiques et de l'expérimentation). « Être dans
le vrai «, en ce sens, c'est s'exposer au risque de l'erreur, risque qui est aussi la condition de la
rectification du vrai, et ainsi de son progrès. En ce sens, être dans le vrai, c'est tout simplement être
dans la science, dans le travail et dans le risque de la science, de sorte qu'il redevient possible de
dire, mais en un sens nouveau, qu'il y a bien de la vérité dans les sciences, mais une vérité qui n'est
ni évidente, ni démontrée, ni par conséquent définitive, mais qui s'inscrit toujours dans un processus
d'infinie rectification.
La vérité des oeuvres
En quel sens peut-on dire de la production d'une oeuvre qu'elle manifeste une « vérité « ? Si l'on
conçoit la production d'une oeuvre comme la réalisation d'une idée, on dira que l'idée était « vraie « si
elle permet effectivement de réaliser ce qu'elle vise, et que la vérité d'une pensée technique se
mesure à sa réalisation. Il ne s'agit plus, ici, de connaître des structures ou des formes que la réalité
posséderait en elles-mêmes et qui préexisteraient à la connaissance que nous en prenons, mais
d'inventer et de réaliser des formes nouvelles. La vérité n'est plus dans l'accord entre notre pensée et
une réalité qui existe indépendamment d'elle, mais dans l'accord entre notre pensée et la possibilité
effective de produire une réalité qui lui soit conforme. Il y a donc bien une « vérité « de la pensée
technique, irréductible à celle que vise la pensée scientifique.
Mais peut-on réduire la production d'une oeuvre à la simple réalisation d'une idée, et ne concevoir la
vérité qu'elle peut comporter que comme une simple conformité entre l'oeuvre et l'idée qui en dirige
l'exécution ? Dans le Système des Beaux-Arts, Alain distingue l'artiste de l'artisan en ce que l'idée,
chez l'artiste, ne précède pas l'exécution, mais la suit : « Toutes les fois que l'idée précède et règle
l'exécution, c'est industrie. « : c'est ce qu'une machine bien réglée pourrait faire à mille exemplaires…
Le propre de l'artiste, par contre, si la création n'est pas un vain mot et ne se confond pas avec la
simple application mécanique d'une règle, est de découvrir son oeuvre en la faisant : « Pensons
maintenant au travail du peintre de portrait ; il est clair qu'il ne peut avoir le projet de toutes les
couleurs qu'il emploiera à l'oeuvre qu'il commence ; l'idée lui vient à mesure qu'il fait ; il serait même
rigoureux de dire que l'idée lui vient ensuite, comme au spectateur, et qu'il est spectateur aussi de son
oeuvre en train de naître. Et c'est là le propre de l'artiste. « C'est ce qui distingue le génie du talent : le
génie a la grâce de la nature et « s'étonne lui-même « (Alain), il est « la disposition innée de l'esprit
par laquelle la nature donne la règle à l'art « (Kant, Critique de la faculté de juger, § 46). De même
que le jugement esthétique ne consiste pas à identifier un objet à l'aide d'un concept (jugement de
connaissance), ni à comparer le but visé par l'artiste au résultat obtenu, afin de mesurer l'écart qui
pourrait les séparer (jugement de perfection), de même la création artistique n'est pas la réalisation
d'un projet préalablement conçu par l'esprit : « Un beau vers n'est pas d'abord en projet, et ensuite fait
; mais il se montre beau au poète ; et la belle statue se montre belle au sculpteur, à mesure qu'il la fait
; et le portrait naît sous le pinceau «. Et si le génie « donne la règle à l'art « (Kant), cette « règle « ne
précède pas l'oeuvre et en est inséparable. C'est le génie lui-même, ou mieux, son oeuvre, qui sont la
règle de l'art, la seule règle dans l'art : « Le génie ne se connaît que dans l'oeuvre peinte, écrite ou
chantée. Ainsi la règle du beau n'apparaît que dans l'oeuvre, et y reste prise, en sorte qu'elle ne peut
servir jamais, d'aucune manière, à faire une autre oeuvre. «.
En quel sens peut-on, dans ces conditions, parler de la « vérité « d'une oeuvre ? Comment parler de
vérité là où il n'y a plus de distinction et, par conséquent de comparaison possible, de conformité ou
de non-conformité, entre un concept et son objet ? L'Idée esthétique ne peut jamais être saisie
abstraitement, ou séparément de l'oeuvre singulière qui la manifeste, et l'on ne peut donc pas
confronter l'oeuvre et l'idée pour en déterminer l'adéquation et décider par là de la « vérité « de
l'oeuvre. Mais la vérité ne peut-elle être définie qu'en termes d'adéquation entre un concept et son
objet ? Dans la pensée grecque antique, la « vérité « ne s'oppose pas primitivement à l'erreur, mais à
l'oubli : le terme grec que nous traduisons par « vérité «, alètheia, signifie d'abord ce qui est arraché à
l'oubli (lèthè), ce qui devient ou redevient présent. Or, chaque oeuvre d'art singulière nous met en
présence d'un monde, sans que cela dépende de la contingence de nos réactions personnelles
(comme c'est le cas pour ce qui nous est simplement agréable), mais par la mobilisation de toutes nos
facultés dans un « libre jeu « dont nous sommes fondés à croire que chacun doit pouvoir en être
capable. Une telle communicabilité universelle est sans doute différente de celle que la connaissance
scientifique permet, et l'on peut, si l'on veut, dire qu'il ne s'agit pas d'une « connaissance «, en ce
sens (au sens ou toute connaissance devrait avoir un caractère « objectif «). Mais si l'on admet que
tout ce qui nous est rendu présent de telle sorte que chacun doit pouvoir s'y accorder constitue une
réelle expérience de la vérité, il faut alors conclure que l'expérience esthétique est bien une
expérience de la vérité, et que le domaine de la vérité ne se réduit pas à celui de la connaissance
scientifique.
La vérité pratique
De même que l'on oppose parfois l'objectivité des faits à la subjectivité et à la relativité des
interprétations que l'on en donne, de même et à plus forte raison les jugements de valeur peuvent-ils
sembler dénués de toute vérité objective, par rapport aux jugements que nous portons sur des faits.
C'est ainsi que Hume montre l'impossibilité de fonder les distinctions morales (entre le bien et le mal)
sur la raison, et, par là, l'impossibilité d'en considérer l'objet comme vrai ou faux41. Il est impossible,
en effet, de fonder le devoir sur la réalité (et donc de lui accorder une valeur de « vérité «, si l'on
admet que la vérité ne peut être conçue que comme un accord avec la réalité), et Hume dénonce la
confusion sur laquelle repose un tel projet de fondation rationnelle de la morale : « Dans chacun des
systèmes de moralité que j'ai jusqu'ici rencontrés, j'ai toujours remarqué que l'auteur procède pendant
un certain temps selon la manière ordinaire de raisonner, établit l'existence de Dieu ou fait des
observations sur les affaires humaines, quand tout à coup j'ai la surprise de constater qu'au lieu des
copules habituelles, est ou n'est pas, je ne rencontre pas de proposition qui ne soit liée par un doit ou
ne doit pas. C'est un changement imperceptible, mais il est néanmoins de la plus grande importance.
Car puisque ce doit ou ce ne doit pas expriment une certaine relation ou affirmation nouvelle, il est
nécessaire qu'elle soit soulignée ou expliquée, et qu'en même temps soit donnée une raison de ce qui
semble tout à fait inconcevable, à savoir, de quelle manière cette relation nouvelle peut être déduite
d'autres relations qui en diffèrent du tout au tout. Mais comme les auteurs ne prennent habituellement
pas cette précaution, je me permettrai de la recommander aux lecteurs et je suis convaincu que cette
petite attention renversera tous les systèmes courants de moralité et nous fera voir que la distinction
du vice et de la vertu n'est pas fondée sur les seules relations entre objets et qu'elle n'est pas perçue
par la raison «. Cette impossibilité de fonder ce qui doit être sur ce qui est, et de parler de « vérités «
morales, ne signifie pas pour autant que toute morale est relative et qu'il n'y a aucun principe moral
universel. Cela signifie seulement que la morale ne peut se fonder que sur un sentiment, mais il peut
1
bien y avoir des sentiments désintéressés qui unissent tous les hommes plus qu'ils ne les opposent,
et ce sont ces sentiments qui peuvent avoir un caractère moral : « La notion de morale implique un
sentiment, commun à tous les hommes, qui recommande le même objet à l'approbation générale et
fait que tous les hommes, ou la plupart d'entre eux, se rejoignent dans la même opinion ou dans la
même décision à ce sujet «.
Mais on peut se demander si cette exclusion de toute « vérité « en matière morale ne repose pas sur
une conception trop étroite de la raison et de la vérité. Faut-il, tout d'abord, limiter l'usage de la
raison au domaine de la connaissance ? Si l'exigence de rationalité est d'abord une exigence de
cohérence et de non contradiction, elle peut s'appliquer à nos actions aussi bien qu'à nos jugements :
nous pouvons être incohérents dans notre conduite, comme nous pouvons l'être dans nos croyances.
Lorsque par exemple nous nous permettons de faire à autrui ce que nous n'accepterions pas qu'autrui
nous fasse, lorsque nous agissons immoralement : « Si maintenant nous faisons attention à nous-mêmes.
dans tous les cas où nous violons un devoir, nous trouvons que nous ne voulons pas
réellement que notre maxime devienne une loi universelle, car cela nous est impossible ; c'est bien
plutôt la maxime opposée qui doit rester universellement une loi ; seulement nous prenons la liberté
d'y faire une exception pour nous, ou (seulement pour cette fois) en faveur de notre inclination. En
conséquence, si nous considérions tout d'un seul et même point de vue, à savoir du point de vue de la
raison, nous trouverions une contradiction dans notre volonté propre en ce sens que nous voulons
qu'un certain principe soit nécessaire objectivement comme loi universelle, et que néanmoins il n'ait
pas une valeur universelle subjectivement, et qu'il souffre des exceptions. « Faut-il ensuite exclure la
vérité du domaine des sentiments ? À supposer même, en effet, que Hume ait raison de vouloir fonder
la morale sur le sentiment plutôt que sur la raison, il n'en résulterait pas qu'il n'y aurait aucune vérité
possible en matière morale. Dans sa correspondance avec la princesse Elisabeth, Descartes
distingue « trois genres d'idées ou de notions primitives qui se connaissent chacune de façon
particulière « : nous ne pouvons pas en effet nous connaître nous-mêmes, en tant qu'êtres pensants,
de la même manière que nous connaissons les corps extérieurs (dotés d'une extension spatiale), ni
de la même manière que nous nous connaissons comme unis à notre corps, corps dont nous avons le
sentiment qu'il ne fait qu'un avec nous. Cette dernière connaissance ne nous est procurée ni par la
science, ni par la méditation, mais par la « vie « : et le sentiment vécu de ne faire qu'un avec notre
corps a autant de vérité que la connaissance intellectuelle que nous prenons de notre âme comme «
réellement distincte « de notre corps, quand nous méditons. Or, ce domaine de « l'union de l'âme et
du corps « est aussi bien celui de la morale que celui des passions : « Pour l'âme et le corps
ensemble, nous n'avons que [la notion primitive] de leur union, de laquelle dépend celle de la force
qu'a l'âme de mouvoir le corps, et le corps d'agir sur l'âme en causant ses sentiments et ses passions.
« Si donc il est permis de parler de vérités morales aussi bien que de vérités scientifiques, quelle est
la nature de ces vérités d'ordre pratique ? Lorsque Aristote distingue, dans le livre E de la
Métaphysique, le savoir théorique du savoir pratique, il ne faut pas entendre par « savoir pratique « un
savoir au sujet de la pratique (un savoir théorique ayant la pratique pour objet), mais un savoir qui
oriente et guide l'action tout en étant inséparable d'elle. Le vrai courage, par exemple, à la différence
d'une témérité irréfléchie et aveugle, est inséparable d'une intelligence des situations qui permet de
savoir quand il convient d'agir et quand il faut s'en abstenir. Mais ce courage et la forme d'intelligence
qui lui correspond ne peuvent s'acquérir que par la pratique même du courage et l'expérience. De
sorte que le savoir moral n'est pas non plus un savoir séparable de l'être qui le possède, mais au
contraire un savoir déterminé à partir de lui et déterminant pour lui : déterminant pour lui dans la
mesure où il est impliqué par ce qu'il connaît (c'est quelque chose qu'il a à faire) ; déterminé à partir
de lui parce que pour être en état de le comprendre intellectuellement, il faut déjà avoir développé en
soi-même, par l'exercice et l'éducation, une attitude qu'il faut constamment maintenir et confirmer par
un comportement juste dans les situations concrètes de la vie. Les vérités d'ordre pratique sont ainsi
inséparables du sujet connaissant et des transformations de soi qu'il est capable d'opérer pour
pouvoir y accéder, et ne peuvent faire l'objet, à la différence des connaissances scientifiques, d'une
démonstration ou d'une communication purement théoriques.
Questions sur la vérité.
1) Si la prétention à détenir la vérité mène souvent à l'intolérance, peut-on facilement
renoncer à la vérité, et se contenter d'être sceptique ou relativiste ?
On en peut pas renoncer facilement à la vérité, car il arrive qu'elle se présente à nous dans la réalité, lorsque nous nous rendons compte que nous sommes dans l'erreur.
En fait, on peut renoncer à la vérité au sens vérité scientifique, mais pas au sens vérité qui s'acquiert par certains critères que l'on adapte à notre réalité présente, car alors on s'y trouve toujours confronté.
2) La vérité est-elle un idéal ou une construction effectuée par une suite
d'expérimentations ?
La vérité peut être un idéal sans cesse poursuivi, mais cela peut rejoindre une constructions à partir d'expérimentations. Quelque soit la définition de vérité que l'on accepte, elle n'est ni innée ni évidente : un travail et un effort sont nécessaires pour y accéder. Si on prend expérimentations au sens stricte du travail matériel, ce serait trop restrictif et donc erroné.
3) Comment définir la vérité scientifique ?
Si on définit la vérité scientifique comme une vérité intemporelle et nécessaire, obtenue par démonstration, on se rend compte que bien des limites rendent impossible la réalisation de telles vérités. Il semble que pour faire cohabiter vérité et science, il soit nécessaire de prendre dans les sciences des idées et des résultats qui acceptent le risque de l'erreur et la remise en question future. Une vérité scientifique est dans une optique d'infinie rectification, de progrès et s'affranchie de la démonstration et de l'évidence.
4) Qu'est-ce qui distingue la démonstration de l'intuition ?
Les deux termes sont proches et non réellement opposables car ils visent tous deux la vérité. Cependant, alors que l'intuition va s'obtenir spontanément, par l'influence d'expériences antérieures et de connaissances, ou simplement par l'évidence ou la clarté d'une situation, la démonstration est elle un cheminement basé sur des raisonnements logiques qui ne prennent pas en considération les critères de vérité non scientifiques.
5) En quoi la vérité peut-elle être définie par la falsifiabilité (K.Popper) ? Qu'est-ce que
cela veut dire ?
La vérité, au sens vérité scientifique, sera définie par sa falsifiabilité dans son caractère provisoire. Une théorie qui va guider les expériences futures susceptibles de la remettre en question va ainsi chercher à atteindre la vérité non pas en se vérifiant, mais au contraire en se modifiant, en montrant éventuellement son caractère falsifié.
6) En quel sens peut-on parler de « vérité d'une oeuvre d'art « ?
Il faut voir dans l'oeuvre la possibilité d'(une communication universelle, qui nous met en présence d'un monde autour duquel chacun, sans connaissance au niveau scientifique, peut s'accorder. C'est en ça que l'expérience esthétique devient une expérience de réalité.
7) Faut-il exclure toute vérité en matière morale ?
Vérité et morale ne peuvent s'unir que lorsque des sentiments désintéressé qui unissent plus les homme qu'ils ne les opposent, ont un caractère moral. C'est de la que peut venir la morale dite universelle et se rapprocher de la vérité supposée morale.
8) Faut-il limiter l'usage de la raison au domaine de la connaissance ?
Si on considère que la connaissance n'est pas seulement la connaissance logique et scientifique, mais aussi celle qui unie les hommes et les mène vers différents niveaux de réalité, alors oui cela englobe toute la raison. La raison se limite alors aux limites de la connaissance, puisqu'au delà, dans la métaphysique par exemple, on accède à un autre degré qui n'est plus la connaissance, mais plus al supposition, la suggestion subjective.
9) Quel est le sens d'une vérité pratique ?
Une vérité pratique est indissociable du sujet qui la connaît et des transformations de lui même qu'il va opérer pour accéder à cette vérité. Elle ne s'obtient ni par la théorie, ni par la connaissance scientifique ou la démonstration.
«
définition qu'Aristote donne de la science : avoir la science de quelque chose, c'est être capable de ledémontrer, et la science est la « disposition de celui qui est capable de démontrer ».
C'est de là querésulte la nécessité des vérités qu'elle nous fait connaître (ce dont la vérité est démontrée ne peutpas, par définition, être faux), ainsi que leur permanence (résultant de leur nécessité).Mais qu'est-ce qu'une démonstration ? Au sens strict, une démonstration est un enchaînement depropositions (un « syllogisme », en grec) permettant de savoir quelque chose (« Par démonstration,j'entends le syllogisme scientifique, et j'appelle syllogisme scientifique un syllogisme dont lapossession même constitue pour nous la science », Aristote, Seconds Analytiques, I, 2).
Elle n'est pasla simple confirmation extérieure d'une croyance, mais le processus par lequel une vérité semanifeste, qui n'a pas lui-même besoin de confirmation supplémentaire (la preuve de la vérité d'unedémonstration, c'est cette démonstration même).
La démonstration, de ce point de vue, estindissociable de l'évidence.Démontrer, c'est, indirectement, montrer, faire voir (« Les yeux de l'esprit, par le moyen desquels ilvoit les choses et les observe, ce sont les démonstrations elles-mêmes », Spinoza, Éthique, V, 23,scolie).La démonstration, loin de s'opposer à l'intuition, la présuppose au contraire : « Seule une preuveapodictique, en tant qu'elle est intuitive, peut s'appeler démonstration » (Kant, Critique de la raisonpure, méthodologie, 1re section).
Y a-t-il cependant de telles démonstrations dans les sciences ?Sont-elles réellement capables de nous procurer des vérités authentiquement démontrées ? Et si cen'est pas le cas, peut-on encore parler de « vérités scientifiques » ? Et en quel sens ?Si on laisse de côté le cas particulier des mathématiques, et si l'on prend en considération lessciences qui visent à produire des connaissances dans un domaine d'objets déterminés, commel'astronomie, la physique ou la biologie, c'est au moins autant l'épreuve de l'expérience que larigueur de leurs démonstrations qui constitue la condition de leur scientificité.
L'histoire des sciencesnous montre, de ce point de vue, que la constitution des connaissances scientifiques n'est pas l'effetde raisonnements intemporels, mais d'un dialogue ininterrompu entre la raison et l'expérience,conduisant à penser toute théorie scientifique comme essentiellement provisoire et le vrai commeobjet d'infinie approximation.Si donc la raison est à l'oeuvre dans les sciences, c'est pour guider l'expérimentation et non pourétablir, par voie démonstrative, des vérités échappant au temps.
Mais cela, l'expérience ne le peut pasnon plus.
Comment en effet fonder sur l'expérience, toujours particulière, si répétés que soient les casqu'elle nous présente, l'universalité d'une loi ? Hume a bien montré l'impossibilité d'une tellejustification.
Ainsi, une théorie scientifique, loin d'être une théorie démontrée ou vérifiée, se définitplutôt par sa capacité de rendre possible et de guider des expériences susceptibles de la remettre enquestion, par son caractère « falsifiable », par conséquent, plutôt que vérifiable.
C'est ce qui en fait lecaractère essentiellement provisoire.Mais si l'on admet cette définition de la scientificité par la falsifiabilité, et si l'on dissocie radicalement,par conséquent, comme le fait Karl Popper, les critères de la scientificité des critères de vérité, en quelsens peut-on encore parler de « vérité scientifique » ? Tout au plus est-il permis de croire que nosthéories scientifiques peuvent être vraies (car dire qu'elles sont « falsifiables n'est pas dire qu'ellesseront nécessairement « falsifiées »).
Mais énoncer quelque chose qui peut seulement être vrai n'estpas connaître la vérité : une telle connaissance peut tout au plus, par conséquent, être à l'horizon dela science, horizon qui recule au fur et à mesure que la science progresse, simple idée régulatriceinatteignable.Mais n'est-ce pas là présupposer une conception de la vérité qu'une réflexion sur la nature de laconnaissance scientifique pourrait contribuer à remettre en question ? L'héliocentrisme, on le sait, n'aété réellement démontré ni par Copernic (qui ne se fondait que sur la plus grande simplicitémathématique de sa description), ni même par Galilée (dont aucune expérience n'a réellement réussià confirmer l'hypothèse copernicienne).
Cela ne doit pas nous empêcher de dire que Galilée, en unsens, « était dans le vrai ».
Il était dans le vrai au sens où l'héliocentrisme était l'hypothèse qu'ilconvenait d'adopter dans le contexte de la physique mathématique qu'il venait de fonder (et il ne fautpas entendre par là la simple fondation d'une nouvelle théorie physique, mais la fondation de laphysique comme science, au sens moderne du terme, c'est-à-dire d'une connaissance de natureprogressive, fondée sur le constant dialogue des mathématiques et de l'expérimentation).
« Être dansle vrai », en ce sens, c'est s'exposer au risque de l'erreur, risque qui est aussi la condition de larectification du vrai, et ainsi de son progrès.
En ce sens, être dans le vrai, c'est tout simplement êtredans la science, dans le travail et dans le risque de la science, de sorte qu'il redevient possible dedire, mais en un sens nouveau, qu'il y a bien de la vérité dans les sciences, mais une vérité qui n'estni évidente, ni démontrée, ni par conséquent définitive, mais qui s'inscrit toujours dans un processusd'infinie rectification.La vérité des oeuvresEn quel sens peut-on dire de la production d'une oeuvre qu'elle manifeste une « vérité » ? Si l'onconçoit la production d'une oeuvre comme la réalisation d'une idée, on dira que l'idée était « vraie » sielle permet effectivement de réaliser ce qu'elle vise, et que la vérité d'une pensée technique semesure à sa réalisation.
Il ne s'agit plus, ici, de connaître des structures ou des formes que la réalitéposséderait en elles-mêmes et qui préexisteraient à la connaissance que nous en prenons, maisd'inventer et de réaliser des formes nouvelles.
La vérité n'est plus dans l'accord entre notre pensée etune réalité qui existe indépendamment d'elle, mais dans l'accord entre notre pensée et la possibilitéeffective de produire une réalité qui lui soit conforme.
Il y a donc bien une « vérité » de la pensée.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- [De la vérité universelle de l'art]
- Il n'y a ni erreur ni vérité
- vérité - cours de philo
- Toute vérité est elle démontrable?
- Avons-nous le devoir de chercher la vérité ?