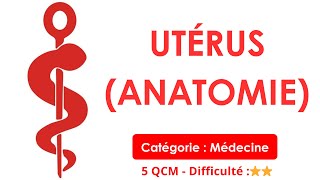TEXTE: Règles pour la direction de l'esprit, Règle douzième. DESCARTES
Publié le 22/02/2012

Extrait du document

de même qu'en géométrie vous faites sur une quantité des suppositions qui n'ébranlent nullement la force des démonstrations, quoique souvent la physique nous donne de la nature de cette quantité une idée différente.
A cette classe doivent être rapportées ces notions communes, qui sont comme des liens qui unissent entre elles diverses natures simples, et sur l'évidence desquelles reposent les conclusions du raisonnement ;
A ce compte, il est évident que nous nous trompons, si nous croyons ne pas connaître tout entière quelqu'une de ces natures simples ;
Nous disons, en cinquième lieu, que nous ne pouvons rien comprendre au-delà de ces natures simples, et des composées qui s'en forment ;
ce qui n'empêche pas que nous ne disions que la nature du triangle est un composé de toutes ces natures, et qu'elles sont mieux connues que le triangle, puisque ce sont elles que l'on comprend en lui.
Nous disons, en sixième lieu, que les natures appelées composées sont connues de nous, parce que nous trouvons par expérience qu'elles sont composées, ou parce que nous les composons nous-mêmes.
Par exemple, de ce que dans l'air il n'est rien que la vue, le tact ou quelque autre sens puisse saisir, nous concluons que l'espace qui le renferme est vide, nous joignons mal à propos la nature du vide à celle de l'espace ;
Nous avons de plus expliqué ce que c'est que ces natures simples dont il est question dans la règle huitième.
Il est clair que l'intuition s'applique et à ces natures, et à leur connexion nécessaire entre elles, et enfin à toutes les autres choses que l'entendement trouve par une expérience précise, soit en lui-même, soit dans l'imagination.
Il s'ensuit secondement qu'il ne faut pas se donner beaucoup de peine pour connaître ces natures simples, car elles sont suffisamment connues par elles-mêmes.
Mais tous ne distinguent pas aussi nettement la nature de la position des autres choses contenues dans cette idée, et ils ne peuvent affirmer que dans ce cas rien n'est changé que la position.
Il suit, en troisième lieu, que toute la science humaine consiste seulement à voir distinctement comment ces natures simples concourent entre elles à la formation des autres choses, remarque très utile à faire.
Ainsi, quand on demande quelle est la nature de l'aimant, aussitôt, et parce qu'ils augurent que la chose est difficile et ardue, éloignant leur esprit de tout ce qui est évident, ils l'appliquent à ce qu'il y a de plus difficile, et attendent dans le vague si par hasard, en parcourant l'espace vide de causes infinies, ils ne trouveront pas quelque chose de nouveau.
Mais celui qui pense qu'on ne peut rien connaître dans l'aimant qui ne soit formé de certaines natures simples et connues par elles-mêmes, sûr de ce qu'il doit faire, rassemble d'abord avec soin toutes les expériences qu'il possède sur cette pierre, et cherche ensuite à en déduire quel doit être le mélange nécessaire de natures simples pour produire les effets qu'il a reconnus dans l'aimant.
Cela trouvé, il peut affirmer hardiment qu'il connaît la véritable nature de l'aimant, autant qu'un homme avec les expériences données peut y parvenir.
Il résulte quatrièmement de ce que nous avons dit, qu'il ne faut pas regarder une connaissance comme plus obscure qu'une autre, puisque toutes sont de la même nature, et consistent seulement dans la composition des choses qui sont connues par elles-mêmes :
Liens utiles
- TEXTE: Règles pour la direction de l'esprit, Règle seizième. DESCARTES
- TEXTE: Règles pour la direction de l'esprit, Règle quatorzième. DESCARTES
- TEXTE: Règles pour la direction de l'esprit, Règle treizième. DESCARTES
- TEXTE: Règles pour la direction de l'esprit, Règle douzième. DESCARTES
- TEXTE: Règles pour la direction de l'esprit, Règle quatrième. DESCARTES