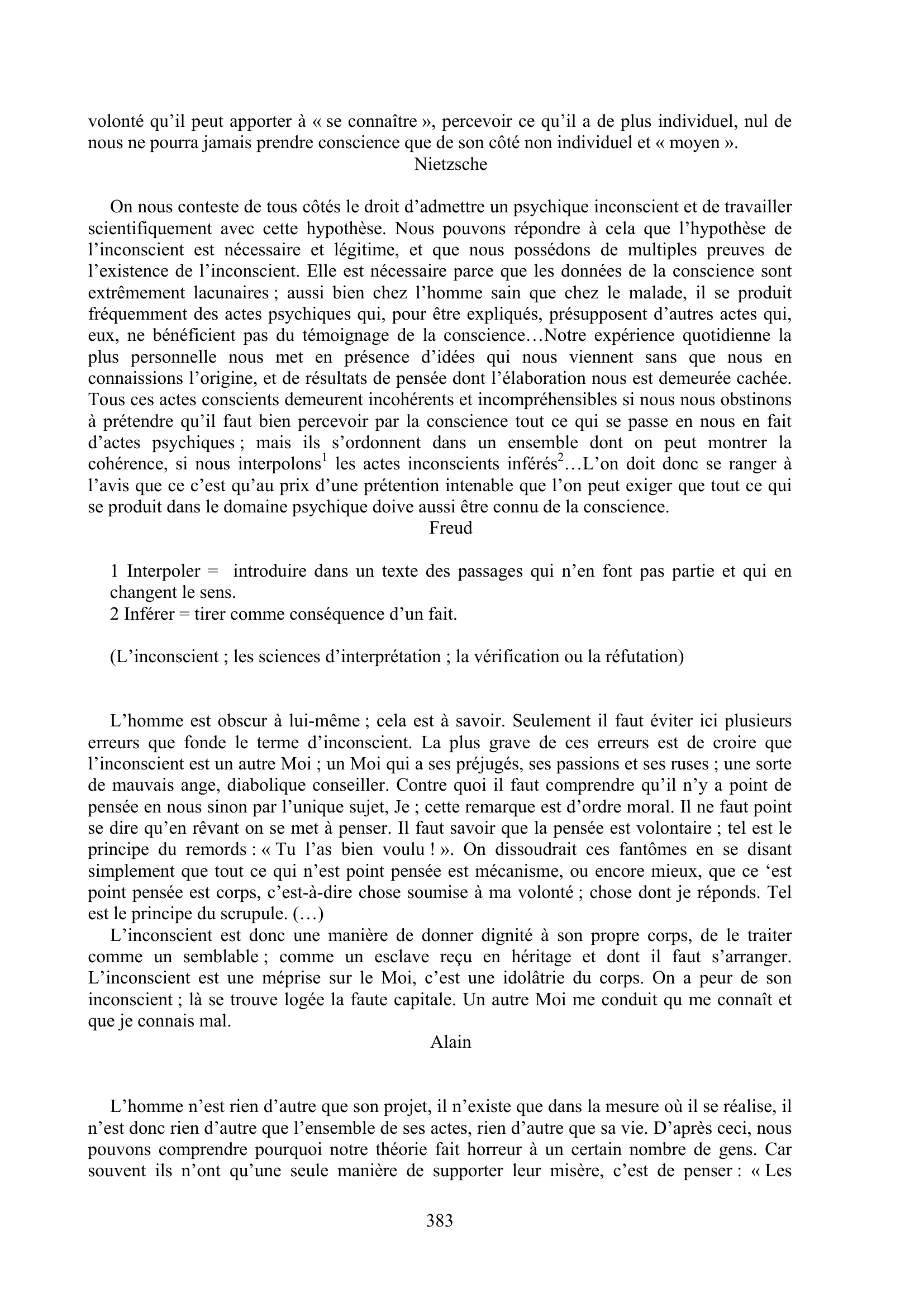Conscience de soi et connaissance de soi
Publié le 10/04/2014

Extrait du document

Conscience de soi et connaissance de soi
La conscience est-elle source d’illusion ? (La conscience, l’inconscient ; la liberté ; la
connaissance sensible)
Suis-je ce que j’ai conscience d’être ?
Etre conscient de soi est-ce être maître de soi ? (La conscience ; l’inconscient ; la liberté)
L’idée d’inconscient exclut-elle l’idée de liberté ?
Peut-on refuser l’idée d’un inconscient psychique ?
Cette conscience de lui-même, l’homme l’acquiert de deux manières : théoriquement, en
prenant conscience de ce qu’il est intérieurement, de tous les mouvements de son âme, de
toutes les nuances de ses sentiments, en cherchant à se représenter à lui-même, tel qu’il se
découvre par la pensée, et à se reconnaître dans cette représentation qu’il offre à ses propres
yeux. Mais l’homme est également engagé dans des rapports pratiques avec le monde
extérieur, et de ces rapports naît également le besoin de transformer ce monde, comme luimême,
dans la mesure où il en fait partie, en lui imprimant son cachet personnel. Et il le fait
pour encore se reconnaître lui-même dans la forme des choses, pour jouir de lui-même comme
d’une réalité extérieure. On saisit déjà cette tendance dans les premières impulsions de
l’enfant : il veut voir des choses dont il soit lui-même l’auteur, et s’il lance des pierres dans
l’eau, c’est pour voir ces cercles qui se forment et qui sont son oeuvre dans laquelle il retrouve
comme un reflet de lui-même. Ceci s’observe dans de multiples occasions et sous les formes
les plus diverses, jusqu’à cette sorte de reproduction de soi-même qu’est une oeuvre d’art.
Hegel
(La conscience ; l’inconscient ; le travail et la technique ; l’art)
Je me trouve en droit de supposer que la conscience ne s’est développée que sous la
pression du besoin de communiquer… La conscience n’est qu’un réseau de communication
entre hommes… : l’homme qui vivait solitaire, en bête de proie, aurait pu s’en passer. Si nos
actions, pensées, sentiments et mouvements parviennent – du moins en partie – à la surface de
notre conscience, c’est le résultat d’une terrible nécessité qui a longtemps dominé l’homme, le
plus menacé des animaux : il avait besoin de secours et de protection, il avait besoin de son
semblable, il était obligé de savoir dire ce besoin, de savoir se rendre intelligible ; et pour
tout cela, …il fallait qu’il eût une « conscience «, qu’il sût lui-même ce qui lui manquait, qu’il
sût ce qu’il sentait, qu’il sût ce qu’il pensait. Car comme toute créature vivante,
l’homme…pense constamment, mais il l’ignore ; la pensée qui devient consciente ne
représente que la partie la plus infime, disons la plus superficielle, la plus mauvaise, de tout ce
qu’il pense : car il n’y a que cette pensée qui s’exprime en paroles, c’est-à-dire en signes
d’échanges…Bref le développement du langage et le développement de la conscience … vont
de pair.
Je pense, comme on le voit, que la conscience n’appartient pas essentiellement à
l’existence individuelle de l’homme, mais au contraire à la partie de sa nature qui est
commune à tout le troupeau ; qu’elle n’est en conséquence, subtilement développée que dans
la mesure de son utilité pour la communauté, le troupeau ; et qu’en dépit de la meilleure
383
volonté qu’il peut apporter à « se connaître «, percevoir ce qu’il a de plus individuel, nul de
nous ne pourra jamais prendre conscience que de son côté non individuel et « moyen «.
Nietzsche
On nous conteste de tous côtés le droit d’admettre un psychique inconscient et de travailler
scientifiquement avec cette hypothèse. Nous pouvons répondre à cela que l’hypothèse de
l’inconscient est nécessaire et légitime, et que nous possédons de multiples preuves de
l’existence de l’inconscient. Elle est nécessaire parce que les données de la conscience sont
extrêmement lacunaires ; aussi bien chez l’homme sain que chez le malade, il se produit
fréquemment des actes psychiques qui, pour être expliqués, présupposent d’autres actes qui,
eux, ne bénéficient pas du témoignage de la conscience…Notre expérience quotidienne la
plus personnelle nous met en présence d’idées qui nous viennent sans que nous en
connaissions l’origine, et de résultats de pensée dont l’élaboration nous est demeurée cachée.
Tous ces actes conscients demeurent incohérents et incompréhensibles si nous nous obstinons
à prétendre qu’il faut bien percevoir par la conscience tout ce qui se passe en nous en fait
d’actes psychiques ; mais ils s’ordonnent dans un ensemble dont on peut montrer la
cohérence, si nous interpolons1 les actes inconscients inférés2…L’on doit donc se ranger à
l’avis que ce c’est qu’au prix d’une prétention intenable que l’on peut exiger que tout ce qui
se produit dans le domaine psychique doive aussi être connu de la conscience.
Freud
1 Interpoler = introduire dans un texte des passages qui n’en font pas partie et qui en
changent le sens.
2 Inférer = tirer comme conséquence d’un fait.
(L’inconscient ; les sciences d’interprétation ; la vérification ou la réfutation)
L’homme est obscur à lui-même ; cela est à savoir. Seulement il faut éviter ici plusieurs
erreurs que fonde le terme d’inconscient. La plus grave de ces erreurs est de croire que
l’inconscient est un autre Moi ; un Moi qui a ses préjugés, ses passions et ses ruses ; une sorte
de mauvais ange, diabolique conseiller. Contre quoi il faut comprendre qu’il n’y a point de
pensée en nous sinon par l’unique sujet, Je ; cette remarque est d’ordre moral. Il ne faut point
se dire qu’en rêvant on se met à penser. Il faut savoir que la pensée est volontaire ; tel est le
principe du remords : « Tu l’as bien voulu ! «. On dissoudrait ces fantômes en se disant
simplement que tout ce qui n’est point pensée est mécanisme, ou encore mieux, que ce ‘est
point pensée est corps, c’est-à-dire chose soumise à ma volonté ; chose dont je réponds. Tel
est le principe du scrupule. (…)
L’inconscient est donc une manière de donner dignité à son propre corps, de le traiter
comme un semblable ; comme un esclave reçu en héritage et dont il faut s’arranger.
L’inconscient est une méprise sur le Moi, c’est une idolâtrie du corps. On a peur de son
inconscient ; là se trouve logée la faute capitale. Un autre Moi me conduit qu me connaît et
que je connais mal.
Alain
L’homme n’est rien d’autre que son projet, il n’existe que dans la mesure où il se réalise, il
n’est donc rien d’autre que l’ensemble de ses actes, rien d’autre que sa vie. D’après ceci, nous
pouvons comprendre pourquoi notre théorie fait horreur à un certain nombre de gens. Car
souvent ils n’ont qu’une seule manière de supporter leur misère, c’est de penser : « Les
circonstances ont été contre moi, je valais beaucoup mieux que ce que j’ai été ; bien sûr, je
n’ai pas eu de grand amour, ou de grande amitié, mais c’est parce que je n’ai pas rencontré un
homme ou une femme qui en fussent dignes, je n’ai pas écrit de très bon livres, c’est parce
que je n’ai pas eu de loisirs pour le faire ; je n’ai pas eu d’enfants à qui me dévouer, c’est
parce que je n’ai pas trouvé l’homme avec lequel j’aurais pu faire ma vie. Sont restées donc,
chez moi, inemployées et entièrement viables, une foule de dispositions, d’inclinations, de
possibilités qui me donnent une valeur que la simple série de mes actes ne permet pas
d’inférer «.
Or, en réalité,… il n’y a pas d’amour autre que celui qui se construit, il n’y a pas de
possibilité d’amour autre que celle qui se manifeste dans un amour ; il n’y a pas de génie autre
que celui qui s’exprime dans des oeuvres d’art : le génie de Proust c’est la totalité des oeuvres
de Proust ; le génie de Racine c’est la série de ses tragédies, en dehors de cela il n’y a rien ;
pourquoi attribuer à Racine la possibilité d’écrire une nouvelle tragédie, puisque précisément
il ne l’a pas écrite ? Un homme s’engage dans sa vie, dessine sa figure, et en dehors de cette
figure il n’y a rien.
Evidemment, cette pensée peut paraître dure à quelqu’un qui n’a pas réussi sa vie. Mais
d’autre part, elle dispose les gens à comprendre que seule compte la réalité, que les rêves, les
attentes, les espoirs permettent seulement de définir un homme comme rêve déçu, comme
espoirs avortés, comme attentes inutiles.
Sartre

«
383 volonté qu’il peut apporter à « se connaître », percevoir ce qu’il a de plus individuel, nul de
nous ne pourra jamais prendre conscience que de son côté non individuel et « moyen ».
Nietzsche
On nous conteste de tous côtés le droit d’admettre un psychique inconscient et de travailler
scientifiquement avec cette hypothèse.
Nous pouvons répondre à cela que l’hypothèse de
l’inconscient est nécessaire et légitime, et que nous possédons de multiples preuves de
l’existence de l’inconscient.
Elle est nécessaire parce que les données de la conscience sont
extrêmement lacunaires ; aussi bien chez l’homme sain que chez le malade, il se produit
fréquemment des actes psychiques qui, pour être expliqués, présupposent d’autres actes qui,
eux, ne bénéficient pas du témoignage de la conscience…Notre expérience quotidienne la
plus personnelle nous met en présence d’idées qui nous viennent sans que nous en
connaissions l’origine, et de résultats de pensée dont l’élaboration nous est demeurée cachée.
Tous ces actes conscients demeurent incohérents et incompréhensibles si nous nous obstinons
à prétendre qu’il faut bien percevoir par la conscience tout ce qui se passe en nous en fait
d’actes psychiques ; mais ils s’ordonnent dans un ensemble dont on peut montrer la
cohérence, si nous interpolons
1 les actes inconscients inférés 2…L’on doit donc se ranger à
l’avis que ce c’est qu’au prix d’une prétention intenable que l’on peut exiger que tout ce qui
se produit dans le domaine psychique doive aussi être connu de la conscience.
Freud
1 Interpoler = introduire dans un texte des passages qui n’en font pas partie et qui en
changent le sens.
2 Inférer = tirer comme conséquence d’un fait.
(L’inconscient ; les sciences d’interprétation ; la vérification ou la réfutation)
L’homme est obscur à lui-même ; cela est à savoir.
Seulement il faut éviter ici plusieurs
erreurs que fonde le terme d’inconscient.
La plus grave de ces erreurs est de croire que
l’inconscient est un autre Moi ; un Moi qui a ses préjugés, ses passions et ses ruses ; une sorte
de mauvais ange, diabolique conseiller.
Contre quoi il faut comprendre qu’il n’y a point de
pensée en nous sinon par l’unique sujet, Je ; cette remarque est d’ordre moral.
Il ne faut point
se dire qu’en rêvant on se met à penser.
Il faut savoir que la pensée est volontaire ; tel est le
principe du remords : « Tu l’as bien voulu ! ».
On dissoudrait ces fantômes en se disant
simplement que tout ce qui n’est point pensée est mécanisme, ou encore mieux, que ce ‘est
point pensée est corps, c’est-à-dire chose soumise à ma volonté ; chose dont je réponds.
Tel
est le principe du scrupule.
(…)
L’inconscient est donc une manière de donner dignité à son propre corps, de le traiter
comme un semblable ; comme un esclave reçu en héritage et dont il faut s’arranger.
L’inconscient est une méprise sur le Moi, c’est une idolâtrie du corps.
On a peur de son
inconscient ; là se trouve logée la faute capitale.
Un autre Moi me conduit qu me connaît et
que je connais mal.
Alain
L’homme n’est rien d’autre que son projet, il n’existe que dans la mesure où il se réalise, il
n’est donc rien d’autre que l’ensemble de ses actes, rien d’autre que sa vie.
D’après ceci, nous
pouvons comprendre pourquoi notre théorie fait horreur à un certain nombre de gens.
Car
souvent ils n’ont qu’une seule manière de supporter leur misère, c’est de penser : « Les.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La conscience immédiate est-elle connaissance de soi?
- La conscience de soi équivaut-elle à la connaissance de soi ?
- La conscience est-elle UNE CONNAISSANCE DE SOI ?
- Conscience ET CONNAISSANCE DE SOI
- La conscience de soi est-elle une connaissance ?