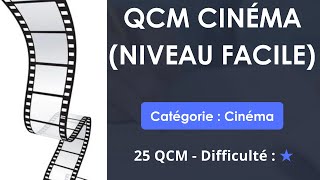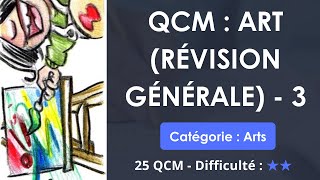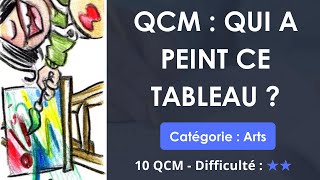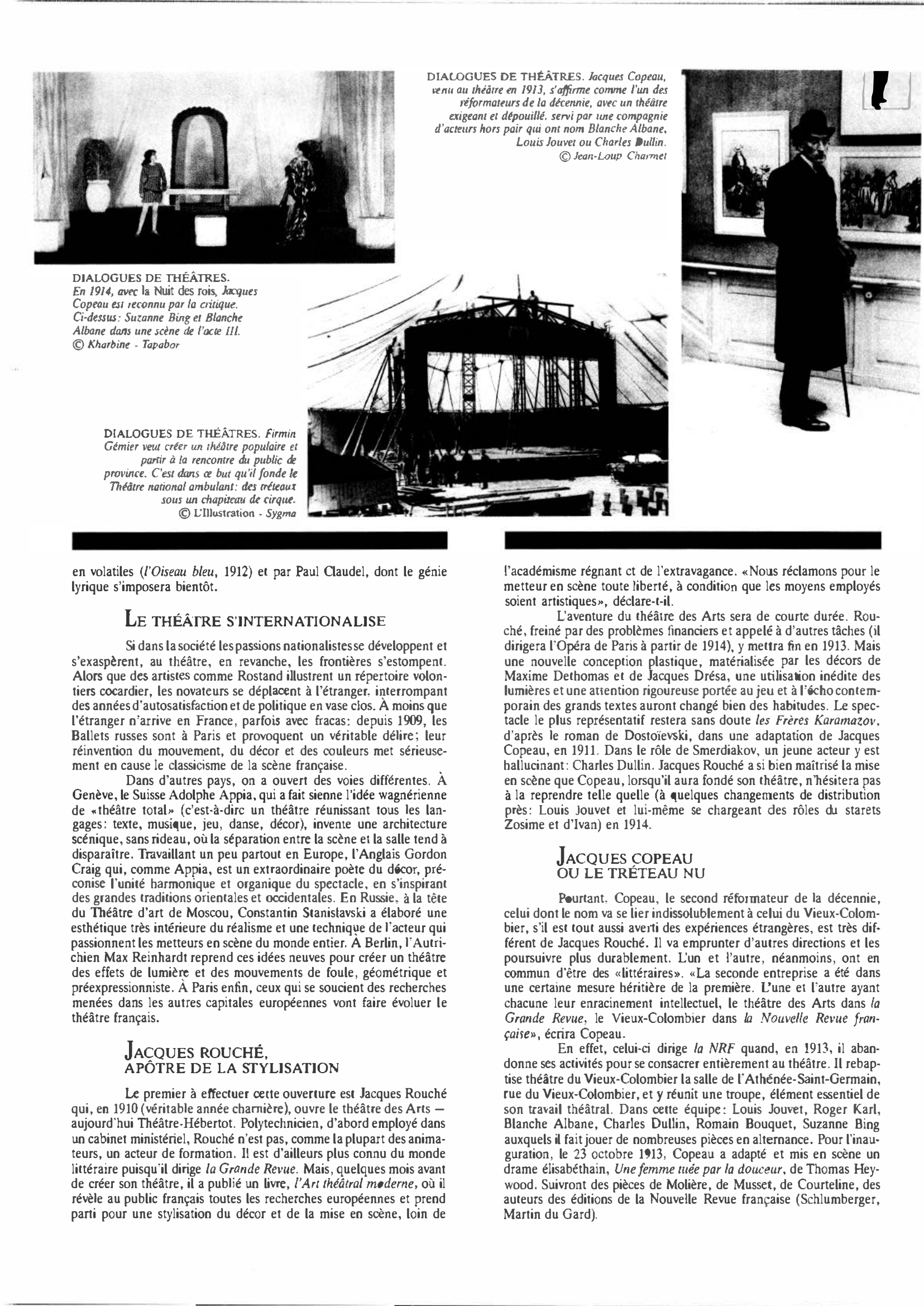Le théâtre de 1910 à 1919 : Histoire
Publié le 11/01/2019

Extrait du document

En 1910, le poète dramatique le plus prisé de l'cpoque, Edmond Rostand, subit un cuisant échec avec Chantecler, fable nostalgique dans laquelle un coq découvre que son chant matinal ne fait pas lever le soleil. La postérité révisera ce jugement: Chantecler n’est pas une pièce ridicule, elle contient de vraies beautés. Mais la poésie a changé ; sa modernité est mieux représentée par le symboliste Maurice Maeterlinck, qui, lui aussi, va mettre sur scène des acteurs costumés en volatiles (L'Oiseau bleu, 1912) et par Paul Claudel, dont le génie lyrique s’imposera bientôt.
Le THÉÂTRE S’INTERNATIONALISE
Si dans la société les passions nationalistes se développent et s’exaspèrent, au théâtre, en revanche, les frontières s’estompent. Alors que des artistes comme Rostand illustrent un répertoire volontiers cocardier, les novateurs se déplacent à l’étranger, interrompant des années d’autosatisfaction et de politique en vase clos. À moins que l’étranger n’arrive en France, parfois avec fracas: depuis 1909, les Ballets russes sont à Paris et provoquent un véritable délire; leur réinvention du mouvement, du décor et des couleurs met sérieusement en cause le classicisme de la scène française.
Dans d’autres pays, on a ouvert des voies différentes. À Genève, le Suisse Adolphe Appia, qui a fait sienne l’idée wagnérienne de «théâtre total» (c’est-à-dire un théâtre réunissant tous les langages: texte, musique, jeu, danse, décor), invente une architecture scénique, sans rideau, où la séparation entre la scène et la salle tend à disparaître. Travaillant un peu partout en Europe, l'Anglais Gordon Craig qui, comme Appia, est un extraordinaire poète du décor, préconise l’unité harmonique et organique du spectacle, en s’inspirant des grandes traditions orientales et occidentales. En Russie, à la tête du Théâtre d’art de Moscou, Constantin Stanislavski a élaboré une esthétique très intérieure du réalisme et une technique de l’acteur qui passionnent les metteurs en scène du monde entier. À Berlin, l’Autrichien Max Reinhardt reprend ces idées neuves pour créer un théâtre des effets de lumière et des mouvements de foule, géométrique et préexpressionniste. À Paris enfin, ceux qui se soucient des recherches menées dans les autres capitales européennes vont faire évoluer le théâtre français.
Jacques rouché,
APÔTRE DE LA STYLISATION
Le premier à effectuer cette ouverture est Jacques Rouché qui, en 1910 (véritable année charnière), ouvre le théâtre des Arts — aujourd’hui Théâtre-Hébertot. Polytechnicien, d’abord employé dans un cabinet ministériel, Rouché n’est pas, comme la plupart des animateurs, un acteur de formation. Il est d’ailleurs plus connu du monde littéraire puisqu’il dirige la Grande Revue. Mais, quelques mois avant de créer son théâtre, il a publié un livre, l'Art théâtral moderne, où il révèle au public français toutes les recherches européennes et prend parti pour une stylisation du décor et de la mise en scène, loin de
l’académisme régnant et de l'extravagance. «Nous réclamons pour le metteur en scène toute liberté, à condition que les moyens employés soient artistiques», déclare-t-il.
L'aventure du théâtre des Arts sera de courte durée. Rouché, freiné par des problèmes financiers et appelé à d’autres tâches (il dirigera l’Opéra de Paris à partir de 1914), y mettra fin en 1913. Mais une nouvelle conception plastique, matérialisée par les décors de Maxime Dethomas et de Jacques Drésa, une utilisation inédite des lumières et une attention rigoureuse portée au jeu et à l'écho contemporain des grands textes auront changé bien des habitudes. Le spectacle le plus représentatif restera sans doute les Frères Karamazov, d'après le roman de Dostoïevski, dans une adaptation de Jacques Copeau, en 1911. Dans le rôle de Smerdiakov, un jeune acteur y est hallucinant: Charles Dullin. Jacques Rouché a si bien maîtrisé la mise en scène que Copeau, lorsqu’il aura fondé son théâtre, n’hésitera pas à la reprendre telle quelle (à quelques changements de distribution près: Louis Jouvet et lui-même se chargeant des rôles du starets Zosime et d’Ivan) en 1914.

«
DIALOGUES
DE THéÂTRES.
Jacques Copeau,
ve 1111 au thélirre en 1913, s'affinne comme J'un des
réformateurs de la décenn ie, avec un théâtre
exigeant er dépoui/Jé, servi par une compagnie
d'acteurs hors pair qu i ont nom Blanche Albane,
Louis louver ou Charles Du/Jin.
©Jean-Loup Clrarmer ll
J
DIALOGUES DE THÉÂTRES.
En /914, avec la Nuit des rois, Jacques
Copeau tJI reconnu par la critique.
Ci-dt.!.!us: Suzanne Bing et Blanche
Albane dans une scène de l'acre Ill.
© Kharbine • Tapabor
DIALOGUES DE THÉÂTRES.
Firmin
Gémier veut créer zm rhéfirr e populaire er
partir à la rencontre du public de
province.
C'est dans ce bw qu'il fonde le
Théâtre national amb ulant : des tréteaux
sous un chapiteau de cirque.
© L'illustration • Sygma
en volatiles (l'Oiseau bleu, 1 912) et par Paul Claudel, dont le génie
lyrique s'imposera bientôt.
LE THÉÂTRE S'INTERNATIONALISE
Si dans la société les passions nationalistes se développent et
s'exaspèrent, au théâtre, en revanche, les frontières s'estompent.
Alors que des artistes comme Rostand illustrent un répertoire volon
tiers cocardier, les novateurs se déplacent à l'étranger, i�terrompant
des années d'autosatisfaction et de politique en vase clos.
A moins que
l'étranger n'arrive en France, parfois avec fracas: depuis 1909, les
Ballets russes sont à Paris et provoquent un véritable délire; leur
réinvention du mouvement, du décor et des couleurs met sérieuse
ment en cause le classicisme de la scène française.
.
Dans d'autres pays, on a ouvert des voies différentes.
A
Genève, le Suisse Adolphe Appia, qui a fait sienne l'idée wagnérienne
de «théâtre total» (c'est-à-dire un théâtre réunissant tous les lan
gages: texte, musique, jeu, danse, décor), invente une architecture
scénique, sans rideau, où la séparation entre la scène et la salle tend à
disparaître.
Travaillant un peu partout en Europe, l'Anglais Gordon
Craig qui, comme Appia, est un extraordinaire poète du décor, pré
conise l'unité harmonique et organique du spectacle, en s'inspirant
des grandes traditions orientales et occidentales.
En Russie, à la tête
du Théâtre d'art de Moscou, Constantin Stanislavski a élaboré une
esthétique très intérieure du réalisme et une techniqlfe de l'acteur qui
passionnent les metteurs en scène du monde entier.
A Berlin, l' Autri
chien Max Reinhardt reprend ces idées neuves pour créer un théâtre
des effets de lumiè�e et des mouvements de foule, géométrique et
préexpressionniste.
A Paris enfin, ceux qui se soucient des recherches
menées dans les autres capitales européennes vont faire évoluer le
théâtre français.
JACQUES ROUCHÉ,
APÔTRE DE LA STYLISATION
Le premier à effectuer cene ouverture est Jacques Rouché
qui, en 1910 (véritable année charnière), ouvre le théâtre des Arts -
aujourd'hui Théâtre-Hébertot.
Polytechnicien, d'abord employé dans
un cabinet ministériel, Rouché n'est pas, comme la plupart des anima
teurs, un acteur de formation.
Il est d'ailleurs plus connu du monde
littéraire puisqu'il dirige la Grande Revue.
Mais, quelques mois avant
de créer son théâtre, il a publié un livre, I'Artthédtral moderne, où il
révèle au public français toutes les recherches européennes et prend
parti pour une stylisation du décor et de la mise en scène, loin de l'académisme
régnant ct de l'extravagance.
«Nous réclamons pour le
metteur en scène toute liberté, à condition que les moyens employés
soient artistiques», déclare-t-il.
L'aventure du théâtre des Arts sera de courte durée.
Rou
ché, freiné par des problèmes financiers et appelé à d'autres tâches (il
dirigera l'Opéra de Paris à partir de 1914), y mettra fin en 1913.
Mais
une nouvelle conception plastique, matérialisée par les décors de
Maxime Dethomas et de Jacques Drésa, une utilisation inédite des
lumières et une anention rigoureuse portée au jeu et à l'écho contem
porain des grands textes auront changé bien des habitudes.
Le spec
tacle le plus représentatif restera sans doute les Frères Karamm:ov,
d'après le roman de Dostoïevski, dans une adaptation de Jacques
Copeau, en 1911.
Dans le rôle de Smerdiakov, un jeune acteur y est
hallucinant: Charles Dullin.
Jacques Rouché a si bien maîtrisé la mise
en scène que Copeau, lorsqu'il aura fondé son théâtre, n'hésitera pas
à la reprendre telle quelle (à quelques changements de distribution
près: Louis Jouvet et lui-même se chargeant des rôles du starets
Zosime et d'Ivan) en 1914.
J ACQUES COPEAU
OU LE TRÉTEAU NU
Pourtant, Copeau, le second réformateur de la décennie,
celui dont le nom va se lier indissolublement à celui du Vieux-Colom
bier, s'il est tout aussi averti des expériences étrangères, est très dif
férent de Jacques Rouché.
Il va emprunter d'autres directions et les
poursuivre plus durablement.
L'un et l'autre, néanmoins, ont en
commun d'être des.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LA Peinture de 1910 à 1919 : Histoire
- La musique dans la décennie 1910-1919: Histoire
- L'ARCHITECTURE de 1910 à 1919 : Histoire
- LES Ballets russes de 1910 à 1919 : Histoire
- Libye (TRIPOLITAINE ET CYRÉNAÏQUE) de 1910 à 1919 : Histoire