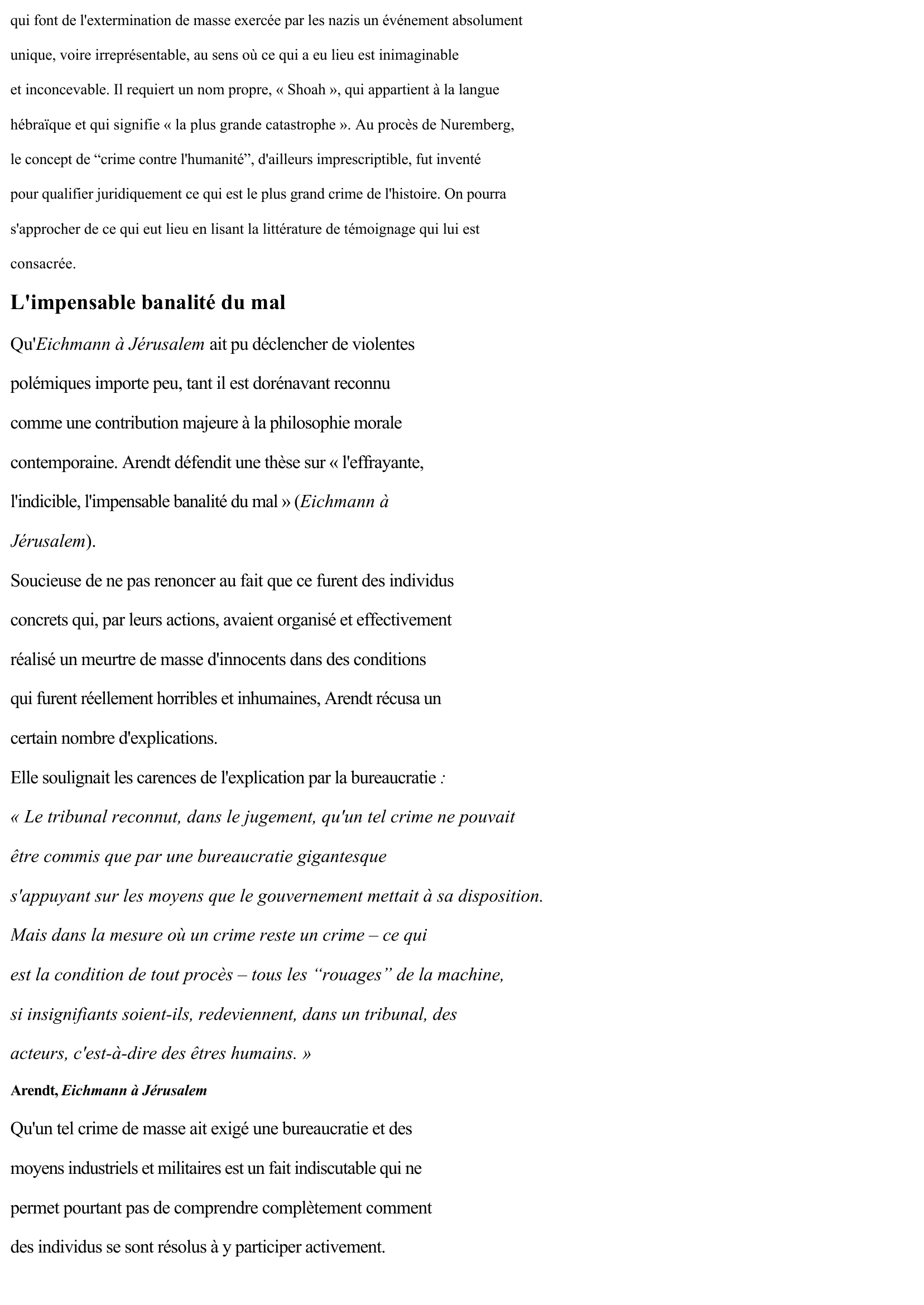Arendt : penser l'inhumain
Publié le 22/02/2012

Extrait du document


«
qui font de l'extermination de masse exercée par les nazis un événement absolument
unique, voire irreprésentable, au sens où ce qui a eu lieu est inimaginable
et inconcevable.
Il requiert un nom propre, « Shoah », qui appartient à la langue
hébraïque et qui signifie « la plus grande catastrophe ».
Au procès de Nuremberg,
le concept de “crime contre l'humanité”, d'ailleurs imprescriptible, fut inventé
pour qualifier juridiquement ce qui est le plus grand crime de l'histoire.
On pourra
s'approcher de ce qui eut lieu en lisant la littérature de témoignage qui lui est
consacrée.
L'impensable banalité du mal
Qu' Eichmann à Jérusalem ait pu déclencher de violentes
polémiques importe peu, tant il est dorénavant reconnu
comme une contribution majeure à la philosophie morale
contemporaine.
Arendt défendit une thèse sur « l'effrayante,
l'indicible, l'impensable banalité du mal » ( Eichmann à
Jérusalem ).
Soucieuse de ne pas renoncer au fait que ce furent des individus
concrets qui, par leurs actions, avaient organisé et effectivement
réalisé un meurtre de masse d'innocents dans des conditions
qui furent réellement horribles et inhumaines, Arendt récusa un
certain nombre d'explications.
Elle soulignait les carences de l'explication par la bureaucratie :
« Le tribunal reconnut, dans le jugement, qu'un tel crime ne pouvait
être commis que par une bureaucratie gigantesque
s'appuyant sur les moyens que le gouvernement mettait à sa disposition.
Mais dans la mesure où un crime reste un crime – ce qui
est la condition de tout procès – tous les “rouages” de la machine,
si insignifiants soient-ils, redeviennent, dans un tribunal, des
acteurs, c'est-à-dire des êtres humains.
»
Arendt, Eichmann à Jérusalem
Qu'un tel crime de masse ait exigé une bureaucratie et des
moyens industriels et militaires est un fait indiscutable qui ne
permet pourtant pas de comprendre complètement comment
des individus se sont résolus à y participer activement..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Arendt: Penser l'événement
- Hannah Arendt, Journal de pensée, (1953) – traduction Sylvie Courtine-Denamy
- Penser le temps
- En quoi peut on dire que Gargantua de Rabelais prête autant a rire qu’il donne à penser ?
- PEUT ON PENSER PAR SOI MÊME ?