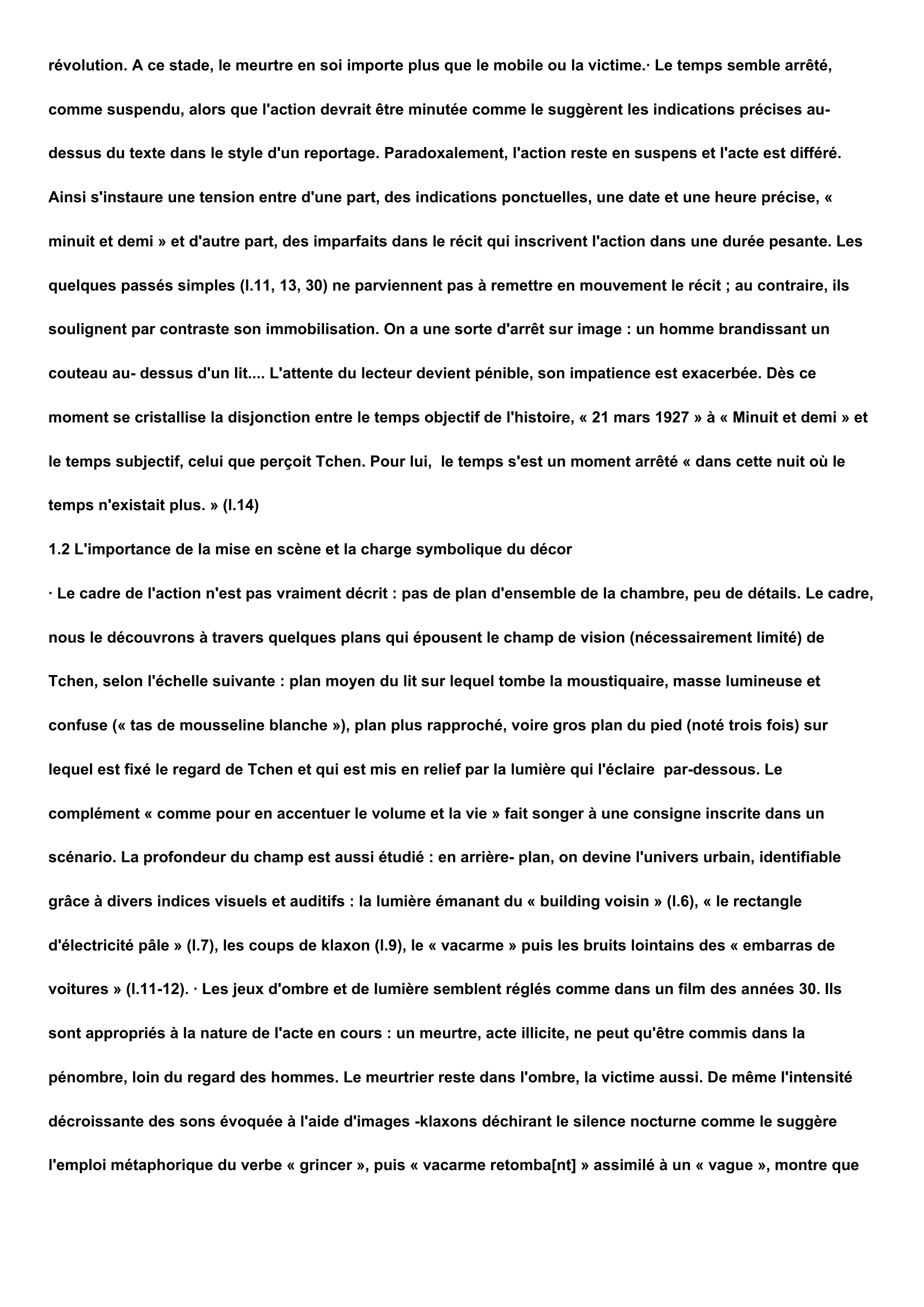Commentaire La condition Humaine
Publié le 10/11/2012

Extrait du document
«
révolution.
A ce stade, le meurtre en soi importe plus que le mobile ou la victime.· Le temps semble arrêté,
comme suspendu, alors que l'action devrait être minutée comme le suggèrent les indications précises au-
dessus du texte dans le style d'un reportage.
Paradoxalement, l'action reste en suspens et l'acte est différé.
Ainsi s'instaure une tension entre d'une part, des indications ponctuelles, une date et une heure précise, «
minuit et demi » et d'autre part, des imparfaits dans le récit qui inscrivent l'action dans une durée pesante.
Les
quelques passés simples (l.11, 13, 30) ne parviennent pas à remettre en mouvement le récit ; au contraire, ils
soulignent par contraste son immobilisation.
On a une sorte d'arrêt sur image : un homme brandissant un
couteau au- dessus d'un lit....
L'attente du lecteur devient pénible, son impatience est exacerbée.
Dès ce
moment se cristallise la disjonction entre le temps objectif de l'histoire, « 21 mars 1927 » à « Minuit et demi » et
le temps subjectif, celui que perçoit Tchen.
Pour lui, le temps s'est un moment arrêté « dans cette nuit où le
temps n'existait plus.
» (l.14)
1.2 L'importance de la mise en scène et la charge symbolique du décor
· Le cadre de l'action n'est pas vraiment décrit : pas de plan d'ensemble de la chambre, peu de détails.
Le cadre,
nous le découvrons à travers quelques plans qui épousent le champ de vision (nécessairement limité) de
Tchen, selon l'échelle suivante : plan moyen du lit sur lequel tombe la moustiquaire, masse lumineuse et
confuse (« tas de mousseline blanche »), plan plus rapproché, voire gros plan du pied (noté trois fois) sur
lequel est fixé le regard de Tchen et qui est mis en relief par la lumière qui l'éclaire par-dessous.
Le
complément « comme pour en accentuer le volume et la vie » fait songer à une consigne inscrite dans un
scénario.
La profondeur du champ est aussi étudié : en arrière- plan, on devine l'univers urbain, identifiable
grâce à divers indices visuels et auditifs : la lumière émanant du « building voisin » (l.6), « le rectangle
d'électricité pâle » (l.7), les coups de klaxon (l.9), le « vacarme » puis les bruits lointains des « embarras de
voitures » (l.11-12). · Les jeux d'ombre et de lumière semblent réglés comme dans un film des années 30.
Ils
sont appropriés à la nature de l'acte en cours : un meurtre, acte illicite, ne peut qu'être commis dans la
pénombre, loin du regard des hommes.
Le meurtrier reste dans l'ombre, la victime aussi.
De même l'intensité
décroissante des sons évoquée à l'aide d'images -klaxons déchirant le silence nocturne comme le suggère
l'emploi métaphorique du verbe « grincer », puis « vacarme retomba[nt] » assimilé à un « vague », montre que.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- commentaire : André Malraux, La condition humaine
- Commentaire texte André Malraux La Condition humaine (1933) Première partie 21 mars 1927
- Malraux: Plan détaillé du commentaire de l'incipit de La Condition humaine
- ► Vous ferez le commentaire du début de La Condition humaine de Malraux.
- La Condition humaine, I,« 21 mars I 927 », Folio (Gallimard), pp. 54-55. Commentaire composé)