De Gaulle au micro de la BBC
Publié le 22/02/2012

Extrait du document
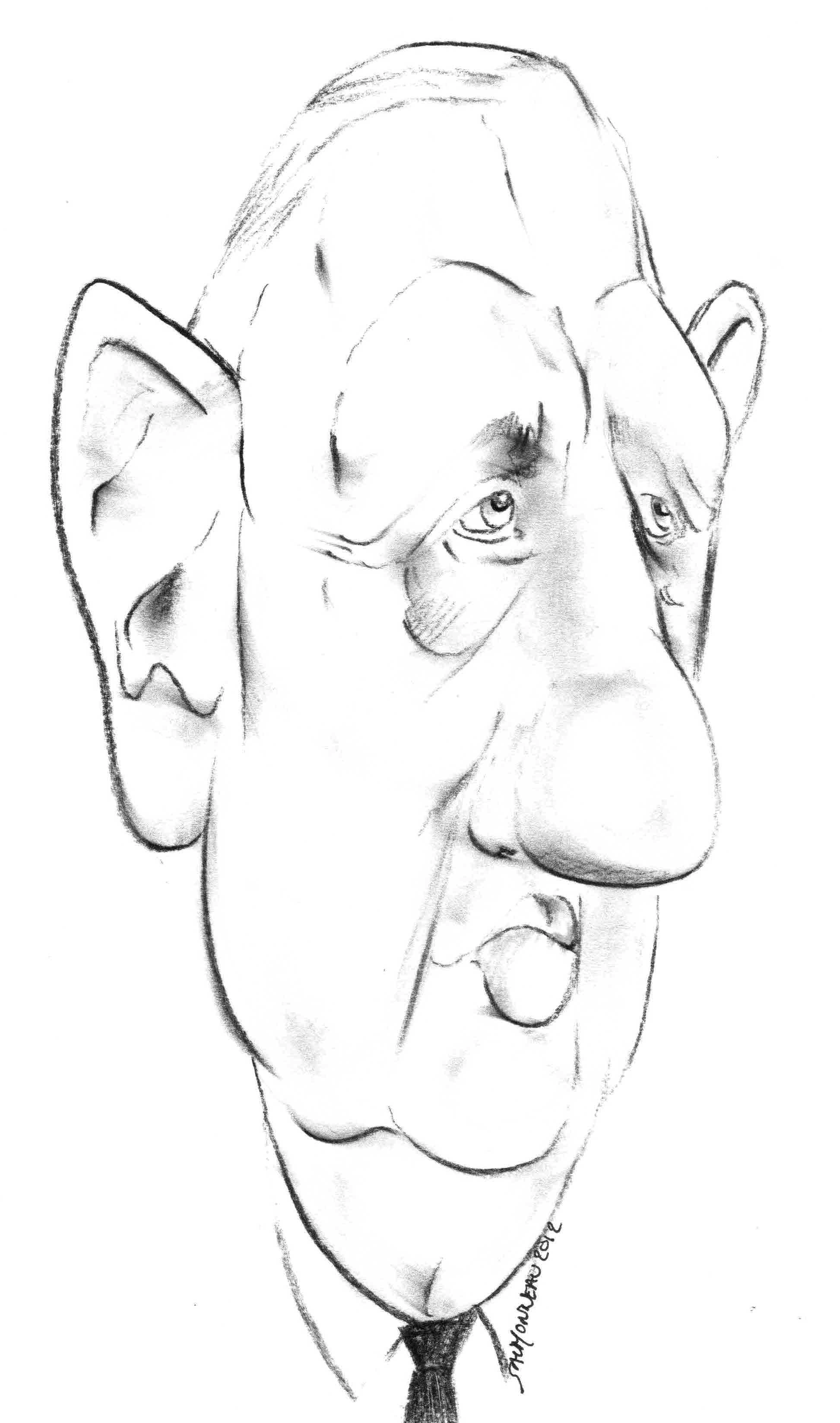
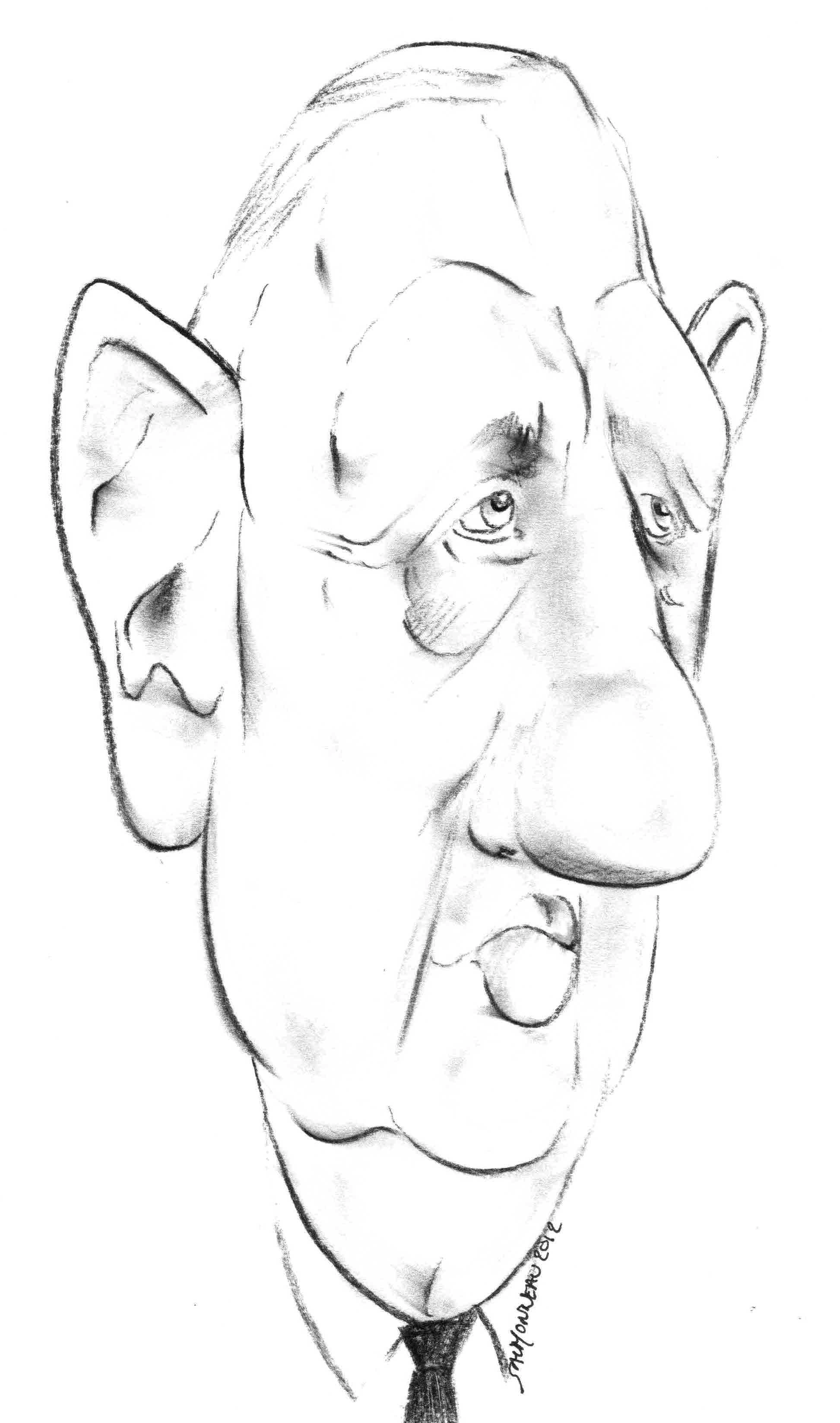
«
Charles de Gaulle avait atterri à Londres la veille, le 17 juin, au début de l'après-midi, deux heures après la diffusion de l'appelà " cesser le combat " lancé de Bordeaux par le maréchal Pétain, à l'heure où le préfet de Chartres, qui s'appelait Jean Moulin,était pour la première fois torturé par les envahisseurs.
Avait-il, dès son précédent séjour à Londres, comme sous-secrétaire d'Etat à la guerre du gouvernement Reynaud, du 15 au16, décidé cet exil ? A Henry Amouroux qui le lui demandait le général répondit : " C'était même, autant vous dire, convenu (1) ".
Propos bien net pour une situation et des intentions qui furent, semble-t-il, complexes, mais que domina bien sûr une puissanteet très simple réaction : le refus d'accepter la défaite.
Sentiment auquel s'ajoutait la fureur de voir investis par le désastre les deuxhommes que lui, de Gaulle, tenait pour les responsables directs de l'effondrement de l'armée : Pétain et Weygand.
Ayant appris, le 16 au soir à Bordeaux, l'éviction de Reynaud, et le choix pour la politique d'armistice, il n'a pas barguignélongtemps.
Et si " épouvantable " qu'ait été pour lui la décision de rompre avec la légalité apparente, ce n'est pas enlevé par SirEdward Spears, l'émissaire de Churchill, qu'il a quitté Bordeaux le 17 au matin, mais ayant choisi de le faire.
Pourquoi ? Parcequ'à été prise une décision qu'il estime contraire à l'honneur et plus encore à l'intérêt du pays.
Parce qu'il est un stratège desgrands espaces, et que, regardant ce jour-là des officiers étudiant une carte, il leur lance violemment : " Prenez donc unemappemonde ! " A Londres, il n'a pas été accueilli sans réserve le 17.
Spears a fait en effet prévoir à Churchill qu'il ramènerait àLondres des personnages d'un tout autre " standing " politique : Reynaud, Mandel, Louis Marin.
D'autre part, au moment mêmeoù il atterrit en Angleterre, Jean Monnet et Pleven quittent Londres après avoir persuadé leurs amis britanniques qu'ilsconvaincront Herriot et Jeanneney de former un gouvernement de résistance hors de la métropole.
Enfin, le Foreign Office voitsans enthousiasme s'amorcer une opération qui risque fort d'aggraver encore la crise entre les deux gouvernements.
" Il faut continuer à se battre "
Mais Churchill, qui a apprécié la pugnacité du jeune général lors des conseils interalliés de la première quinzaine de juin, mêmelorsqu'elle s'appliquait à des projets aussi absurdes que celui du " réduit breton ", et qui voit en lui un personnage de sa trempe,prend dès la soirée du 17 l'initiative de lui confier un micro, en attendant Reynaud et Mandel.
Et de Gaulle se met au travail dansle petit appartement de Seamore Place que lui a prêté son ancien chef de cabinet, Jean Laurent.
Il est 20 h 20, ce 18 juin, quand, à la fin de l'émission d'information du soir, qui n'a été qu'un tissu de sinistres nouvelles, leresponsable des bulletins étrangers, Gibson Parker, et un vieux speaker français nommé Thierry, font place, à leurs côtés, à ungrand diable de général en tenue de toile qui pose sur un petit lutrin de bois, devant le micro deux feuillets dactylographiés parElisabeth de Miribel.
Et il commence de sa voix des profondeurs : " Les chefs qui depuis de longues années sont à la tête desarmées françaises...
".
L'appel est lancé.
Il n'est d'abord entendu que par un petit nombre : Pierre Mendès France à Jarnac, Maurice Schumann sousles bombes d'une gare.
A Locminé, pourtant, bourgade bretonne que traversent en trombe les motards allemands, un jeunehomme accourt sur la place pour clamer la nouvelle : " Un général vient de parler à la radio et dit qu'il faut continuer à se battre ...Il s'appelle de Gaulle.
" Alors une vieille dame perdue dans la foule lâche le bras du curé auquel elle s'accrochait et jette dans uncri : " C'est mon fils ! "...
Douze jours plus tard la vieille dame était morte.
Et les gendarmes de Locminé, résistants d'avant-garde,rendaient devant sa tombe les honneurs militaires à la mère de l'homme du 18 juin.
JEAN LACOUTURE Le Monde du 18 juin 1965.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- de Gaulle : Appel du 18 juin 1940 à la BBC (analyse)
- Dissertation sur le général de gaulle
- Quelle est l’importance des micro-organismes dans la préparation de l’akassa ; du come et du fromage et quelle est leur techniques de préparation ?
- commentaire: discours de bayeux de charles de gaulle
- Analyse du discours de Charles De Gaulle à l’hôtel de ville de Paris le 25 août 1944 Ce document est un discours prononcé par le général De Gaulle, à l’hôtel de ville de Paris le 25 août 1944.


