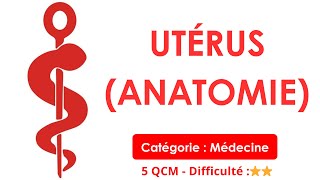et si nous nous apercevons que les autres nous sont inférieurs à cet égard, nous n'en éprouverons aucun plaisir, nous le déplorerons plutôt et formerons le souhait sincère que tous puissent nous ressembler.
Publié le 23/10/2012

Extrait du document
et si nous nous apercevons que les autres nous sont inférieurs à cet égard, nous n'en éprouverons aucun plaisir, nous le déplorerons plutôt et formerons le souhait sincère que tous puissent nous ressembler. — Qu'ils sont différents, les effets que produit la conscience de notre supériorité intellectuelle 1... Une vanité superbe et triomphante, une pitié faite de hauteur et de dédain à l'égard d'autrui, le chatouillement délicieux que donne la conscience d'une supériorité marquée et éclatante, et qui se rapproche de cet orgueil que nous font éprouver nos avantages physiques, tel est le bilan du contentement de soi, seconde manière. — Ce contraste entre ces deux sortes de contentements montre bien que l'une d'elles concerne notre être vrai, intime et éternel, tandis que l'autre se rapporte à des avantages plus extérieurs, purement temporels, pour ainsi dire purement physiques. Et, par le fait, l'intellect n'est-il pas une simple fonction du cerveau ? Tandis que la volonté est la fin, dont l'homme tout entier, dans son existence et dans son essence, est la fonction. (Monde, III, 43-46.) Toutes ces considérations prouveront clairement à tout observateur un peu profond que l'intellect parcourt une longue série de développements successifs pour s'acheminer, comme toute chose physique, à la ruine, que la volonté reste en dehors de ces évolutions, ou du moins qu'elle n'y participe que dans une faible mesure : au commencement de sa carrière, elle lutte contre l'intellect, instrument encore incomplet, et à la fin de la vie il lui faut résister à l'usure de ce même outil ; mais elle-même apparaît comme une chose toute faite et immuable, qui n'est pas soumise aux lois du temps ni à celle du devenir et de l'anéantissement dans le temps. Par là elle se caractérise comme élément métaphysique, en dehors du monde phénoménal. C'est un juste sentiment de cette différence fondamentale qui a donné naissance aux termes, généralement usités et exactement compris par presque tous, de tête et de coeur ; termes excellents et caractéristiques et qui se retrouvent dans toutes les langues. C'est à bon droit que le coeur, ce primum mobile de la vie animale, a été adopté comme symbole, comme synonyme même de la volonté ; il sert à la désigner comme essence primitive de notre existence phénoménale, en opposition à l'intellect qui est véritablement SCHOPENHAUER identique à la tête. Tout ce qui est chose de la volonté, au sens le plus large du mot, tel que le désir, la passion, la joie, la douleur, la bonté, la méchanceté, de même ce que les Allemands appellent G emiith ( les choses du sentiment) et qu'Homère désigne par cpiXov trop, est attribué au coeur. Ainsi l'on dit : il a mauvais coeur ; son coeur est suspendu à telle chose ; cela vient du coeur ; cela l'a blessé au coeur ; cela lui a brisé le coeur ; son coeur saigne ; son coeur tressaille de joie ; qui peut voir dans le coeur de l'homme ? cela déchire, cela brise, cela anéantit, cela élève, cela émeut le coeur ; il est cordialement bon ; il a le coeur dur ; il a du coeur, il n'a pas de coeur (dans le sens de courage), etc. Les choses d'amour tout particulièrement s'appellent affaires de coeur ; parce que l'instinct sexuel est le foyer de la volonté et que le choix de ce qui le concerne est l'occupation essentielle du vouloir humain... — La tête au contraire désigne tout ce qui a trait à la connaissance. De là : un homme de tête ; une tête remarquable, fine, bornée ; perdre la tête ; porter haut la tête, etc. Tête et coeur, ces deux mots désignent tout l'homme. Mais la tête n'est jamais que l'élément secondaire et dérivé : car elle n'est pas le centre, mais seulement l'efflorescence suprême du corps. Quand un héros meurt, on embaume son coeur et non pas son cerveau : au contraire on aime à conserver le crâne des poètes, des artistes et des philosophes. (Monde, III, 50-51.) 3. L'IDENTITÉ DE LA PERSONNE « LE NOYAU DE NOTRE ÊTRE « Sur quoi repose l'identité de la personne ? Non pas sur la matière du corps : celle-ci se renouvelle au bout de quelques années. Non plus sur la forme de ce corps : elle change dans son ensemble et dans ses diverses parties, sauf toutefois dans l'expression du regard ; c'est au regard qu'après un grand nombre d'années même on peut reconnaître une personne. Preuve que, malgré toutes les modifications que le temps provoque dans l'homme, quelque chose en lui reste immuable, et nous permet ainsi, après un très long intervalle même, de le reconnaître et de le retrouver intact. C'est ce que nous observons également en nous-même : nous avons beau vieillir, dans notre for intérieur nous nous sentons toujours le même que nous étions dans notre jeunesse, dans notre enfance même. Cet élément immuable, qui demeure toujours identique à soi sans jamais vieillir, c'est précisément le noyau de notre être qui n'est pas dans le temps. — On admet généralement que l'identité de la personne repose sur celle de la conscience. Si on entend uniquement par cette dernière le souvenir coordonné du cours de notre vie, elle ne suffit pas à expliquer l'autre. Sans doute nous savons un peu plus de notre vie passée que d'un roman lu autrefois ; mais ce que nous en savons est pourtant peu de chose. Les événements principaux, les scènes intéressantes se sont gravés dans la mémoire ; quant au reste, pour un événement retenu, mille autres sont tombés dans l'oubli. Plus nous vieillissons, et plus les faits de notre vie passent sans laisser de trace. Un âge très avancé, une maladie, une lésion du cerveau, la folie peuvent nous priver complètement de mémoire. Mais l'identité de la personne ne s'est pas perdue avec cet évanouissement progressif du souvenir. Elle repose sur la volonté identique, et sur le caractère immuable que celle-ci présente. C'est cette même volonté qui confère sa persistance à l'expression du regard. L'homme se trouve dans le coeur, non dans la tête. Sans doute par suite de nos relations avec le dehors nous sommes habitués à considérer comme notre moi véritable le sujet de la connaissance, le moi connaissant, qui s'alanguit le soir, s'évanouit dans le sommeil, pour briller le lendemain d'un plus vif éclat. Mais ce moi-là est une simple fonction du cerveau et non notre moi véritable. Celui-ci, ce noyau de notre être, c'est ce qui est caché derrière l'autre, c'est ce qui ne connaît au fond que deux choses : vouloir ou ne pas vouloir, être ou ne pas être content, avec certaines nuances bien entendu de l'expression de ces actes et qu'on appelle sentiments, passions, émotions. C'est ce dernier moi qui produit l'autre, il ne dort pas avec cet autre, et quand celui-ci est anéanti par la mort, son compagnon n'est pas atteint. — Au contraire, tout ce qui relève de la connaissance est exposé à l'oubli : au bout de quelques années nous ne nous rappelons plus exactement celles même de nos actions qui ont une importance morale, nous ne savons plus au juste et par le détail comment nous avons agi dans un cas critique. Mais le caractère, dont les actes ne
Liens utiles
- Un nouveau livre de poche va voir le jour. Dans la série « classique », annonce l'éditeur, « chaque volume sera enrichi d'une trentaine de pages de commentaires : biographie de l'auteur, naissance de l'œuvre, sa place dans l'histoire de la littérature, les jugements qu'elle a suscités... » Prendrez-vous connaissance de tous ces compléments? Pensez-vous qu'ils puissent vous permettre de mieux comprendre l'œuvre et d'en tirer un plaisir accru ou estimez-vous qu'ils risquent de faire écra
- Un nouveau livre de poche va voir le jour. Dans la série « classique », annonce l'éditeur, « chaque volume sera enrichi d'une trentaine de pages de commentaires : biographie de l'auteur, naissance de l'œuvre, sa place dans l'histoire de la littérature, les jugements qu'elle a suscités... » Prendrez-vous connaissance de tous ces compléments? Pensez-vous qu'ils puissent vous permettre de mieux comprendre l'œuvre et d'en tirer un plaisir accru ou estimez-vous qu'ils risquent de faire écra
- Un nouveau livre de poche va voir le jour. Dans la série « Classiques », annonce l'éditeur, « chaque volume sera enrichi d'une trentaine de pages de commentaires : biographie de l'auteur, naissance de l'oeuvre, sa place dans l'histoire de la littérature, les jugements qu'elle a suscités... ». Prendrez-vous connaissance de tous ces compléments ? Pensez-vous qu'ils puissent vous permettre de mieux comprendre l'oeuvre et d'en tirer un plaisir accru ou estimez-vous qu'ils risquent de faire
- "Dans toutes les littératures, les auteurs subjectifs ont été nombreux. Et c'est une vérité élémentaire que de dire qu'en un sens tout écrivain est subjectif, quels que puissent être ses efforts pour éliminer le coefficient personnel dans la peinture qu'il fait des choses et de l'homme. Mais il n'est pas moins vrai que les différences à cet égard sont infiniment graduées, et que les termes extrêmes de l'échec en arrivent à représenter deux fonctions de l'écrivain qui sont presque sans
- Sujet : Le bonheur est-il une succession de plaisir ?