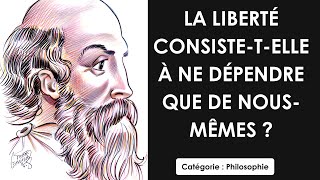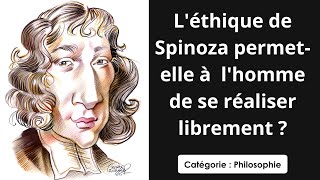Le désir est-il la part animale de l'homme ?
Publié le 26/06/2009
Extrait du document
Etymologiquement, désir dérive de desiderare, composé de de (préfixe privatif) et sidus-eris (astre sidéral, d'où dérive l'adjectif "sidéré"). Il reste de cette structure latine l'expression "désirer la lune...".
Il existe une longue tradition morale qui condamne le désir parce qu'il ramène l'homme à l'état d'animalité. Que ce soit le platonisme, qui le réserve à la classe sociale la plus "basse" dans l'organisation de la République : les artisans ; ou le christianisme, qui y voit un asservissement de l'esprit à la chair, le désir a subi historiquement une longue occultation morale, ainsi qu'une farouche condamnation de la part de l'Église. Il traîne après lui des odeurs de paganisme et de débauche. A l'origine, le désir est le constat d'une absence, doublé d'une idée de regret. De cette "absence regrettée", le sens a évolué vers l'idée positive et prospective de "souhaiter", ou "chercher à obtenir". Le désir manifeste donc à la fois l'absence ("de l'astre"), et l'aspiration, le souhait, de recouvrer cette perte ou ce manque. Il en est venu enfin à désigner la libido ou l'appétence sexuelle, mais il est important toutefois de ne pas le confondre exclusivement avec lui. Bien que lié au "besoin", qui en est peut-être l'origine, il s'en distingue par plusieurs traits : le besoin s'apaise dans la satisfaction, tandis que le désir semble insatiable, passant d'un objet à un autre sans pouvoir disparaître en se niant. Il engendre des rêves et des phantasmes, il est producteur d'images mais il est également doté de sens, à la différence du besoin qui ne vise que la consommation et la satisfaction. On verra enfin qu'il est source de valeurs, tant il est vrai que bien souvent nous ne désirons pas certaines choses parce qu'elles sont bonnes et agréables, mais au contraire, nous les estimons bonnes et agréables parce que nous les désirons, comme l'a montré Spinoza.
Liens utiles
- HOMME DE DÉSIR (L'), Louis Claude de Saint-Martin - étude de l'œuvre
- HOMME ET SON DÉSIR (L’). Darius Milhaud
- HOMME DE DÉSIR (L’). de Louis-Claude de Saint-Martin (résumé)
- Spinoza a dit "le Désir est l'essence même de l'homme".
- Le désir et le besoin chez l'homme