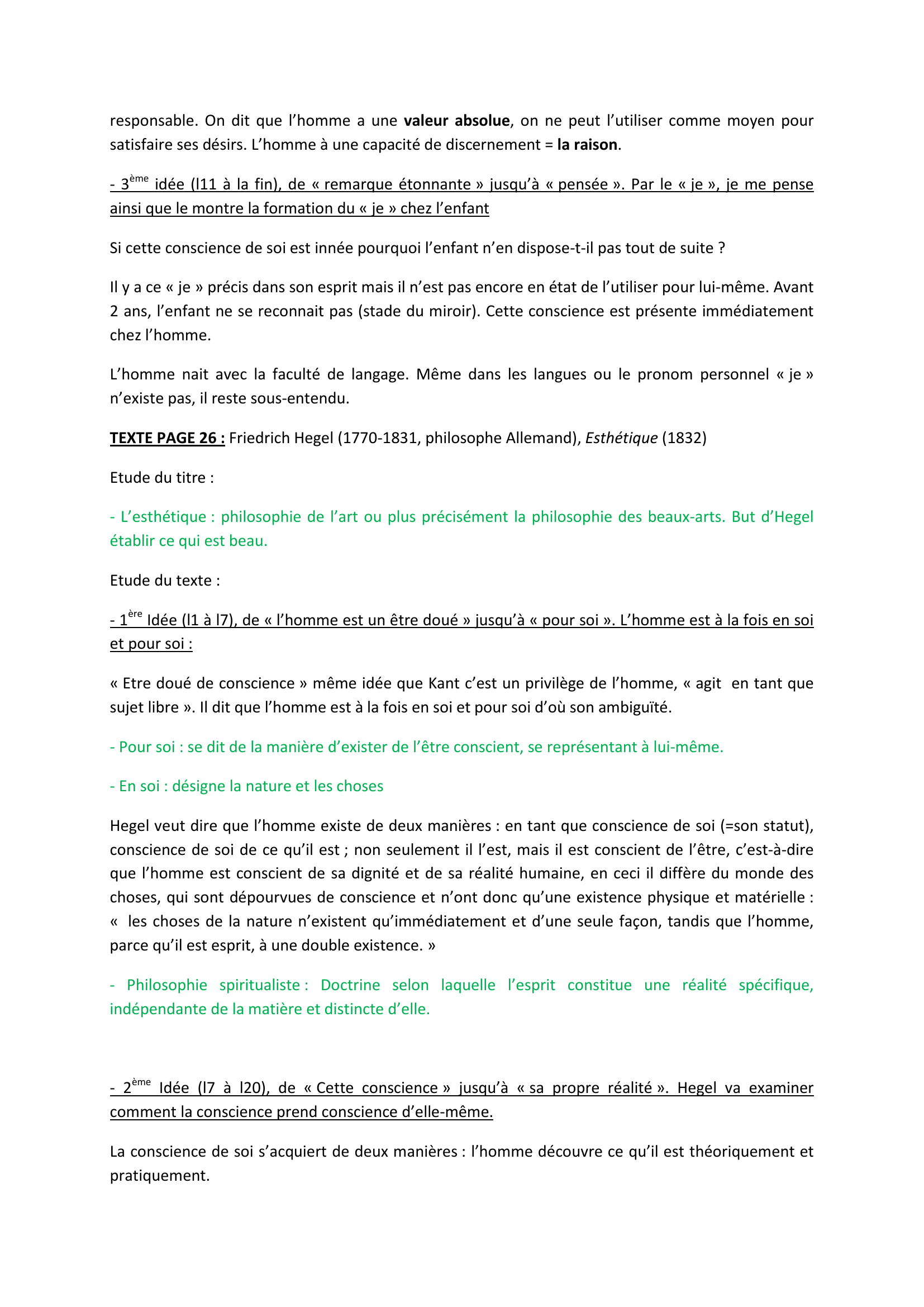THEME : LE SUJET
Publié le 28/01/2012

Extrait du document
Le sujet désigne l’individu singulier et unique qui peut dire « je «, rapporter à soi ses pensées, répondre de ses actes, ce qui suppose la conscience et la liberté. Il a conscience de ce qu’il vit, de ce qu’il fait, de ce qu’il est. Il est donc doté d’une conscience qui lui permet d’accéder directement à son monde intérieur en conséquence il se représente lui-même dans ce qu’il vit à la première personne.
- La conscience : Connaissance +/- claire qu’un sujet possède de ses états, de ses actes et de lui-même.
- La responsabilité : répondre totalement de ses actes, les assumer, et s’en reconnaitre comme l’auteur.
- La liberté : Elle doit être entendue comme pouvoir d’autodétermination. La volonté est à l’origine des choix qui donnent lieu aux actes.
TEXTE PAGE 20 : Emmanuel Kant (1724-1804, philosophe Allemand), Anthropologie du point de vue pragmatique (1798)
Etude du titre : Anthropologie c’est l’étude de l’homme. Pragmatique c’est une réflexion concrète sur l’homme mais qui appelle un prolongement philosophique et une méditation sur l’homme en tant que conscience de soi (=en tant que sujet).
Explication du texte :
-1ère idée (l1 à l6), de « que l’homme puisse « jusqu’à « à sa guise «. La possession du « je « est propre à l’homme :
L’homme se représente dans son esprit. « Puisse disposer « l’homme à une faculté, un pouvoir dont il dispose dans sa nature : c’est une disposition innée. L’homme est un « être vivant « mais il est supérieur d’après le texte par rapport aux autres êtres-vivants car il a une conscience donc il sait ce qu’il est, ce qu’il ressent. L’homme se définit par sa pensée.
- La personne (sens général) : c’est l’être humain conscient, responsable de lui-même et des valeurs morales.
- La personne (chez Kant) : Sujet moral, fin en soi, par opposition à la chose.
L’homme n’est pas une chose mais l’animal si.
- La chose (chez Kant) : Les choses se sont tous les êtres qui appartiennent exclusivement à la sphère de la nature et qui sont dépourvues de conscience par opposition à la personne ou au sujet moral.
- 2ème Idée (l6 à l10), de « et il en est ainsi « jusqu’à « entendement «. Le « je « est une fonction, un acte de l’entendement (=faculté de penser l’homme).
C’est un « je « universel qui est donc dans l’esprit de tout homme. Ce « je « appartient à la structure mentale de l’homme. Seul un homme qui a une conscience morale peut se représenter comme sujet responsable. On dit que l’homme a une valeur absolue, on ne peut l’utiliser comme moyen pour satisfaire ses désirs. L’homme à une capacité de discernement = la raison.
- 3ème idée (l11 à la fin), de « remarque étonnante « jusqu’à « pensée «. Par le « je «, je me pense ainsi que le montre la formation du « je « chez l’enfant
Si cette conscience de soi est innée pourquoi l’enfant n’en dispose-t-il pas tout de suite ?
Il y a ce « je « précis dans son esprit mais il n’est pas encore en état de l’utiliser pour lui-même. Avant 2 ans, l’enfant ne se reconnait pas (stade du miroir). Cette conscience est présente immédiatement chez l’homme.
L’homme nait avec la faculté de langage. Même dans les langues ou le pronom personnel « je « n’existe pas, il reste sous-entendu.
TEXTE PAGE 26 : Friedrich Hegel (1770-1831, philosophe Allemand), Esthétique (1832)
Etude du titre :
- L’esthétique : philosophie de l’art ou plus précisément la philosophie des beaux-arts. But d’Hegel établir ce qui est beau.
Etude du texte :
- 1ère Idée (l1 à l7), de « l’homme est un être doué « jusqu’à « pour soi «. L’homme est à la fois en soi et pour soi :
« Etre doué de conscience « même idée que Kant c’est un privilège de l’homme, « agit en tant que sujet libre «. Il dit que l’homme est à la fois en soi et pour soi d’où son ambiguïté.
- Pour soi : se dit de la manière d’exister de l’être conscient, se représentant à lui-même.
- En soi : désigne la nature et les choses
Hegel veut dire que l’homme existe de deux manières : en tant que conscience de soi (=son statut), conscience de soi de ce qu’il est ; non seulement il l’est, mais il est conscient de l’être, c’est-à-dire que l’homme est conscient de sa dignité et de sa réalité humaine, en ceci il diffère du monde des choses, qui sont dépourvues de conscience et n’ont donc qu’une existence physique et matérielle : « les choses de la nature n’existent qu’immédiatement et d’une seule façon, tandis que l’homme, parce qu’il est esprit, à une double existence. «
- Philosophie spiritualiste : Doctrine selon laquelle l’esprit constitue une réalité spécifique, indépendante de la matière et distincte d’elle.
- 2ème Idée (l7 à l20), de « Cette conscience « jusqu’à « sa propre réalité «. Hegel va examiner comment la conscience prend conscience d’elle-même.
La conscience de soi s’acquiert de deux manières : l’homme découvre ce qu’il est théoriquement et pratiquement.
« Cogito théorique « : il s’agit de retour sur elle-même de la pensée.
Observation de la conscience par elle-même que l’on nomme introspection psychologique (= mode d’appréhension directe de ses états de conscience par un sujet, rendu possible par la présence à soi de la conscience ce qui rend possible une connaissance de soi par soi) « il doit se pencher sur lui-même « jusqu’à « comme essence « dans ce moment d’introspection on est à la fois observateur et observé.
« Cogito pratique « : De prendre conscience de soi par l’action.
On observe ce qu’on a fait, on y voit ce qu’on est à l’extérieur de soi et on en éprouve une satisfaction. Le besoin de transformer le monde s’explique par le désir qu’a toute conscience de manifester ce qu’elle est à l’extérieur d’elle-même pour s’y reconnaitre, et être reconnue par les autres. C’est par le travail et l’art que la conscience s’extériorise et se donne une sorte de permanence qui la sauve de sa fragilité psychologique.
On comprend que pour Hegel se connaître soi-même, attendre la vérité de soi implique un dépassement de l’introspection, de l’observation de la conscience par elle-même. En agissant l’homme extériorise son « moi « et marque le monde de la forme du sujet.
La conscience, ce « pour soi « devient alors un « en soi « une chose ou plus exactement « un en soi pour soi «, ce qui veut dire que la conscience communique aux objets sa structure. L’homme se définit par sa culture.
«
responsable.
On dit que l’homme a une valeur absolue, on ne peut l’utiliser comme moyen pour
satisfaire ses désirs.
L’homme à une capacité de discernement = la raison.
- 3 ème idée (l11 à la fin), de « remarque étonnante » jusqu’à « pensée ».
Par le « je », je me pense
ainsi que le montre la formation du « je » chez l’enfant
Si cette conscience de soi est innée pourquoi l’enfant n’en dispose -t -il pas tout de suite ?
Il y a ce « je » précis dans son esprit mais il n’est pas encore en état de l’ utiliser pour lui-même.
Avant
2 ans, l’enfant ne se reconnait pas (stade du miroir).
Cette conscience est présente immédiatement
chez l’homme.
L’homme nait avec la faculté de langage.
Même dans les langues ou le pronom personnel « je »
n’existe pas, il re ste sous-entendu.
TEXTE PAGE 2 6 : Friedrich Hegel (1770 -1831, philosophe Allemand), Esthétique (1832)
Etude du titre :
- L’esthétique : philosophie de l’art ou plus précisément la philosophie des beaux -arts.
But d ’Hegel
établir ce qui est beau.
Etude du texte :
- 1 ère Idée (l1 à l7) , de « l’homme est un être doué » jusqu’à « pour soi » .
L’homme est à la fois en soi
et pour soi :
« Etre doué de conscience » même idée que Kant c’est un privilège de l’homme, « agit en tant que
sujet libre ».
Il dit que l’homme est à la fois en soi et pour soi d’où son ambiguïté.
- Pour soi : se dit de la manière d’exister de l’être conscient, se re présentant à lui-même.
- En soi : désigne la nature et les choses
Hegel veut dire que l’homme existe de deux manières : en tant que conscience de soi (=son statut),
conscience de soi de ce qu’il est ; non seulement il l’est , mais il est conscient de l’êtr e, c’est -à -dire
que l’homme est conscient de sa dignité et de sa réalité humaine, en ceci il diffère du monde des
choses, qui sont dépourvues de conscience et n’ont donc qu’une existence physique et matérielle :
« les choses de la nature n’existent qu’imm édiatement et d’une seule façon, tandis que l’homme,
parce qu’il est esprit, à une double existence.
»
- Philosophie spiritualiste : Doctrine selon laquelle l’esprit constitue une réalité spécifique,
indépendante de la matière et distincte d’elle.
- 2 èm e Idée (l7 à l20), de « Cette conscience » jusqu’à « sa propre réalité ».
Hegel va examiner
comment la conscience prend conscience d’elle -même.
La conscience de soi s’acquiert de deux manières : l’homme découvre ce qu’il est théoriquement et
pratiquement..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- EXPOSE THEME : La polygamie dans sous l’orage
- N°15 DROIT PRIVE THEME N°4 : Cas pratique - gérance
- ANTHROPOLOGIE POLITIQUE ET SOCIALE. THEME : LE MOUVEMENT ALMORAVIDE ENTRE ECONOMIE ET RELIGION.
- THEME 1 : La Terre, la vie et l’organisation du vivant Partie A : Génétique et évolution Chapitre 1 : L’origine du génotype des individus
- THEME 4 : IDENTIFIER, PROTEGER ET VALORISER LE PATROMOINE : ENJEUX GEOPOLITIQUES