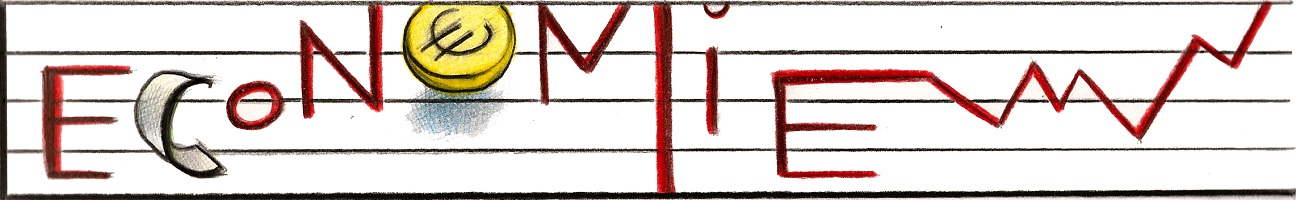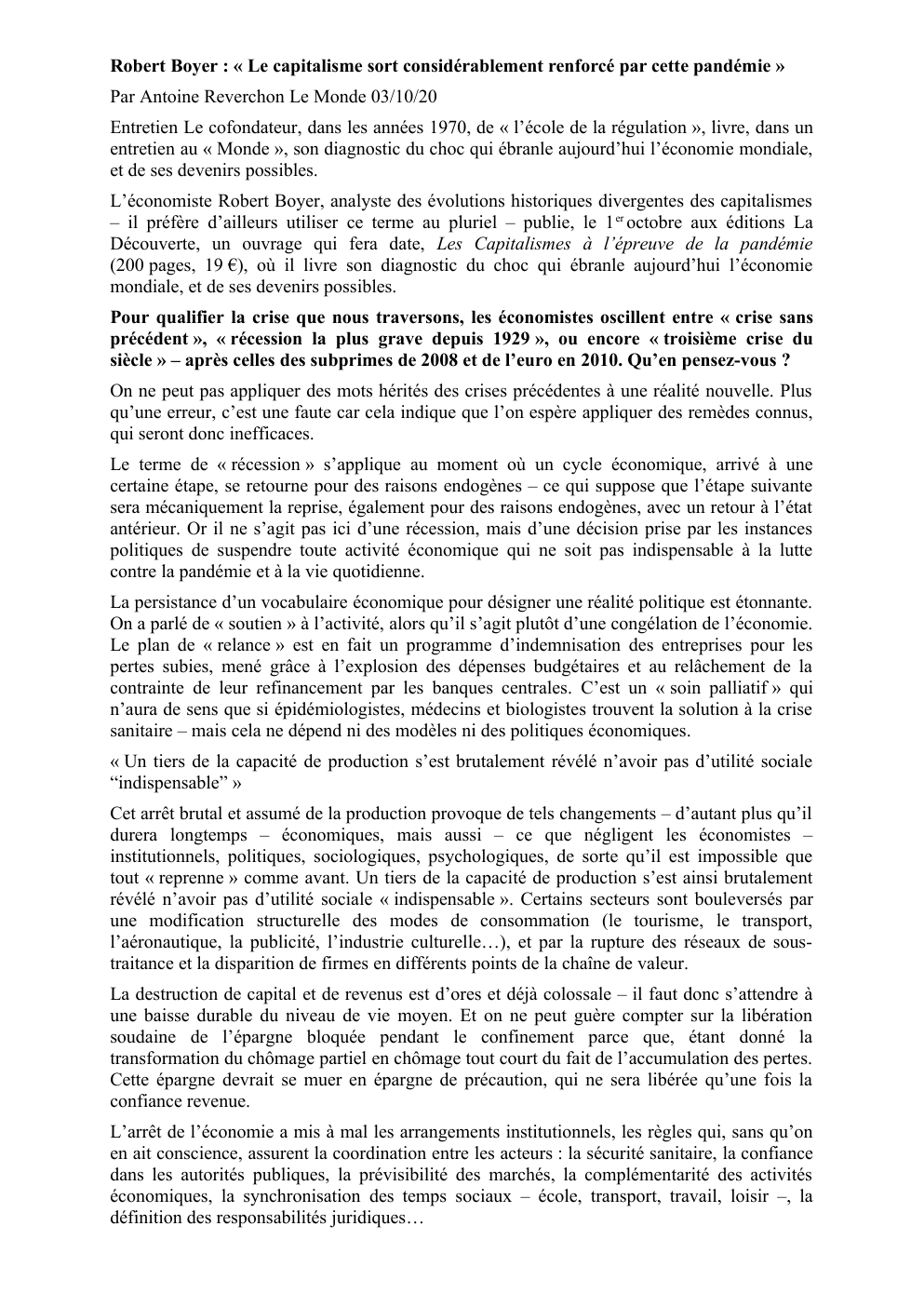Capitalisme et crise COVID
Publié le 29/10/2023
Extrait du document
«
Robert Boyer : « Le capitalisme sort considérablement renforcé par cette pandémie »
Par Antoine Reverchon Le Monde 03/10/20
Entretien Le cofondateur, dans les années 1970, de « l’école de la régulation », livre, dans un
entretien au « Monde », son diagnostic du choc qui ébranle aujourd’hui l’économie mondiale,
et de ses devenirs possibles.
L’économiste Robert Boyer, analyste des évolutions historiques divergentes des capitalismes
– il préfère d’ailleurs utiliser ce terme au pluriel – publie, le 1 er octobre aux éditions La
Découverte, un ouvrage qui fera date, Les Capitalismes à l’épreuve de la pandémie
(200 pages, 19 €), où il livre son diagnostic du choc qui ébranle aujourd’hui l’économie
mondiale, et de ses devenirs possibles.
Pour qualifier la crise que nous traversons, les économistes oscillent entre « crise sans
précédent », « récession la plus grave depuis 1929 », ou encore « troisième crise du
siècle » – après celles des subprimes de 2008 et de l’euro en 2010.
Qu’en pensez-vous ?
On ne peut pas appliquer des mots hérités des crises précédentes à une réalité nouvelle.
Plus
qu’une erreur, c’est une faute car cela indique que l’on espère appliquer des remèdes connus,
qui seront donc inefficaces.
Le terme de « récession » s’applique au moment où un cycle économique, arrivé à une
certaine étape, se retourne pour des raisons endogènes – ce qui suppose que l’étape suivante
sera mécaniquement la reprise, également pour des raisons endogènes, avec un retour à l’état
antérieur.
Or il ne s’agit pas ici d’une récession, mais d’une décision prise par les instances
politiques de suspendre toute activité économique qui ne soit pas indispensable à la lutte
contre la pandémie et à la vie quotidienne.
La persistance d’un vocabulaire économique pour désigner une réalité politique est étonnante.
On a parlé de « soutien » à l’activité, alors qu’il s’agit plutôt d’une congélation de l’économie.
Le plan de « relance » est en fait un programme d’indemnisation des entreprises pour les
pertes subies, mené grâce à l’explosion des dépenses budgétaires et au relâchement de la
contrainte de leur refinancement par les banques centrales.
C’est un « soin palliatif » qui
n’aura de sens que si épidémiologistes, médecins et biologistes trouvent la solution à la crise
sanitaire – mais cela ne dépend ni des modèles ni des politiques économiques.
« Un tiers de la capacité de production s’est brutalement révélé n’avoir pas d’utilité sociale
“indispensable” »
Cet arrêt brutal et assumé de la production provoque de tels changements – d’autant plus qu’il
durera longtemps – économiques, mais aussi – ce que négligent les économistes –
institutionnels, politiques, sociologiques, psychologiques, de sorte qu’il est impossible que
tout « reprenne » comme avant.
Un tiers de la capacité de production s’est ainsi brutalement
révélé n’avoir pas d’utilité sociale « indispensable ».
Certains secteurs sont bouleversés par
une modification structurelle des modes de consommation (le tourisme, le transport,
l’aéronautique, la publicité, l’industrie culturelle…), et par la rupture des réseaux de soustraitance et la disparition de firmes en différents points de la chaîne de valeur.
La destruction de capital et de revenus est d’ores et déjà colossale – il faut donc s’attendre à
une baisse durable du niveau de vie moyen.
Et on ne peut guère compter sur la libération
soudaine de l’épargne bloquée pendant le confinement parce que, étant donné la
transformation du chômage partiel en chômage tout court du fait de l’accumulation des pertes.
Cette épargne devrait se muer en épargne de précaution, qui ne sera libérée qu’une fois la
confiance revenue.
L’arrêt de l’économie a mis à mal les arrangements institutionnels, les règles qui, sans qu’on
en ait conscience, assurent la coordination entre les acteurs : la sécurité sanitaire, la confiance
dans les autorités publiques, la prévisibilité des marchés, la complémentarité des activités
économiques, la synchronisation des temps sociaux – école, transport, travail, loisir –, la
définition des responsabilités juridiques…
La stratégie économique guidée par l’idée qu’il s’agit d’une récession – et qu’il suffit donc de
maintenir ce qui reste de l’économie en l’état, puis de relancer l’activité pour revenir à la
situation antérieure (la fameuse reprise en « V ») – est de ce fait vouée à l’échec.
L’année
2020 pourrait rester dans l’histoire non pas seulement comme celle d’un choc économique du
fait des pertes, colossales, de PIB et de la paupérisation de fractions importantes de la société,
mais encore comme le moment où des régimes socio-économiques, incapables d’assurer les
conditions de leur reproduction, ont atteint leurs limites.
Il n’y aura de « sortie de crise » que
lorsque la transformation structurelle de l’économie qui est en train de se dérouler sous nos
yeux sera suffisamment avancée.
Une transformation vers une économie plus respectueuse de l’environnement, moins
inégalitaire ?
Pas du tout, hélas ! Je n’entends pas participer au jeu concours du « jour d’après », où chaque
spécialiste qui pointe tel ou tel défaut du système propose de le corriger : moins d’inégalités
par la hausse de la fiscalité et de la dépense publique, plus d’écologie par une stratégie
affirmée et cohérente de protection du climat et de la biodiversité, plus d’innovation grâce à la
« destruction créatrice » des activités obsolètes, plus de compétitivité en abaissant les impôts
de production, etc.
Contrairement au mythe d’une table rase qui serait créée par une situation
« sans précédent », cette recomposition est déjà à l’œuvre.
La pandémie n’a fait que la
renforcer.
Alors de quelle transformation s’agit-il ?
La « congélation » de l’économie a accéléré le déversement de valeur entre des industries en
déclin et une économie de plates-formes en pleine croissance – pour faire image, le passage
de l’ingénieur de l’aéronautique au livreur d’Amazon.
Or cette économie offre une très faible
valeur ajoutée, un médiocre niveau de qualification à la majorité de ceux qui y travaillent, et
génère de très faibles gains de productivité.
J’ai longtemps pensé que ces caractéristiques
allaient déboucher sur une crise structurelle du capitalisme, mais je reconnais aujourd’hui que
je me suis trompé.
Les acteurs de cette économie de plate-forme, les GAFA [Google, Apple, Facebook,
Amazon], bien plus que l’investissement « vert », captent les rentes du capitalisme financier,
le sauvant ainsi de ses errements antérieurs, qui l’avaient conduit du krach des start-up du
numérique, en 2000, au krach de l’immobilier, en 2008.
Pendant que les écologistes
interdisent les sapins de Noël, les GAFA investissent dans l’avenir.
Bref, le capitalisme n’est
pas du tout en crise, il sort même considérablement renforcé par cette pandémie.
Mais l’économie de plates-formes renforce les inégalités économiques.
Les start-up
innovantes, les industries et les services traditionnels vont souffrir considérablement.
Les
plates-formes n’offrent que des rémunérations médiocres à ceux qui – à part leurs salariés,
peu nombreux, et bien sûr leurs actionnaires – travaillent pour elles.
Les GAFA ne se
préoccupent ni de la production ni de l’amélioration des qualifications – ils agissent en
prédateurs sur le marché des compétences, à l’échelle transnationale.
La pandémie, le
confinement et les mesures de « soutien » à l’économie n’ont fait que renforcer ces
phénomènes : hausse du sous-emploi, perte de revenus des moins qualifiés, élargissement du
fossé numérique tant entre les entreprises qu’entre les individus, inégalité d’accès à l’école.
Les « perdants » de cette économie, et ils sont nombreux, sont ainsi poussés à se tourner vers
les Etats, seuls capables de les protéger de la misère et du déclassement face à la toutepuissance des firmes transnationales du numérique et de la finance – mais aussi réhabilités
dans leurs fonctions régaliennes et régulatrices par la « magie » de la pandémie.
La puissance
des GAFA produit donc sa contrepartie dialectique : la poussée de différents capitalismes
d’Etat prêts à défendre leurs prérogatives – et leurs propres entreprises – derrière leurs
frontières, dont le modèle le plus achevé est la Chine.
La concurrence croissante entre ces deux formes de capitalisme est un facteur de
déstabilisation des relations internationales, comme le montre la rivalité entre la Chine et les
Etats-Unis, encore exacerbée par la crise du Covid-19 et dont il est impossible, à ce stade, de
prévoir l’issue.
La consolidation de pouvoirs économiques en pouvoirs politiques – impériaux ou nationaux –
pourrait faire voler en éclats les tentatives de gestion multilatérale des relations internationales
– alors que la pandémie a démontré une fois de plus la nécessité d’une gestion mondiale des
questions sanitaires, par exemple.
Cette montée de ce qu’on appelle les « populismes » peut
aussi faire avorter les projets de coordination régionale comme l’Union européenne au profit
d’un éclatement d’Etats souverains avides de « reprendre le contrôle », comme le proclame
Boris Johnson, aidé en cela par toute la panoplie des outils numériques.
On aurait ainsi le
« choix », si j’ose dire, entre un pouvoir numérique exercé par des multinationales, et un
pouvoir numérique exercé par des Etats souverains rivaux.
Mais là encore, comme le montre l’incertitude sur l’élection américaine du 3 novembre,
l’histoire n’est pas écrite.
Il se peut aussi que des coalitions politiques obtiennent le
démantèlement du monopole des GAFA, comme ce fut....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'altermondialisme et la crise du capitalisme
- Les acteurs financiers, aveuglés par leur fondamentalisme de marché n'ont pas vu venir la crise. L'incapacité des marchés à retrouver eux-mêmes un équilibre a poussé les autorités publiques à intervenir. Comment les États ont-ils sauvé le capitalisme financier ?
- gestion du covid en suède
- Le théâtre a-t-il pour fonction de tout dire, de tout expliquer au spectateur de la crise que vivent les personnages? - Par quels moyens et quelles fonctions Juste la Fin du monde est une pièce qui nous retrace la crise de cette famille?
- La crise économique de 29