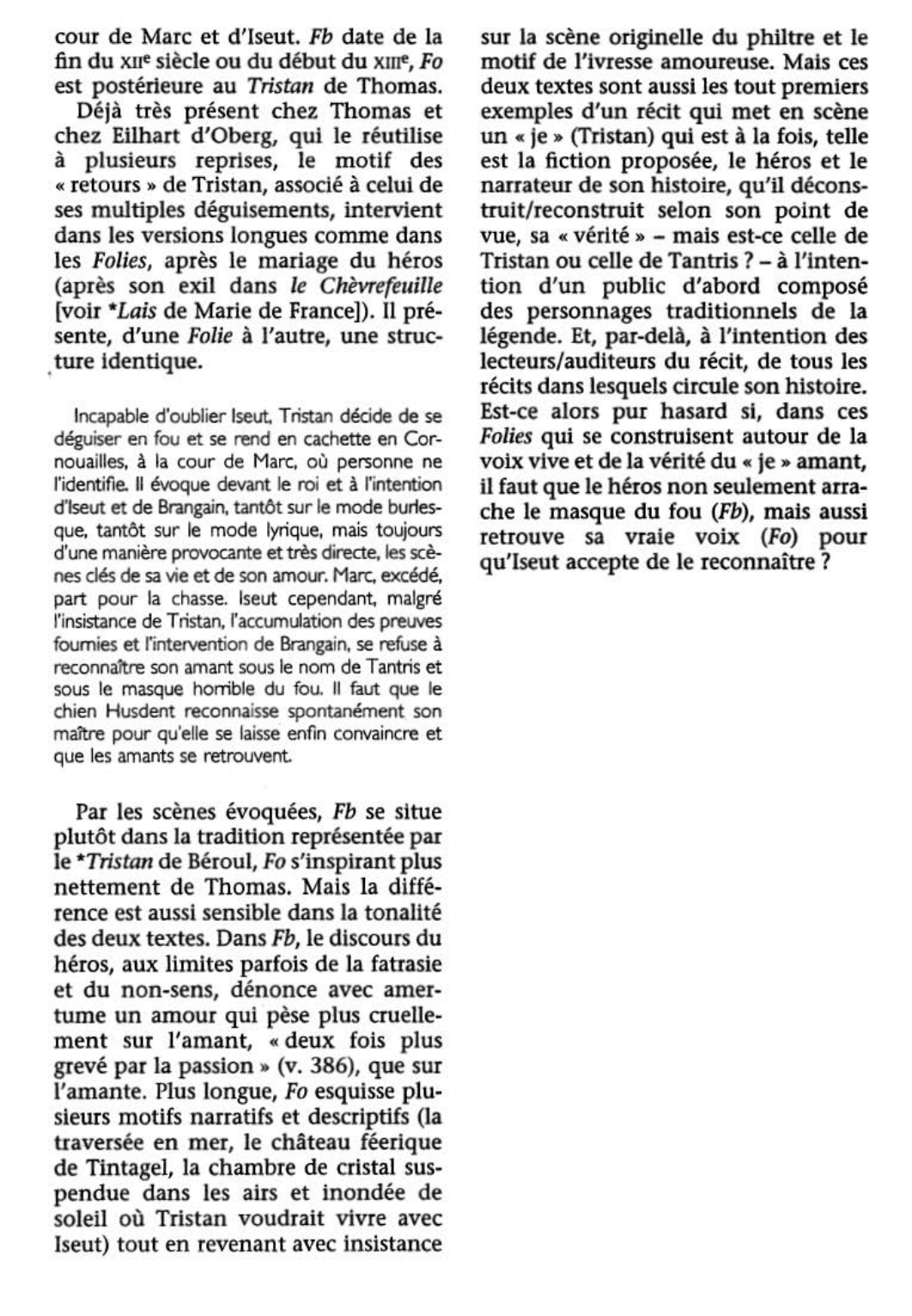FoLIes Tristan (résume et analyse complète)
Publié le 24/10/2018

Extrait du document
FoLIes Tristan. On appelle ainsi deux brefs récits anonymes, conservés l'un dans un manuscrit de la bibliothèque de Berne (la Folie de Berne ou Fb, 584 vers), l'autre, à la suite de fragments du Tristan de Thomas (Folie d'Oxford ou Fo, 998 vers), et relatant un retour de Tristan déguisé en fou à la cour de Marc et d'Iseut. Fb date de la fin du xiie siècle ou du début du xiiie, Fo est postérieure au Tristan de Thomas.
Déjà très présent chez Thomas et chez Eilhart d'Oberg, qui le réutilise à plusieurs reprises, le motif des « retours » de Tristan, associé à celui de ses multiples déguisements, intervient dans les versions longues comme dans les Folies, après le mariage du héros (après son exil dans le Chèvrefeuille [Lais de Marie de France]). Il présente, d'une Folie à l'autre, une structure identique.
Incapable d'oublier Iseut Tristan décide de se déguiser en fou et se rend en cachette en Cor-nouailles, à la cour de Marc, où personne ne l'identifie II évoque devant le roi et à l'intention d'Iseut et de Brangain, tantôt sur le mode burlesque, tantôt sur le mode lyrique, mais toujours d'une manière provocante et très directe, les scènes clés de sa vie et de son amour. Marc, excédé, part pour la chasse. Iseut cependant malgré l’insistance de Tristan, l’accumulation des preuves fournies et l'intervention de Brangain, se refuse à reconnaître son amant sous le nom de Tantris et sous le masque horrible du fou. Il faut que le chien Husdent reconnaisse spontanément son maître pour qu'elle se laisse enfin convaincre et que les amants se retrouvent.
Par les scènes évoquées, Fb se situe plutôt dans la tradition représentée par le Tristan de Béroul, Fo s'inspirant plus nettement de Thomas. Mais la différence est aussi sensible dans la tonalité des deux textes. Dans Fb, le discours du héros, aux limites parfois de la fatrasie et du non-sens, dénonce avec amertume un amour qui pèse plus cruellement sur l'amant, « deux fois plus grevé par la passion » (v. 386), que sur l'amante. Plus longue, Fo esquisse plusieurs motifs narratifs et descriptifs (la traversée en mer, le château féerique de Tintagel, la chambre de cristal suspendue dans les airs et inondée de soleil où Tristan voudrait vivre avec Iseut) tout en revenant avec insistance sur la scène originelle du philtre et le motif de l'ivresse amoureuse. Mais ces deux textes sont aussi les tout premiers exemples d'un récit qui met en scène un « je » (Tristan) qui est à la fois, telle est la fiction proposée, le héros et le narrateur de son histoire, qu'il déconstruit/reconstruit selon son point de vue, sa « vérité » - mais est-ce celle de Tristan ou celle de Tantris ? - à l'intention d'un public d'abord composé des personnages traditionnels de la légende. Et, par-delà, à l'intention des lecteurs/auditeurs du récit, de tous les récits dans lesquels circule son histoire. Est-ce alors pur hasard si, dans ces Folies qui se construisent autour de la voix vive et de la vérité du « je » amant, il faut que le héros non seulement arrache le masque du fou (Fb), mais aussi retrouve sa vraie voix (Fo) pour qu'Iseut accepte de le reconnaître ?
«
cour de Marc et d'Iseut .
Pb date de la
fin du xne siècle ou du début du xmt', Po
est postérieure au Tristan de Thomas.
D éjà très présent chez Thoma s et
chez Eilhart d'Oberg, qui le réutilise
à plusie urs repr ises, le motif d
es « retours » de Tri stan, associé à celu i de
ses multiples déguisem
en ts, intervient
dans les versions longues comme dans
le s
Folies, après le mariage du héros
(ap rès
son exil dans le C hèvr efeuille
[voir *L ai s de Mari e de Fran ce]) .
Il pré
sente,
d'une Folie à l'autre , un e struc
.
tur e ide ntique.
Incapable d'oublier Iseut Tristan décide de se déguiser en fou et se rend en cachette en Cor nouailles, à la cour de Marc, où personne ne l'îdentifie.
Il évoque devant le roi et à l'intention d'Iseut et de Brangain, tantôt sur le mode burles que, tantô t sur le mode lyrique, ma is toujours
d'une manière provocante et très directe.
les scè nes clés de sa vie et de son amour.
Marc.
excédé, part pour la chasse .
Iseut cependa nt.
malgré l'insistance de Tristan, l'accumulation des prewes fournies et l'intervent io n de Branga in, se refuse à reconna?tre son amant sous le nom de Tantris et sous le masque honible du fou .
Il faut que le chien Husdent reconna isse spontanément son ma?tre pour qu'elle se laisse enfin convai ncre et que les amants se retrouvent
Par le s scènes évoquées, Fb se situe
plutôt dans la traditi
on représentée par
le *Tristan de Bérou l, Fo s'insp irant plus
nettemen t de Thomas.
Mais la diffé
rence est aussi sensible dans la tonalité
d es deux text
es.
Dans Fb, le discours du
héros, a
ux limites parfoi s de la fatrasie
e t
du non -sens, dénonce avec amer
tume un am our qu i pèse plus cruelle
men t sur l'amant , « deu x fois plus
grevé par la passion
» (v.
386), que sur
l'ama nte.
Plus longue, Po esquisse plu
s ie urs motifs narratifs et descriptifs (l a
trave rsée en me r, le châ t eau féeriq ue
d e Tintagel, la chambre de c ristal sus
pendue dans les air s
et inondée de
so leil où Trista n voudr ait vivre avec
Iseut)
tout en revenant avec insistance sur
la scè n e o riginell e
du philtre et le
motif de l'ivres se amo ur eu s e.
Ma is ces
deux textes sont aussi les
tout premiers
exemples d'
un ré cit qui m et en sc ène
un • je » (Tris tan) qui est à la fol s, telle
est la fiction proposée, le hér os et le
narrat eur de son
histoire , qu'il décons
truit /reconstru it se lo n son point de
vue , sa
« vérité » -mais est-ce celle de
T ris tan ou celle de Tan tris
? - à l'inten
tion d'un public d'abord composé
des personnages traditionnels de la
légende.
Et, par-del
à, à l 'i ntenti on des
lecteu rs/a udite urs du
récit, de tou s le s
récit s dans lesq uels circule son
histoir e.
Est-ce alors pur hasa rd si,
dan s ces
Fol ies qui se construise nt autour de la
voix vive et de la vé rité du « je ,.
amant ,
il faut que le hé ros non seulement arra
che le masque
du fou (Pb) , mais aussi
retrouve sa vraie voix
(Po) pour
qu'Iseu t accep te de le reconnaître 7.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- CHIEN JAUNE (le). Roman de Georges Simenon (résume et analyse complète)
- La Nausée 1938 Jean-Paul Sartre (résume et analyse complète)
- Illusion comique (L') de Pierre Corneille (résume et analyse complète)
- D'UN CHÂTEAU L'AUTRE de Louis-Ferdinand Céline (résume et analyse complète)
- Rue des Boutiques Obscures 1978 Patrick Modiano (résume et analyse complète)