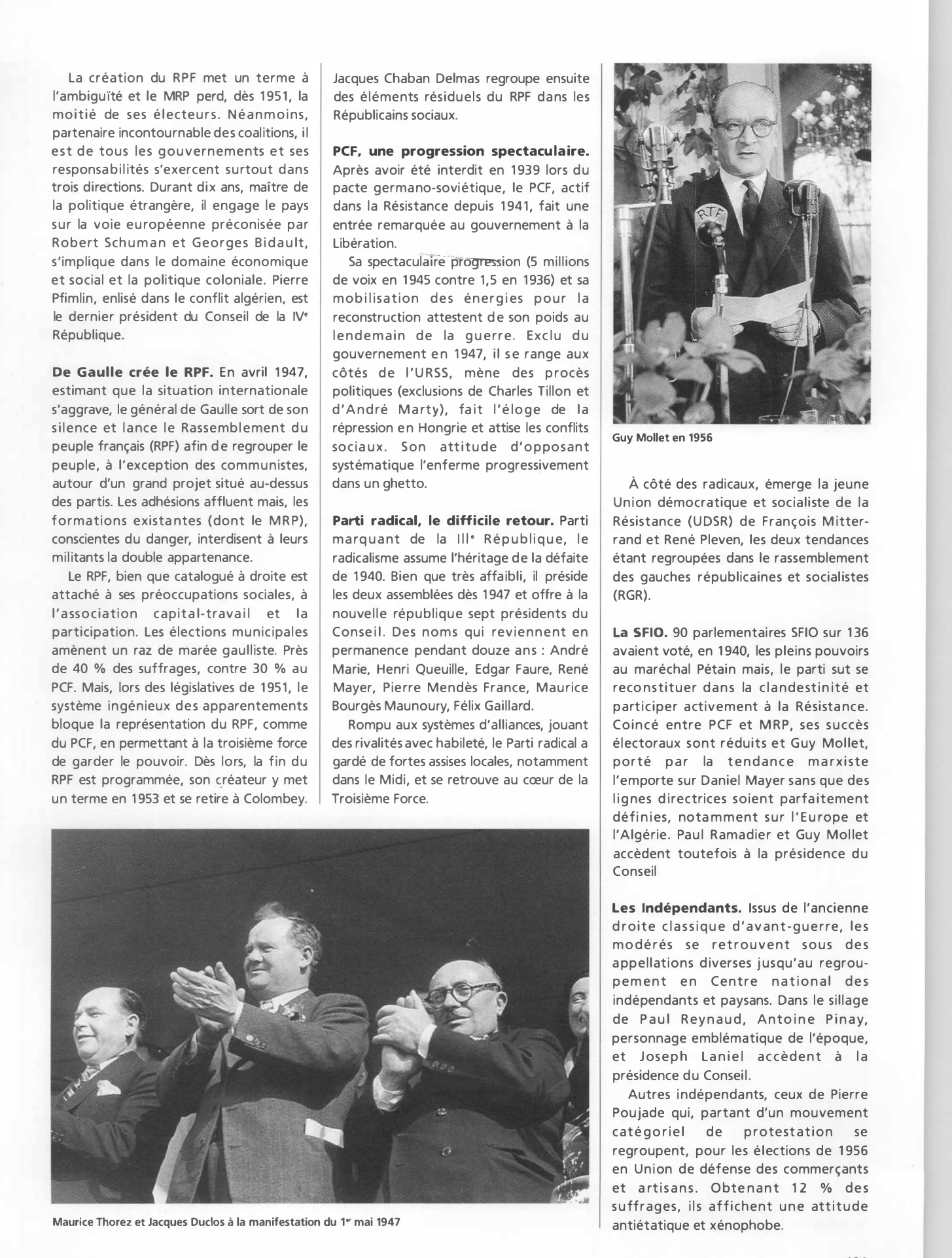Le régime des partis, la valse des ministères, la faiblesse de l'exécutif entraînent la IVe République à sa perte
Publié le 26/03/2019

Extrait du document
Le régime des partis, la valse des ministères, la faiblesse de l'exécutif entraînent la IVe République à sa perte
Un président sans pouvoirs, une Assemblée nationale toute puissante, des partis qui se coalisent pour gouverner malgré des intérêts divergents, tels sont les vices de fonctionnement de la République des partis qui tente, cependant, durant douze ans, de diriger la France avec 22 gouvernements différents. Contrairement aux précédentes, la IVe République n'a jamais été proclamée.
Régime des partis, instabilité ministérielle, faiblesse de l'exécutif, valse des gouvernements, autant de qualificatifs peu élogieux pour désigner cette IV' République mal aimée. Tombant sous la vindicte des électeurs, sombrant à cause de son impuissance à résoudre les événements d'Algérie, elle est victime de la faiblesse de ses institutions qui accordent à l'Assemblée nationale un contrôle paralysant sur le gouvernement. Si l'on ajoute le scrutin proportionnel, responsable d'un poids excessif des petites formations politiques, la recette est complète, garantissant la paralysie de l'État sous les yeux d'un Président condamné à << inaugurer les chrysanthèmes >>.
Maîtres du jeu politique de 1947 à 1958, les partis politiques, incapables de mettre en sourdine leurs querelles d'intérêts, ne peuvent se consacrer pleinement à la résolution des terribles difficultés auxquelles est confronté le pays. Les présidents du Conseil des 22 gouvernements successifs, réduits à un rôle de médiateur entre ministres, partis et groupes de pression, ne peuvent engager des politiques novatrices et efficaces à long terme. Les hommes les plus courageux, de Pierre Mendès France à Antoine Pinay, sont ainsi les victimes d'un système coupable d'abandonner les dirigeants qu'il avait soutenus la veille.
Les partis, dès 1947, reprennent leurs mauvaises habitudes d'avant-guerre. Après une période de tripartisme, les forces en présence de la IV' République se répartissent entre un front du refus et une troisième force. Le front est composé, à gauche, par le Parti communiste et à droite, même s'il refuse un tel positionnement, par le RPF. Entre les deux, dans la troisième force, une mouvance de partis s'étend du centre-droit (MRP) au socialisme en passant parles indépendants et les radicaux. Autant de formations aux intérêts divergents condamnées à gouverner ensemble selon les termes d'Henri Queuille.
Pourtant, si les majorités s'usent, se font et se défont selon un rythme stupéfiant, c'est le même groupe d'hommes politiques qui gouverne. Les ministres changent de portefeuille au gré des coalitions mais finissent par former une équipe ! Il n'est pas rare de compter une dizaine d'attributions différentes pour un même homme durant cette période.
Cette ronde incessante des ministres présente de graves inconvénients. À l'extérieur, le manque d'autorité de l'État et l'instabilité chronique enlèvent toute crédibilité à la politique française et la diplomatie s'en trouve affectée. Autre victime de cette absence de cohérence, les finances. Seule, la présence rassurante d'Antoine Pinay met un terme aux dévaluations mal maîtrisées, à la fuite des capitaux et à la faiblesse de la monnaie.
«
1 La
création du RPF met un terme à
l'ambigu ïté et le MRP perd, dès 1951, la
moitié de ses électe urs.
Néanmoi ns,
partenaire incontournable des coal itions, il
est de tous les gouvernemen ts et ses
responsa bilités s'exercent surtout dans
trois directions.
Durant dix ans, maître de
la politique étrangère, il engage le pays
sur la voie européenne préconisée par
Rober t Sch uman et Georges Bidault,
s'implique dans le domaine économique
et social et la politique coloniale.
Pierre
pfi mlin, enlisé dans le conflit algérien, est
le dernier président du Conseil de la IV'
République.
De Gaulle crée le RPF.
En avril 1947,
estimant que la situation internationale
s'aggr ave, le général de Gaulle sort de son
sile nce et lance le Rasse mblement du
peuple français (RPF) afin de regrouper le
peuple, à l'e xception des communi stes,
autour d'un grand projet situé au-de ssus
des partis.
Les adhésions affluent mais, les
formations existantes (dont le MRP).
conscientes du danger , interdisent à leurs
mil itants la double appartenance.
Le RPF, bien que catalogué à droite est
attaché à ses préoccupations sociales, à
l'as sociation capital-trava il et la
participation.
Les élections municipale s
amènent un raz de mar ée gaull iste.
Près
de 40 % des suffrages, contre 30 % au
PCF.
Mais, lors des légis latives de 1951, le
système ingénieux des apparentements
bloque la représentation du RPF, comme
du PCF, en permettant à la troisième force
de garder le pouvoir.
Dès lors, la fin du
RPF est programmée, son c;réateur y met
un terme en 1953 et se retire à Colombey.
Jacques
Chaban Delmas regroupe ensuite
des élémen ts résiduels du RPF dans les
Républicains sociaux.
PCF, une progression spectaculaire.
Après avoir été interdit en 1939 lors du
pacte germa no-sovi étique, le PCF, actif
dans la Résistance depuis 1941, fait une
entrée remarquée au gouvernement à la
Libération.
Sa spect acul�ion (5 milli ons
de voix en 1945 contre 1,5 en 1936) et sa
mo bilisation des énerg ies pour la
recons truction attestent de son poids au
lendemain de la guerre.
Exclu du
gouvernement en 1947, il se range aux
côtés de l'URSS, mène des procès
politiques (exclusions de Charles Tillon et
d' Andr é Mar ty), fait l'éloge de la
répression en Hongrie et attise les conflits
so cia ux.
Son attitude d'opposant
sys tématique l'enferme progressivement
dans un ghetto.
Parti radical, le difficile retour.
Parti
mar quant de la Ill' Républi que, le
radicalisme assume l'héritage de la défaite
de 1940.
Bien que très affaibli, il préside
les deux assemblées dès 1947 et offre à la
nouv elle république sept présidents du
Cons eil.
Des noms qui reviennen t en
permanence pendant douze ans : André
Ma rie, Henri Queuille, Edgar Faure, René
Mayer, Pierre Mendè s Franc e, Mau rice
Bourgès Maunour y, Félix Gaillar d.
Rompu aux systèmes d'allian ces, jouant
des rivalités avec habileté, le Parti radical a
gardé de fortes assises locales, notamment
dans le Midi, et se retrouve au cœur de la
Troisième Force.
Maurice Thorez et Jacques Duclos à la man ifestation du 1• mai 1947 Guy
Mollet en 1956
À côté des radic aux, émerge la jeune
Uni on démocratique et socialiste de la
Résistance (UDSR) de François Mitter
rand et René Pleven, les deux tendanc es
étant regroupées dans le rassemblement
des gauches républicaines et social istes
(RGR).
La SFIO.
90 parlementai res SFIO sur 136
avaient voté, en 1940, les pleins pouvoirs
au maréchal Pétain mais, le parti sut se
reco nstituer dans la cla ndes tinité et
par ticip er activemen t à la Résis tance.
Coincé entre PCF et MR P, ses succès
éle ctoraux sont réduits et Guy Mol let,
porté par la tendance marxiste
l'emp orte sur Daniel Mayer sans que des
lig nes directrices soient parfaitemen t
défi nies, nota mment sur l'Europe et
l'Algérie.
Paul Ramadier et Guy Mollet
accèdent toutefois à la présidence du
Conseil
Les Indépendants.
Issus de l'ancienne
dr oite classique d'avant-guerr e, les
modér és se retrouvent sous des
ap pella tions diverses jusqu'au regrou
pement en Centre national des
indép endants et paysans.
Dans le sillage
de Paul Reynaud, Antoine Pinay,
personnage emblématique de l'époque,
et Joseph Laniel accèdent à la
présidence du Consei l.
Autres indépenda nts, ceux de Pierre
Poujade qui, partant d'un mouvement
cat égoriel de protestation se
regroupent, pour les élections de 1956
en Union de défense des commerçants
et artisans.
Obtenant 12 % des
suf frag es, ils affichent une attitude
antiétatique et xénophobe.
191.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La valse des gouvernements sous la IVe République
- La IVe République, un régime instable
- Quel est le rôle d'un premier ministre en période de cohabitation ? Qui est le véritable chef de l'exécutif sous le régime de la 5ème république ?
- Dernier Président du Directoire exécutif de la République Française - Régime qui gouverna la France du 4 Brumaire, An IV (26 octobre 1795) au 18 Brumaire, An VII (9 novembre 1799) et fit place au Consulat
- La IVe République, un régime instable ?