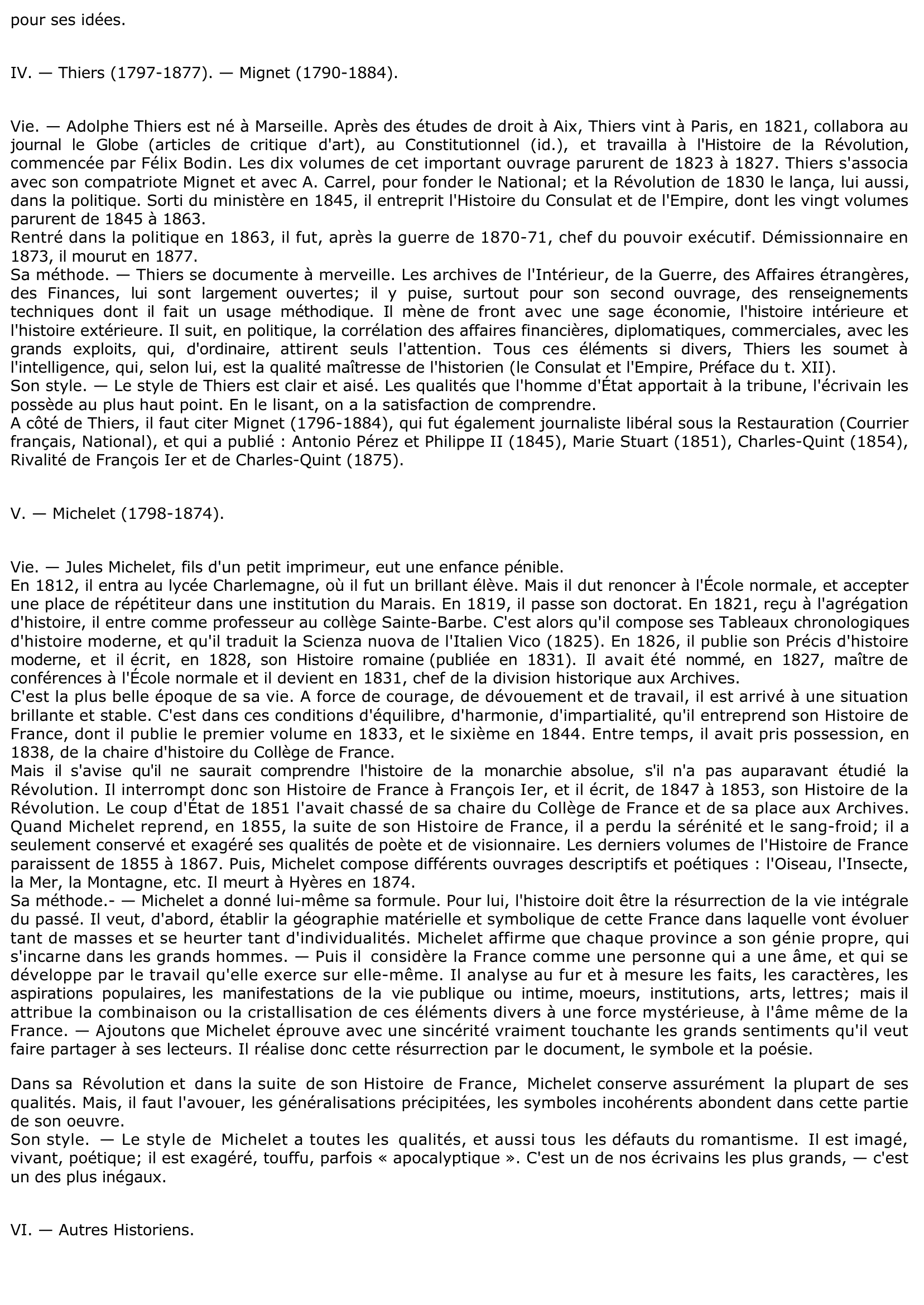L'HISTOIRE AU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE
Publié le 17/01/2022

Extrait du document
Des influences diverses ont contribué, au début du XIXe siècle, à renouveler le genre historique. Ce sont, en résumé : 1° La Révolution qui, en renversant l'ancien régime, incite les historiens à rechercher les causes politiques, sociales et morales de ce grand changement; — 2° Le progrès général des sciences, et en particulier des sciences auxiliaires de l'histoire : l'archéologie, l'épigraphie, la géographie ethnographique, etc... — 3° Le romantisme qui inspire à tous le goût de la couleur locale et de la reconstitution pittoresque des mœurs. des costumes, des monuments, etc...
I. — Augustin Thierry (1795-1856).
Vie. — Augustin Thierry entra à l'École normale en 1811 ; il quitta l'Université en 1815. En 1817, il commença à écrire dans le Censeur européen des articles, qui, retouchés, formèrent plus tard une notable partie de son volume intitulé Dix ans d'études historiques (1834). Au Courrier français il publia dix Lettres sur l'histoire de France, réunies en volume, et suivies de quinze autres, en 1827. L'Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands parut en 1825 (4 vol.). C'est alors qu'A. Thierry devint aveugle. On sait avec quelle résignation courageuse il accepta cette infirmité. Il publia encore Les Récits des temps mérovingiens (1833-1840), puis les Considérations sur l'histoire de France (1840), et mourut en 1856.
«
pour ses idées.
IV.
— Thiers (1797-1877).
— Mignet (1790-1884).
Vie.
— Adolphe Thiers est né à Marseille.
Après des études de droit à Aix, Thiers vint à Paris, en 1821, collabora aujournal le Globe (articles de critique d'art), au Constitutionnel (id.), et travailla à l'Histoire de la Révolution,commencée par Félix Bodin.
Les dix volumes de cet important ouvrage parurent de 1823 à 1827.
Thiers s'associaavec son compatriote Mignet et avec A.
Carrel, pour fonder le National; et la Révolution de 1830 le lança, lui aussi,dans la politique.
Sorti du ministère en 1845, il entreprit l'Histoire du Consulat et de l'Empire, dont les vingt volumesparurent de 1845 à 1863.Rentré dans la politique en 1863, il fut, après la guerre de 1870-71, chef du pouvoir exécutif.
Démissionnaire en1873, il mourut en 1877.Sa méthode.
— Thiers se documente à merveille.
Les archives de l'Intérieur, de la Guerre, des Affaires étrangères,des Finances, lui sont largement ouvertes; il y puise, surtout pour son second ouvrage, des renseignementstechniques dont il fait un usage méthodique.
Il mène de front avec une sage économie, l'histoire intérieure etl'histoire extérieure.
Il suit, en politique, la corrélation des affaires financières, diplomatiques, commerciales, avec lesgrands exploits, qui, d'ordinaire, attirent seuls l'attention.
Tous ces éléments si divers, Thiers les soumet àl'intelligence, qui, selon lui, est la qualité maîtresse de l'historien (le Consulat et l'Empire, Préface du t.
XII).Son style.
— Le style de Thiers est clair et aisé.
Les qualités que l'homme d'État apportait à la tribune, l'écrivain lespossède au plus haut point.
En le lisant, on a la satisfaction de comprendre.A côté de Thiers, il faut citer Mignet (1796-1884), qui fut également journaliste libéral sous la Restauration (Courrierfrançais, National), et qui a publié : Antonio Pérez et Philippe II (1845), Marie Stuart (1851), Charles-Quint (1854),Rivalité de François Ier et de Charles-Quint (1875).
V.
— Michelet (1798-1874).
Vie.
— Jules Michelet, fils d'un petit imprimeur, eut une enfance pénible.En 1812, il entra au lycée Charlemagne, où il fut un brillant élève.
Mais il dut renoncer à l'École normale, et accepterune place de répétiteur dans une institution du Marais.
En 1819, il passe son doctorat.
En 1821, reçu à l'agrégationd'histoire, il entre comme professeur au collège Sainte-Barbe.
C'est alors qu'il compose ses Tableaux chronologiquesd'histoire moderne, et qu'il traduit la Scienza nuova de l'Italien Vico (1825).
En 1826, il publie son Précis d'histoiremoderne, et il écrit, en 1828, son Histoire romaine (publiée en 1831).
Il avait été nommé, en 1827, maître deconférences à l'École normale et il devient en 1831, chef de la division historique aux Archives.C'est la plus belle époque de sa vie.
A force de courage, de dévouement et de travail, il est arrivé à une situationbrillante et stable.
C'est dans ces conditions d'équilibre, d'harmonie, d'impartialité, qu'il entreprend son Histoire deFrance, dont il publie le premier volume en 1833, et le sixième en 1844.
Entre temps, il avait pris possession, en1838, de la chaire d'histoire du Collège de France.Mais il s'avise qu'il ne saurait comprendre l'histoire de la monarchie absolue, s'il n'a pas auparavant étudié laRévolution.
Il interrompt donc son Histoire de France à François Ier, et il écrit, de 1847 à 1853, son Histoire de laRévolution.
Le coup d'État de 1851 l'avait chassé de sa chaire du Collège de France et de sa place aux Archives.Quand Michelet reprend, en 1855, la suite de son Histoire de France, il a perdu la sérénité et le sang-froid; il aseulement conservé et exagéré ses qualités de poète et de visionnaire.
Les derniers volumes de l'Histoire de Franceparaissent de 1855 à 1867.
Puis, Michelet compose différents ouvrages descriptifs et poétiques : l'Oiseau, l'Insecte,la Mer, la Montagne, etc.
Il meurt à Hyères en 1874.Sa méthode.- — Michelet a donné lui-même sa formule.
Pour lui, l'histoire doit être la résurrection de la vie intégraledu passé.
Il veut, d'abord, établir la géographie matérielle et symbolique de cette France dans laquelle vont évoluertant de masses et se heurter tant d'individualités.
Michelet affirme que chaque province a son génie propre, quis'incarne dans les grands hommes.
— Puis il considère la France comme une personne qui a une âme, et qui sedéveloppe par le travail qu'elle exerce sur elle-même.
Il analyse au fur et à mesure les faits, les caractères, lesaspirations populaires, les manifestations de la vie publique ou intime, moeurs, institutions, arts, lettres; mais ilattribue la combinaison ou la cristallisation de ces éléments divers à une force mystérieuse, à l'âme même de laFrance.
— Ajoutons que Michelet éprouve avec une sincérité vraiment touchante les grands sentiments qu'il veutfaire partager à ses lecteurs.
Il réalise donc cette résurrection par le document, le symbole et la poésie.
Dans sa Révolution et dans la suite de son Histoire de France, Michelet conserve assurément la plupart de sesqualités.
Mais, il faut l'avouer, les généralisations précipitées, les symboles incohérents abondent dans cette partiede son oeuvre.Son style.
— Le style de Michelet a toutes les qualités, et aussi tous les défauts du romantisme.
Il est imagé,vivant, poétique; il est exagéré, touffu, parfois « apocalyptique ».
C'est un de nos écrivains les plus grands, — c'estun des plus inégaux.
VI.
— Autres Historiens..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Histoire moderne : Introduction à l’Europe du XVIème siècle
- histoire ancienne: Chapitre 4 : Histoire Impériale du 1er siècle ap.JC
- La politique et les forces de l’histoire (xix° siècle): Hegel, Marx, Bakounine, Proudhon...
- Princesse de Clèves: Le personnage face à l’histoire au XIXe Siècle, en quoi la construction du personnage du roman au fil des siècles nous permet-elle de mieux comprendre le monde ?
- HISTOIRE DE L’ART PAR LES MONUMENTS DEPUIS SA DÉCADENCE AU IVe SIÈCLE, JUSQU’A SON RENOUVELLEMENT AU XVIe.