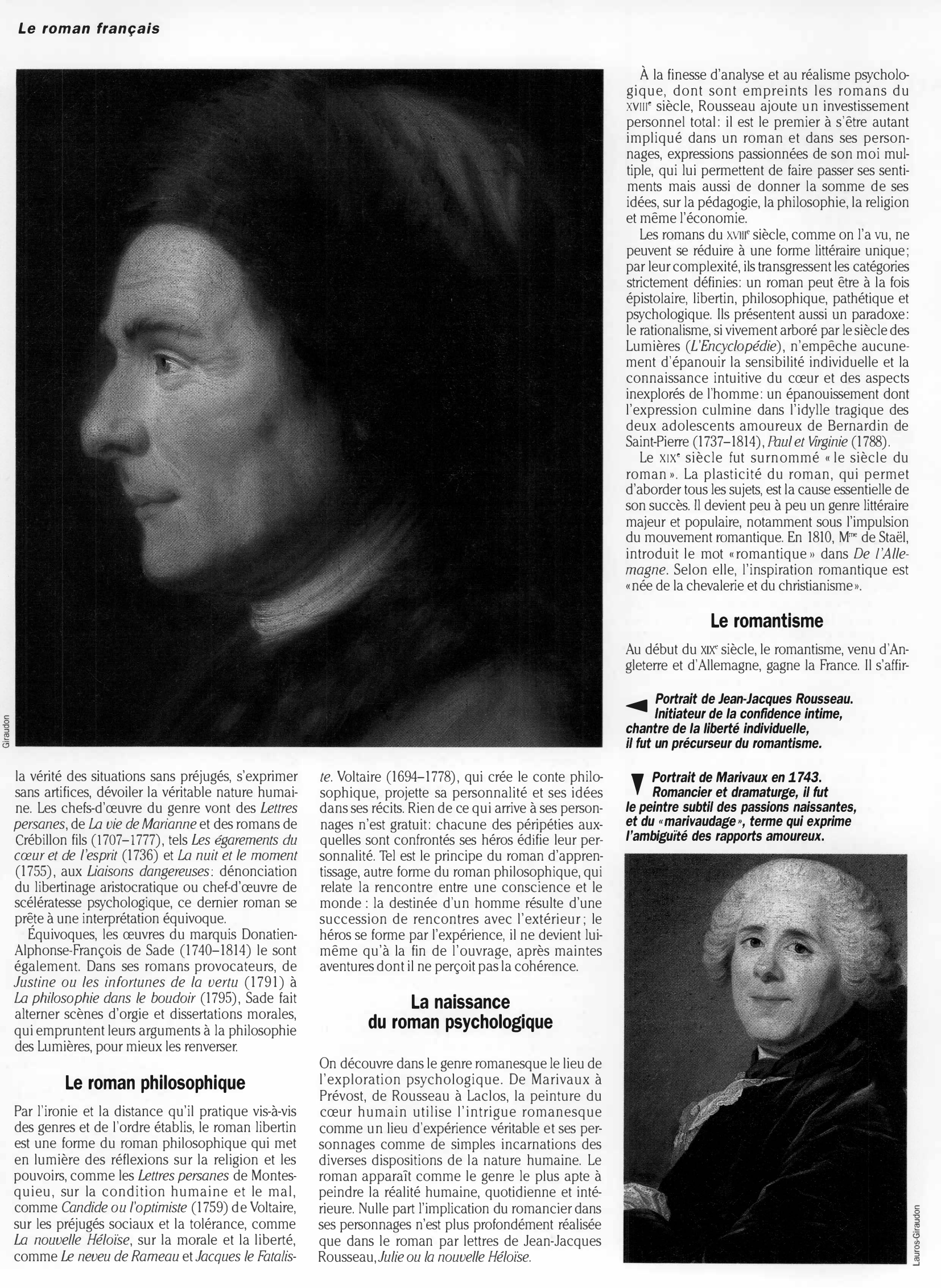Arts et Culture LE ROMAN FRANÇAIS
Publié le 09/02/2019

Extrait du document

propres préoccupations esthétiques que de délivrer un message politique, annoncent les bouleversements: Julien Gracq (né en 1910), auteur de romans «surréalistes» comme Le rivage des Syrtes (1951), est un des plus originaux, par la qualité poétique de son style et la peinture d’un univers étrange, dans l’attente d’une catastrophe indéfinissable; Raymond Queneau (1903-1976) remet en cause la validité de la langue littéraire, en introduisant des «photographies du langage populaire» dans Zazie dans le métro (1959), et propose une nouvelle orthographe adéquate à la langue parlée (ainsi le «doukipudonktan»).
Le nouveau roman
L’expression «nouveau roman» désigne les œuvres qui prônent la recherche de l’innovation formelle. Si les auteurs qui s’en réclament -Nathalie Sarraute (née en 1902), Alain Robbe-Grillet (né en 1922), Claude Simon (né en 1913), Michel Butor (né en 1926)- ne constituent pas un mouvement à proprement parler, ils partagent le même souci d’associer écriture littéraire et réflexion théorique. Il s’agit de refuser les conventions du roman classique. Cette réflexion théorique passe par une critique du romancier omniscient, de la continuité temporelle et spatiale que suppose l’histoire, de la notion de caractère logique, pour s’interroger sur la conscience des
situations décrites, particulièrement sur la conscience de l’écrivain.
Le roman, qui ne s’interdit pas le réalisme, est appréhendé comme une recherche. La modification (1957) de Michel Butor recourt à une «fiction rusée» où les phrases s’étirent sur plusieurs paragraphes: présenté à la deuxième personne, le récit est le discours intérieur d’un homme qui voyage dans un train; le livre est formé des images, des rêveries, des cauchemars, des pensées qui défilent dans sa tête. La jalousie (1957) d’Alain Robbe-Grillet illustre une conception cinématographique du récit: une série de «plans» subjectifs nous suggère la présence d’un personnage invisible, et désoriente la logique traditionnelle.
Dans cette lignée s’inscrit le mouvement d’écriture expérimentale «Oulipo» - Ouvroir de Littérature Potentielle - avec Georges Pérec (1936-1982), qui élabore ses romans sous la contrainte formelle: La disparition (1969) écrit sans -e- Le «nouveau roman» a entraîné dans son sillage des écrivains de qualité, comme Marguerite Duras (1914-1996), qui s’attache à rendre l’indicible (India Song, L’amant). Dans un récit très dépouillé, sans notations psychologiques, elle montre surtout le vide de l’existence et l’impossibilité de la communication entre des êtres qui cherchent vainement l’amour (Moderato cantabile, 1958).
Depuis, le roman contemporain oscille entre les valeurs humanistes, chez Marguerite Yourcenar (1903-1987), L’œuvre au noir et la dimension
métaphysique chez Michel Tournier (né en 1924), Le roi des Aulnes (1970), Les météores (1975).
Le roman contemporain
À la fin des années 1970, Jean-Marie Gustave Le Clézio (né en 1940) et Patrick Modiano (né en 1945) écrivent sur la quête d’identité, ouverture sur le monde pour le premier (Onitsha, 1991), introspection angoissante pour le second (Dora Bruder, 1997). Le désarroi caractérise Les noces barbares (1985) de Yann Queffélec, comme les romans pessimistes de Philippe Djian (37°2 le matin, 1989). On est loin de cette violence dans les opus d’Alexandre Jardin (L’Tle des Gauchers, 1995; Le zubial, 1997). Une société sans repère engendre une littérature sans école: entre l’humanisme d’un Paris populaire chez Daniel Pen-nac (La fée carabine, 1989), la gaie sensualité ou les affres d’auteur chez Erik Orsenna (L’exposition coloniale, 1988; Deux étés, 1997) et l’épure bouleversante des récits de vie périssable mais d’amour persistant de Christian Bobin (L’épuisement, 1994; La plus que vive, 1997), quel trait d’union en effet, sinon une assurance de pérennité pour une certaine liberté de créer?
L'année dernière à Marienbad (1961) d’Alain Resnais, sur un scénario du chef de file du « nouveau roman », Alain Robbe-Grillet. Ce film inclassable mêle avec une audace inusitée, le passé au présent, le fantasme et le mensonge à la réalité, au fil d'une subtile alliance visuelle et sonore.
Zazie dans le métro (1960), comédie burlesque de Louis Malle, d’après le roman de Raymond Queneau : l’histoire d'une petite provinciale dégourdie venue à Paris dans le but de voir le métro.
ŒUVRES PRINCIPALES
1913
Alain Fournier: le GrandMeaulnes Marcel Proust: Du côté de chez Swann
1923
Raymond Radiguet: le Diable au corps
1926
André Gide: les Faux-Monnayeurs
1928
André Breton : Nadja
1932
Céline: Voyage au bout de la nuit
1933
André Malraux: la Condition humaine
1937
Georges Bernanos: Nouvelle Histoire de Mouchette
André Malraux: l'Espoir
1946
Georges Bernanos: Monsieur Ouine
1951
Jean Giono : le Hussard sur le toit
1953
Alain Robbe-Grillet: les Gommes
1954
Françoise Sagan: Bonjour tristesse
Le roman, action de vie
La seule imagination ne pouvait contenter certains romanciers qui, traumatisés par la Grande Guerre, ont cherché dans l’action, la vraie mesure de leur art. Ainsi, Jean Giono (1895-1970) n’exclut pas la vision dionysiaque (Regain, 1930), le lyrisme cosmique (Que ma joie demeure, 1935), la chronique légendaire (Le Hussard sur le toit, 1951), un optimisme fondamental dans l’homme qui transparaît dans le bonheur d’écriture.
La légende du héros de l’Aéropostale (Vol de nuit, 1931) et l’indéniable lyrisme du Petit Prince (1943) a donné le plus vif rayonnement aux récits d’Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944): avec lui, l’exigence éthique et l’expérience d’une
vie dépassent désormais la fiction. Comme chez André Malraux (1901-1976) fasciné par l’aventure et la participation à l’histoire, qui forment les conditions de la création littéraire. La soumission du récit à une expérience de vie -la guerre civile en Chine dans La condition humaine (1933), la guerre d’Espagne dans L’espoir (1937) -, qui veut donner un sens à l’existence, est un jalon décisif dans la transformation du roman moderne.
Si, depuis le début du xxe siècle, certains écrivains ont remis en cause les conventions romanesques, ils ont néanmoins respecté le recours à une langue «classique». C’est par Le voyage au bout de la nuit, roman de Céline paru en 1932, que le scandale éclate. Non seulement Céline dévalorise le roman d’apprentissage et exprime une vision extrêmement négative de l’humanité avec ce roman, mais il le fait dans une langue chargée de transmettre toute la violence qu’inspire à l’auteur le spectacle de la misère et du désespoir humains. Il veut communiquer «l’émotion du langage parlé à travers l’écrit»; ce faisant, il attribue à son narrateur un langage chargé d’expressions populaires et argotiques, il fabrique une langue personnelle parsemée de néologismes, d’incessantes dislocations syntaxiques qui bouleversent l’ordre des phrases et révolutionnent l’écriture romanesque, la subvertissant, la vulgarisant à plaisir. Sa langue a fait école, notamment dans les truculentes parodies de San-Antonio, pseudonyme de Frédéric Dard (né en 1921).
L’après-guerre
La période de l’immédiat après-guerre est dominée par l’existentialisme de Jean-Paul Sartre (1905-1980) dont les romans illustrent ses idées
L'écrivain américain francophone, Julien Green. On lui doit une œuvre impressionnante à l'atmosphère sombre d'où se dégage une profonde tristesse, qui résume, selon lui, le sentiment fondamental de l’existence.
Écrivain francophone, née en Belgique et ayant vécu aux États-Unis, Marguerite Yourcenar témoigne d’un sens exceptionnel de la narration historique dans Mémoires d’Hadrien (1953) ou L’œuvre au noir (1969).
Jules Romains, ici assis à sa table de travail, avait le goût du canular, que l’on retrouve dans sa fameuse pièce Knock (1923), et l’idéal classique d'une « confrérie d’honnêtes gens » illustrés dans les 27 volumes des Hommes de bonne volonté.
philosophiques: La nausée (1938) est l’histoire d’un intellectuel, Roquentin, qui fait l’expérience du sentiment de l’absurdité de l’existence et du malaise devant les choses; englué dans son angoisse, il prend conscience de la contingence absolue de toute existence. Le mur (1939) est un recueil de nouvelles où Sartre affirme certains des thèmes majeurs de sa pensée : la mauvaise foi, la responsabilité, l’aliénation. Avec une grande économie de moyens et une langue simple, Albert Camus (1913-1960) décrit l’affrontement de l’homme et de l’absurde, et prône la nécessité de la révolte. Écrit mythique et symbolique, La Peste (1947) marque le passage d’une révolte individuelle à la lutte pour la reconnaissance d’une communauté.
À la recherche d’un nouvel humanisme, l’existentialisme et l’absurde inspirent fortement les milieux intellectuels ainsi que de jeunes romanciers marqués par la tradition française du réalisme pessimiste, tel Bonjour tristesse (1954) de Françoise Sagan (née en 1935). Une double réaction contre l’idéologie de gauche anime les «hussards» -du Hussard bleu (1950) de Roger Nimier (1925-1962)- un groupe comprenant Jacques Laurent (né en 1919), Antoine Blondin (1922-1991) et Michel Déon (né en 1919). Ces romanciers, qualifiés de «nouvelle vague réactionnaire», exaltent la quête du bonheur individuel, la dérision et l’immoralité. Dans le genre historico-romanesque, Maurice Druon (né en 1918) se démarque avec une fresque limpide et vivante sur les débuts de la Guerre de Cent ans (Les mis maudits, 1970). Foisonnantes, mais plus intimistes, les fresques d’Henri Troyat évoquent la Russie, où il est né en 1911 (La lumière des justes, 1959-1965).
Cette tendance classique n’exclut pas une volonté de «nouveau roman» dont plusieurs précurseurs, plus soucieux de faire passer leurs

«
Le
roman français
la vérité des situations sans préjugés, s'exprimer
sans artifices, dévoiler la véritable nature humai
ne.
Les chefs-d'œuvre du genre vont des Lettres
persanes, de La vie de Marianne et des romans de
Crébillon fils (1707-1777), tels Les égarements du
cœur et de l'esprit (1736) et La nuit et le moment
(1755), aux Liaisons dangereuses: dénonciation
du libertinage aristocratique ou chef-d'œuvre de
scélératesse psychologique, ce dernier roman se
pr�te à une interprétation équivoque.
Equivoques, les œuvres du marquis Donatien
Alphonse-François de Sade (1740-1814) le sont
également.
Dans ses romans provocateurs, de
Justine ou les infortunes de la vertu (1791) à
La philosophie dans le boudoir (1795), Sade fait
alterner scènes d'orgie et dissertations morales,
qui empruntent leurs arguments à la philosophie
des Lumières, pour mieux les renverser.
Le roman philosophique
Par l'ironie et la distance qu'il pratique vis-à-vis
des genres et de l'ordre établis, le roman libertin
est une forme du roman philosophique qui met
en lumière des réflexions sur la religion et les
pouvoirs, comme les Lettres persanes de Montes
quieu, sur la condition humaine et le mal,
comme Candide ou l'optimiste (1759) de Voltaire,
sur les préjugés sociaux et la tolérance, comme
La nouvelle Héloïse, sur la morale et la liberté,
comme Le neveu de Rameau et Jacques le Fatalis- te.
Voltaire (1694-1778), qui crée le conte philo
sophique, projette sa personnalité et ses idées
dans ses récits.
Rien de ce qui arrive à ses person
nages n'est gratuit: chacune des péripéties aux
quelles sont confrontés ses héros édifie leur per
sonnalité.
Tel est le principe du roman d'appren
tissage, autre forme du roman philosophique, qui
relate la rencontre entre une conscience et le
monde : la destinée d'un homme résulte d'une
succession de rencontres avec l'extérieur; le
héros se forme par l'expérience, il ne devient lui
même qu'à la fin de l'ouvrage, après maintes
aventures dont il ne perçoit pas la cohérence.
La naissance
du roman psychologique
On découvre dans le genre romanesque le lieu de
l'exploration psychologique.
De Marivaux à
Prévost, de Rousseau à Laclos, la peinture du
cœur humain utilise l'intrigue romanesque
comme un lieu d'expérience véritable et ses per
sonnages comme de simples incarnations des
diverses dispositions de la nature humaine.
Le
roman apparaît comme le genre le plus apte à
peindre la réalité humaine, quotidienne et inté
rieure.
Nulle part l'implication du romancier dans
ses personnages n'est plus profondément réalisée
que dans le roman par lettres de Jean-Jacques
Rousseau, Julie ou la nouvelle Héloïse.
À
la finesse d'analyse et au réalisme psycholo
gique, dont sont empreints les romans du
xviiie siècle, Rousseau ajoute un investissement
personnel total: il est le premier à s'être autant
impliqué dans un roman et dans ses person
nages, expressions passionnées de son moi mul
tiple, qui lui permettent de faire passer ses senti
ments mais aussi de donner la somme de ses
idées, sur la pédagogie, la philosophie, la religion
et même l'économie.
Les romans du XVIII" siècle, comme on l'a vu, ne
peuvent se réduire à une forme littéraire unique;
par leur complexité, ils transgressent les catégories
strictement définies: un roman peut être à la fois
épistolaire, libertin, philosophique, pathétique et
psychologique.
Ils présentent aussi un paradoxe :
le rationalisme, si vivement arboré par le siècle des
Lumières (L'Encyclopédie), n'empêche aucune
ment d'épanouir la sensibilité individuelle et la
connaissance intuitive du cœur et des aspects
inexplorés de l'homme: un épanouissement dont
l'expression culmine dans l'idylle tragique des
deux adolescents amoureux de Bernardin de
Saint-Pierre (1737-1814), Fbul et Virginie (1788).
Le XIXe siècle fut surn ommé «le siècle du
roman ''· La plasticité du roman, qui permet
d'aborder tous les sujets, est la cause essentielle de
son succès.
Il devient peu à peu un genre littéraire
majeur et populaire, notamment sous l'impulsion
du mouvement romantique.
En 1810, Mme de Staël,
introduit le mot «romantique>> dans De l'Alle
magne.
Selon elle, l'inspiration romantique est
«n ée de la chevalerie et du christianisme >>.
Le romantisme
Au début du XIX" siècle, le romantisme, venu d'An
gleterre et d'Allemagne, gagne la France.
Il s'affir-
.......
Portrait de Jean-J acques Rousseau.
Initiateur de la confidence intime,
chantre de la liberté individuelle,
il fut un précurseur du romantisme.
' Portrait de Marivaux en 1743.
Romancier et dramaturge, il fut
le peintre subtil des passions naissantes,
et du «marivaudage", terme qui exprime
l'ambiguité des rapports amoureux..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Arts et Culture LES PEINTRES RÉALISTES FRANÇAIS
- Arts et Culture LE CINÉMA FRANÇAIS
- Le peuple dans le roman français de Zola a Céline
- Journal de Mikio : court roman rédigé pour un cours de français sur la rédaction d'histoires fictifs
- Arts et Culture LE FAUVISME