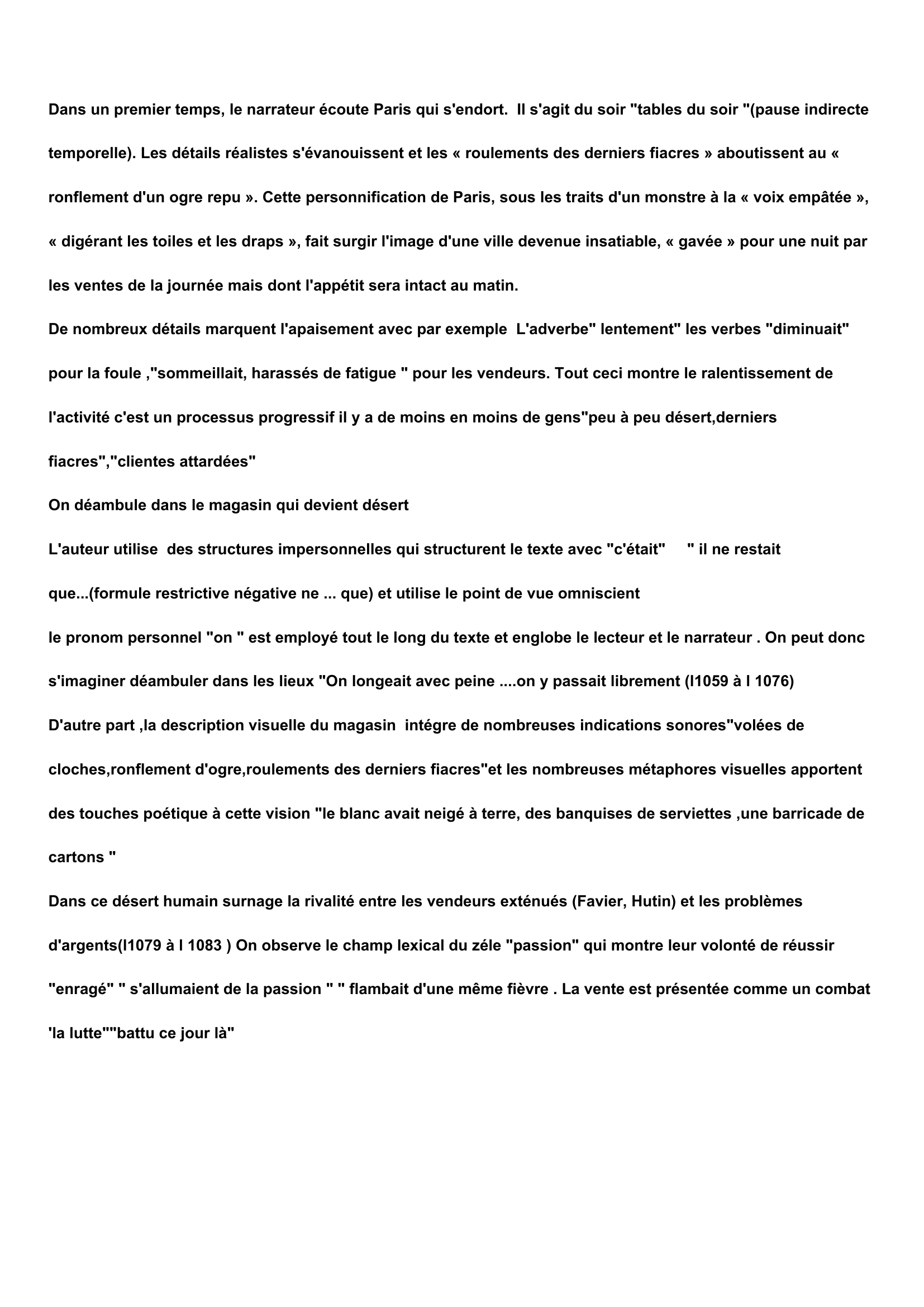Au bonheur des dames chapître IV
Publié le 28/02/2015

Extrait du document
«
Dans un premier temps, le narrateur écoute Paris qui s'endort.
Il s'agit du soir "tables du soir "(pause indirecte
temporelle).
Les détails réalistes s'évanouissent et les « roulements des derniers fiacres » aboutissent au «
ronflement d'un ogre repu ».
Cette personnification de Paris, sous les traits d'un monstre à la « voix empâtée »,
« digérant les toiles et les draps », fait surgir l'image d'une ville devenue insatiable, « gavée » pour une nuit par
les ventes de la journée mais dont l'appétit sera intact au matin.
De nombreux détails marquent l'apaisement avec par exemple L'adverbe" lentement" les verbes "diminuait"
pour la foule ,"sommeillait, harassés de fatigue " pour les vendeurs.
Tout ceci montre le ralentissement de
l'activité c'est un processus progressif il y a de moins en moins de gens"peu à peu désert,derniers
fiacres","clientes attardées"
On déambule dans le magasin qui devient désert
L'auteur utilise des structures impersonnelles qui structurent le texte avec "c'était" " il ne restait
que...(formule restrictive négative ne ...
que) et utilise le point de vue omniscient
le pronom personnel "on " est employé tout le long du texte et englobe le lecteur et le narrateur .
On peut donc
s'imaginer déambuler dans les lieux "On longeait avec peine ....on y passait librement (l1059 à l 1076)
D'autre part ,la description visuelle du magasin intégre de nombreuses indications sonores"volées de
cloches,ronflement d'ogre,roulements des derniers fiacres"et les nombreuses métaphores visuelles apportent
des touches poétique à cette vision "le blanc avait neigé à terre, des banquises de serviettes ,une barricade de
cartons "
Dans ce désert humain surnage la rivalité entre les vendeurs exténués (Favier, Hutin) et les problèmes
d'argents(l1079 à l 1083 ) On observe le champ lexical du zéle "passion" qui montre leur volonté de réussir
"enragé" " s'allumaient de la passion " " flambait d'une même fièvre .
La vente est présentée comme un combat
'la lutte""battu ce jour là".
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- AU BONHEUR DES DAMES
- Analyse linéaire de l'incipit Au Bonheur des dames
- sujet de réflexion au bonheur des dames
- DISSERTATION : AU BONHEUR DES DAMES: Comment Zola applique-t-il le naturalisme dans une œuvre romanesque ?
- Analyse de Au Bonheur Des Dames d'Emile Zola