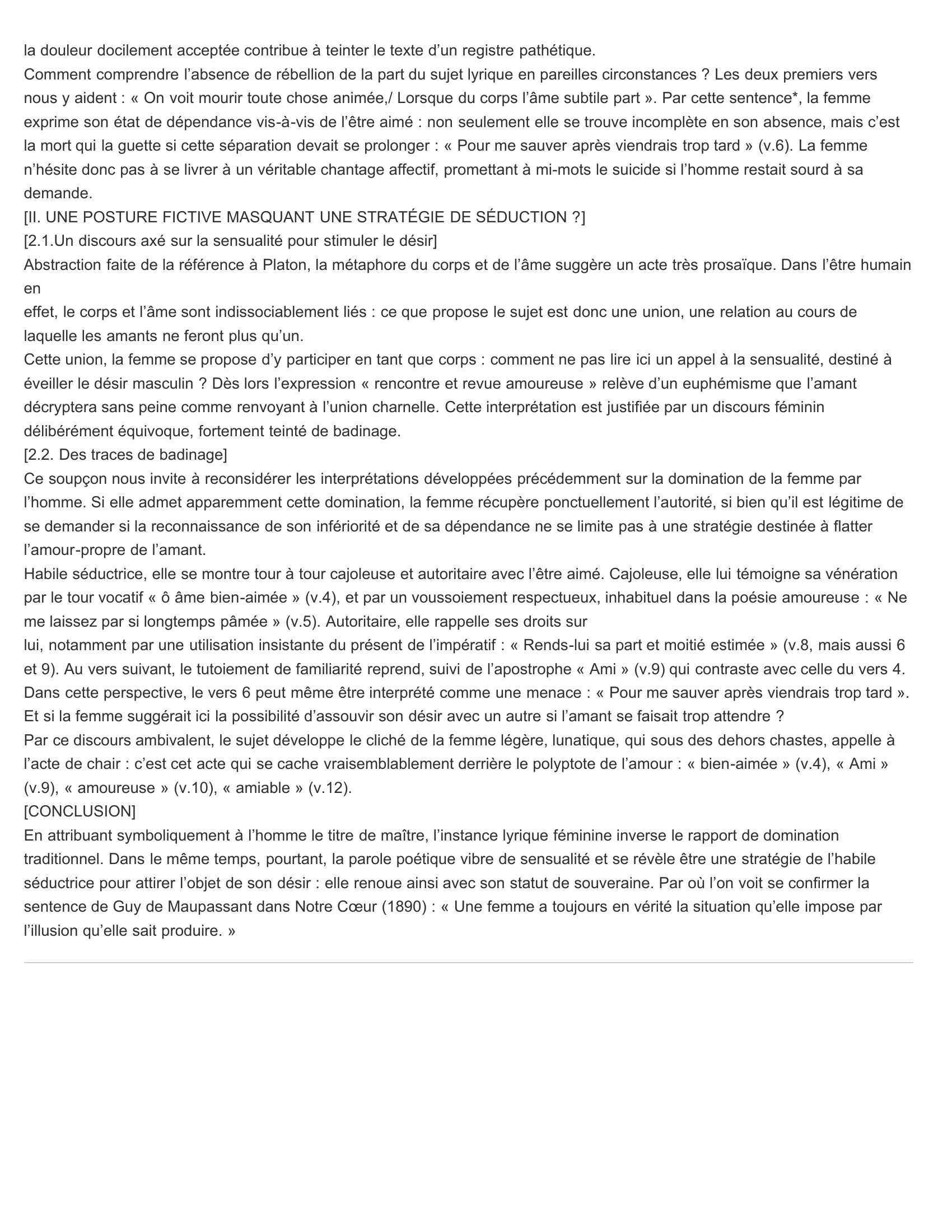Commentaire composé du sonnet 7, « on voit mourir toute chose animée » in sonnets (1555) de Louise Labé
Publié le 07/10/2018

Extrait du document
[II. UNE POSTURE FICTIVE MASQUANT UNE STRATÉGIE DE SÉDUCTION ?]
[2.1.Un discours axé sur la sensualité pour stimuler le désir]
Abstraction faite de la référence à Platon, la métaphore du corps et de l’âme suggère un acte très prosaïque. Dans l’être humain en
effet, le corps et l’âme sont indissociablement liés : ce que propose le sujet est donc une union, une relation au cours de laquelle les amants ne feront plus qu’un.
Cette union, la femme se propose d’y participer en tant que corps : comment ne pas lire ici un appel à la sensualité, destiné à éveiller le désir masculin ? Dès lors l’expression « rencontre et revue amoureuse » relève d’un euphémisme que l’amant décryptera sans peine comme renvoyant à l’union charnelle. Cette interprétation est justifiée par un discours féminin délibérément équivoque, fortement teinté de badinage.
[2.2. Des traces de badinage]
Ce soupçon nous invite à reconsidérer les interprétations développées précédemment sur la domination de la femme par l’homme. Si elle admet apparemment cette domination, la femme récupère ponctuellement l’autorité, si bien qu’il est légitime de se demander si la reconnaissance de son infériorité et de sa dépendance ne se limite pas à une stratégie destinée à flatter l’amour-propre de l’amant.
Habile séductrice, elle se montre tour à tour cajoleuse et autoritaire avec l’être aimé. Cajoleuse, elle lui témoigne sa vénération par le tour vocatif « ô âme bien-aimée » (v.4), et par un voussoiement respectueux, inhabituel dans la poésie amoureuse : « Ne me laissez par si longtemps pâmée » (v.5). Autoritaire, elle rappelle ses droits sur
lui, notamment par une utilisation insistante du présent de l’impératif : « Rends-lui sa part et moitié estimée » (v.8, mais aussi 6 et 9). Au vers suivant, le tutoiement de familiarité reprend, suivi de l’apostrophe « Ami » (v.9) qui contraste avec celle du vers 4. Dans cette perspective, le vers 6 peut même être interprété comme une menace : « Pour me sauver après viendrais trop tard ». Et si la femme suggérait ici la possibilité d’assouvir son désir avec un autre si l’amant se faisait trop attendre ?
Par ce discours ambivalent, le sujet développe le cliché de la femme légère, lunatique, qui sous des dehors chastes, appelle à l’acte de chair : c’est cet acte qui se cache vraisemblablement derrière le polyptote de l’amour : « bien-aimée » (v.4), « Ami » (v.9), « amoureuse » (v.10), « amiable » (v.12).
«
la douleur docilement acceptée contribue à teinter le texte d’un registre pathétique.
Comment comprendre l’absence de rébellion de la part du sujet lyrique en pareilles circonstances ? Les deux premiers vers
nous y aident : « On voit mourir toute chose animée,/ Lorsque du corps l’âme subtile part ».
Par cette sentence*, la femme
exprime son état de dépendance vis-à-vis de l’être aimé : non seulement elle se trouve incomplète en son absence, mais c’est
la mort qui la guette si cette séparation devait se prolonger : « Pour me sauver après viendrais trop tard » (v.6).
La femme
n’hésite donc pas à se livrer à un véritable chantage affectif, promettant à mi-mots le suicide si l’homme restait sourd à sa
demande.
[II.
UNE POSTURE FICTIVE MASQUANT UNE STRATÉGIE DE SÉDUCTION ?]
[2.1.Un discours axé sur la sensualité pour stimuler le désir]
Abstraction faite de la référence à Platon, la métaphore du corps et de l’âme suggère un acte très prosaïque.
Dans l’être humain
en
effet, le corps et l’âme sont indissociablement liés : ce que propose le sujet est donc une union, une relation au cours de
laquelle les amants ne feront plus qu’un.
Cette union, la femme se propose d’y participer en tant que corps : comment ne pas lire ici un appel à la sensualité, destiné à
éveiller le désir masculin ? Dès lors l’expression « rencontre et revue amoureuse » relève d’un euphémisme que l’amant
décryptera sans peine comme renvoyant à l’union charnelle.
Cette interprétation est justifiée par un discours féminin
délibérément équivoque, fortement teinté de badinage.
[2.2.
Des traces de badinage]
Ce soupçon nous invite à reconsidérer les interprétations développées précédemment sur la domination de la femme par
l’homme.
Si elle admet apparemment cette domination, la femme récupère ponctuellement l’autorité, si bien qu’il est légitime de
se demander si la reconnaissance de son infériorité et de sa dépendance ne se limite pas à une stratégie destinée à flatter
l’amour -propre de l’amant.
Habile séductrice, elle se montre tour à tour cajoleuse et autoritaire avec l’être aimé.
Cajoleuse, elle lui témoigne sa vénération
par le tour vocatif « ô âme bien-aimée » (v.4), et par un voussoiement respectueux, inhabituel dans la poésie amoureuse : « Ne
me laissez par si longtemps pâmée » (v.5).
Autoritaire, elle rappelle ses droits sur
lui, notamment par une utilisation insistante du présent de l’impératif : « Rends-lui sa part et moitié estimée » (v.8, mais aussi 6
et 9).
Au vers suivant, le tutoiement de familiarité reprend, suivi de l’apostrophe « Ami » (v.9) qui contraste avec celle du vers 4.
Dans cette perspective, le vers 6 peut même être interprété comme une menace : « Pour me sauver après viendrais trop tard ».
Et si la femme suggérait ici la possibilité d’assouvir son désir avec un autre si l’amant se faisait trop attendre ?
Par ce discours ambivalent, le sujet développe le cliché de la femme légère, lunatique, qui sous des dehors chastes, appelle à
l’acte de chair : c’est cet acte qui se cache vraisemblablement derrière le polyptote de l’amour : « bien-aimée » (v.4), « Ami »
(v.9), « amoureuse » (v.10), « amiable » (v.12).
[CONCLUSION]
En attribuant symboliquement à l’homme le titre de maître, l’instance lyrique féminine inverse le rapport de domination
traditionnel.
Dans le même temps, pourtant, la parole poétique vibre de sensualité et se révèle être une stratégie de l’habile
séductrice pour attirer l’objet de son désir : elle renoue ainsi avec son statut de souveraine.
Par où l’on voit se confirmer la
sentence de Guy de Maupassant dans Notre Cœur (1890) : « Une femme a toujours en vérité la situation qu’elle impose par
l’illusion qu’elle sait produire.
».
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire Composé Du Sonnet 7, « On Voit Mourir Toute Chose Animée » In Sonnets (1555) De Louise Labé
- Louise Labé, sonnets, sonnet XIV
- Commentaire composé. Louise Labé. « Prédit me fut »
- Louise LABÉ (1524-1566), Sonnets (1555), XI :comment ce poème traduit-il les tourments de l’amante ?
- SONNETS et ÉLÉGIES de Louise Labé (résumé et analyse de l'oeuvre)