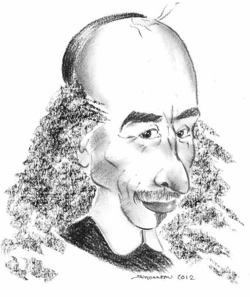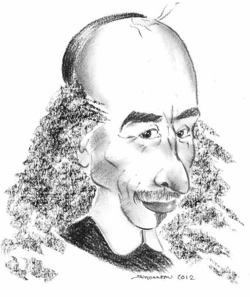CORNEILLE Pierre (1606-1684). Le théâtre de Corneille marqua de son empreinte tout le XVIIe siècle. Fruit d’une carrière qui s’ordonne autour de la création littéraire, il apparaît, un demi-siècle durant, comme un dialogue avec le public. Dans une dramaturgie sans cesse renouvelée, fondée sur l’éthique de l’héroïsme et l’esthétique de l’admiration, il est représentation symbolique de la problématique des valeurs sociales de son temps.
L'affirmation du métier d'écrivain
La biographie de Corneille se présente en un triptyque contrasté : on ne sait à peu près rien de sa personne; de son personnage, on peut établir une image assez nette, qui n’est d’abord que celle d’un modeste bourgeois de robe; en revanche, sa carrière d’écrivain, que l’on peut suivre avec précision, lui valut une gloire sans égale en son temps. Expliquer l’œuvre par la vie serait donc ici particulièrement hasardeux. C’est, à l’inverse, la prééminence de l’œuvre qui oriente la vie.
Dans ses débuts, l’histoire de Corneille s’inscrit dans le droit fil de celle de son groupe social : fils aîné de robins rouennais aisés — mais non pas riches —, appelé à suivre le processus de promotion lente et régulière constant dans le milieu, on lui fait faire de solides études au collège des jésuites, puis son droit, pour le nantir de charges modestes mais honorables, qu’il occupera consciencieusement jusqu’en 1651. Sa vie familiale, sa gestion domestique méthodique s’inscrivent dans le même conformisme.
Mais, dans cet itinéraire sage, la carrière littéraire introduit de brusques distorsions. La première est, en 1629, avec Mélite, l’accès à l’écriture et, d’emblée, au succès, et au succès parisien. Ensuite, carrière sociale et carrière d’écrivain se développent parallèlement, sans interférence décisive jusqu’en 1637, où le roi anoblit la famille Corneille, récompensant ainsi en un acte sans précédent l’auteur du Cid. Promotion d’autant plus remarquable que le théâtre est un genre alors suspect aux institutions religieuses; elle marque donc symboliquement la dignité nouvelle que Corneille conquiert pour la création littéraire. Dans les années 1660-1663, troisième distorsion : il donne de son œuvre deux éditions complètes, critiques et monumentales, emblèmes d’une gloire à laquelle nul autre écrivain auparavant n’avait eu droit de son vivant; dans le même temps, il quitte sa province (où pourtant la vie littéraire est active) pour s’installer à Paris. Pierre Corneille, bourgeois de Rouen, est désormais disparu pour céder la place au « grand Corneille », image vivante de l’écrivain reconnu. Image difficile à assumer d’ailleurs lorsque, dans les années 1670, les changements du goût public vouent son théâtre au purgatoire du demi-succès. Ainsi, la carrière de Corneille fait que l’écrivain a « capté » et transformé le petit magistrat et que l’« homme » s’est identifié à son rôle social d’auteur.
Le peu que nous savons de sa personnalité intime, par les quelques confidences biographiques de ses poèmes
et les indications de ses biographes les plus sûrs, confirme cet effacement de l’homme au profit de l’écrivain. Tout à l’opposé de son œuvre, il était assez terne : « Corneille était assez grand et assez plein, l’air fort simple et fort commun, toujours négligé et peu curieux de son extérieur (...). Sa prononciation n’était pas tout à fait nette » (Fontenelle).
S’il fréquente les salons littéraires, si, au sommet de la gloire, il est de pair à compagnon avec tous les maîtres de la première génération classique, il n’a jamais brillé dans le monde et guère pratiqué la Cour. Peut-être son œuvre a-t-elle pris sa source dans une passion amoureuse : c’est ainsi qu’il explique, dans l'Excuse à Ariste, la genèse de Mélite, mais c’est le seul lien direct entre le « moi » intime et l’écriture qui soit attesté, et — que le fait soit vrai n’y change rien — c’est un lieu commun de son temps. Ce que l’on discerne le mieux de sa psychologie, en fin de compte, c’est son caractère d’écrivain conscient de son génie et défendant son œuvre, face aux critiques et aux rivaux, avec une fierté ombrageuse, manifeste dans ses poèmes polémiques, préfaces, Examens et dans son attitude devant la gloire montante de Racine.
Nul au xviie siècle n’a plus que lui défendu la dignité du métier d’écrivain (y compris dans ses aspects matériels, comme en témoignent ses efforts pour tenter de faire reconnaître la propriété littéraire). S’il a dû, selon les mœurs du temps, dédier ses pièces à des grands ou à des financiers, écrire parfois sur commande et faire partie des Cinq Auteurs [voir Cinq auteurs], il a échappé dès que possible à ces contraintes. Sa stratégie littéraire a été de mettre face à face l’œuvre et le public (le choix du théâtre est, à cet égard, significatif), affirmant ainsi la dignité de la création artistique, non plus comme simple divertissement ou louange des puissants, mais comme activité symbolique autonome.
Un long dialogue avec le public
L’œuvre de Corneille apparaît, au sein du théâtre de son temps, comme un long dialogue avec son public. Sa dramaturgie, fondée sur l’éthique de l’héroïsme et l’esthétique de l’admiration, n’a cessé de se renouveler pour soutenir ce dialogue : l’effort d’innovation y est à la fois défi au public, par l’originalité qu’il génère, et réponse, par la recherche de modulations adaptées aux diverses nuances du goût contemporain. Aussi cette œuvre, dense et variée, est-elle un réceptacle de nombreuses images des valeurs sociales du temps. Mais elle joue comme un prisme aux multiples facettes : loin de s’ordonner en un discours monodique, elle vaut, par sa polyphonie, comme un révélateur de la problématique des valeurs morales, politiques et artistiques.
Ce public est tout d’abord celui des mondains, des « honnêtes gens », milieu qui se développe au premier tiers du xvnc siècle, à côté du public des « doctes », et où le ton est donné par la jeune noblesse de Cour [voir Honnête homme]. Ce milieu pratique l’« art du loisir», est avide de divertissements et de spectacles et favorise un essor du théâtre. Cet engouement, qui coïncide avec le succès de Corneille, se traduit par la création de théâtres (salles et troupes) nouveaux : ainsi, grâce à Mélite, la troupe de Lenoir-Mondory s’installe à Paris, où elle donnera naissance au théâtre du Marais, créant, avec l’Hôtel de Bourgogne (jusque-là en situation de monopole), une concurrence qui reflète et facilite la variété des créations.
La culture du public mondain est avant tout moderne. L'influence de la littérature espagnole (sensible chez Corneille : le Cid, le Menteur) et italienne y est forte. Son goût est marqué par l'Astrée et la pastorale [voir Pastorale], dont Corneille intègre plusieurs aspects dans son œuvre : décors sylvestres, multiples et surprenants (Clitandre, /’Illusion); épreuves imposées aux amants; « chaînes » de concurrences amoureuses contradictoires. De plus, ce public prend un plaisir particulier aux références à l’actualité : références tout extérieures, comme le sont les cadres de la Galerie du Palais et de la Place Royale, lieux à la mode ou, plus profondément, symbolique applicable aux réalités historiques contemporaines : le Cid, par exemple, est une célébration de l'unité nationale pour défendre le pays menacé d'invasion, comme l’a été la France dans sa lutte contre l’Espagne.
Mais, si le public mondain détenait les clefs du succès, seule l'approbation des « doctes » pouvait garantir la consécration. Corneille ne s’est plié qu’avec réticence à leurs exigences. Leur horizon d’attente supposait la référence à la culture antique et la recherche de la « régularité » plus que du spectaculaire. Dans la querelle que déclenchèrent les rivaux de Corneille contre le triomphe du Cid, leurs critiques (manquements aux règles, à la bienséance, à la morale, pillage du modèle espagnol Guillén de Castro) eurent le soutien des « savants » en une coalition qui irrita Corneille.
Plus qu’aucun autre auteur de son époque sans doute, celui-ci a été un maître de l’autocritique littéraire. Au fil des éditions de ses pièces, il ne cesse de les retoucher pour éliminer ce qu’il juge comme des imperfections : l’abondance des variantes montre quelle discipline il s’imposa en ce domaine. Et, en donnant la grande édition de 1660 de ses Œuvres, il rédige des Examens de ses pièces où il n’hésite pas à blâmer certains de ses choix esthétiques, à défaut de pouvoir les modifier — ce qui eût détruit l’économie d'ensemble de certaines, comme Horace. Mais ce travail d’autocritique n’est pas le fruit d’une théorie de « l’art pour l'art » avant la lettre; il révèle en fait une stratégie. Tout en avouant ou corrigeant certaines imperfections, Corneille rappelle sans cesse que l'orientation fondamentale de sa recherche esthétique est de plaire à plusieurs publics à la fois :
« Puisque nous faisons des poèmes pour être représentés, notre premier but doit être de plaire à la Cour et au peuple, et d'attirer un grand monde à leur représentation. Il faut, s'il se peut, y aiouter les règles, afin de ne pas déplaire aux savants, et recevoir un applaudissement universel » (dédicace de la Suivante).
De telles formules attestent une claire conscience de la répartition des pouvoirs entre les fractions du public, et la recherche de l’« applaudissement universel » fonde une « stratégie du succès », visant à l’audience la plus large possible. Mais cette multiple alliance entre l’écrivain et ses auditoires est aussi très précisément hiérarchisée : Corneille se soucie du goût des mondains (de la Cour et du peuple, à entendre ici comme les « honnêtes gens ») avant de se préoccuper des exigences « savantes ».
Il réalisa la synthèse des attentes de ces deux publics dans ses tragédies historiques. Il n’est pas l’inventeur de ce genre : la tragédie avait été remise en vogue dès 1634 par Rotrou (Hercule mourant), et la tragédie historique imposée l’année suivante par la Sophonisbe de Mairet et
la Mort de César de Scudéry — lui-même, poussé par la mode tragique, avait alors donné Médée (1635). Mais quand, en 1640, il inaugure avec Horace la série de ses grandes tragédies historiques, il en élabore un modèle original. Elles satisfont aux exigences des doctes et lui valent la consécration dans le genre théâtral alors le plus noble. Mais elles s’inscrivent aussi dans un cadre de référence familier au public mondain. Leurs sujets reprennent des épisodes de l’histoire romaine que l’« honnête homme » avait étudiée dans ses humanités. Plus même, suivant les analyses d’A. Stegmann, ils correspondent aux rares sujets d’histoire romaine que les jésuites (dont on sait le rôle essentiel dans l’enseignement à ce moment) retenaient pour leurs tragédies de collège. Les vues politiques, liées à une problématique d’actualité, qui s’y manifestent sont aussi conformes aux thèses des jésuites : condamnation du machiavélisme, appels à la clémence et à la conciliation. Cette influence est sensible jusqu'à Pertharite (1652). Le dialogue entre Corneille et son public se situe donc, au-delà des modes passagères, au plan de toute imprégnation culturelle et idéologique : surtout, dans une telle synthèse. Corneille apporte au théâtre de son temps plus qu’il ne lui a emprunté.
De fait, l’effort d’innovation a été constant chez lui. Dès ses comédies, il avait ouvert des voies nouvelles. C'est à juste titre qu’il écrit, dans VExamen de Mélite : « La nouveauté de ce genre de comédie, dont il n'y a point d'exemple en aucune langue, et le style naïf qui faisait une peinture de la conversation des honnêtes gens furent sans doute cause de ce bonheur qui fit alors tant de bruit ».
Il faut ajouter que la moindre originalité de l’entreprise n’était pas d’imposer à des salles volontiers turbulentes, voire agitées, un comique en demi-teintes comme celui de ces comédies.
Et cet effort d’innovation, sensible dans ses tragédies historiques et, plus largement, à travers la variété de son œuvre, se prolonge dans la dernière partie de sa carrière. Si son succès décline après 1660, ce n'est pas que son génie inventif soit épuisé. Mais les réalités politiques ont évolué, ainsi que le public, qui accorde ses préférences à une nouvelle dramaturgie. Celle-ci, d'ailleurs, s’élabore à partir du modèle cornélien avant de s’affirmer contre lui. Reste que Corneille a été reconnu comme un modèle pour le théâtre de son siècle; aussi pouvait-il écrire, en annonçant les Examens de ses pièces : « Je n’en dissimulerai point les défauts, et, en revanche, je me donnerai la liberté de remarquer ce que j’y trouverai de moins imparfait. Balzac accorde ce privilège à une certaine espèce de gens qu’ils peuvent dire par franchise ce que d’autres diraient d'eux-mêmes par vanité. Je ne sais si j'en suis; mais je veux avoir assez bonne opinion de moi pour n'en désespérer pas » (Discours du poème dramatique).
La dramaturgie cornélienne et l'esthétique de l'admiration
Dans sa dramaturgie, la variété des formes d’expression est grande. Deux aspects fondamentaux sont à retenir. En premier lieu, l’évolution de son esthétique ne se fait pas de façon linéaire : s’il a parcouru presque toute la hiérarchie des genres inscrite dans la poétique théâtrale de son temps, c’est au fil d’un itinéraire que l’on pourrait dire « en étoile ». Après sa première comédie, il passe à la tragi-comédie (Clitandre), puis revient à la comédie assez longuement avant d’aborder la tragédie; au temps de ses grandes tragédies historiques, il fait un retour à la comédie gaie (le Menteur et la Suite du Menteur); plus tard, après des tragédies sombres, il compose des « comédies héroïques » (Tite et Bérénice, Pulchérie) dans la lignée du Cid... Ses pièces se groupent ainsi par petites séries qui explorent chacune les diverses ressources d’un registre d’expression. Autre trait remarquable, il va volontiers vers des extrêmes contrastés : écriture baroque et spectacle foisonnant de Clitandre (ou, plus tard, de la Toison d'or) et composition régulière et décor de « palais à volonté » de Cinna; variante de ce contraste : le passage au sein du registre tragique, du mythe païen violent de Médée à la générosité héroïque de Nicomède ou à l’ordre mystique de Polyeucte. Variété, donc, et si patente qu’il est impossible de ranger l’œuvre de Corneille dans quelque grande catégorie que ce soit, baroque ou classique : participant de l’une et de l’autre, elle les dépasse et a même pu leur servir de modèle.
Mais à travers cette diversité, des indices d’unité sont sensibles. Sur le plan des formes d’expression, le registre des pièces héroïques à fin heureuse est dominant. Et si l’on envisage les structures de la dramaturgie, les éléments d’unité sont plus nets encore. A cet égard, les Discours et Examens de 1660, rédigés en partie pour réfuter des critiques de l’abbé d’Aubignac, constituent un outil d’analyse d’une pertinence irremplaçable.
Pour Corneille, « la poésie dramatique a pour but le seul plaisir des spectateurs » (Discours du poème dramatique); mais elle est aussi, à travers ce plaisir même, un moyen didactique : en incluant dans le texte des propos de portée générale, en peignant vices et vertus, en suscitant l’identification du spectateur au héros, le théâtre peut éduquer son public; mais surtout, pour la tragédie, il est le lieu d’une catharsis. Commentant la doctrine d’Aristote, Corneille ajoute à la catharsis par la terreur et la pitié définie dans la Poétique celle de l’admiration (au sens propre). Le spectateur moderne, en effet, vivant dans un univers politique et religieux hiérarchisé et stable, n’a pas à en redouter les brusques distorsions, mais à admirer, et donc partager, la force d’être dans cet univers. L'Examen de Nicomède et la pièce elle-même illustrent cela de façon exemplaire. Cette esthétique repose donc sur la lucidité et la force de héros capables de mener leur éthique jusqu’à son terme. Elle s’accorde mal avec le cadre de référence mythologique ancien, et Corneille a peu utilisé celui-ci sauf pour des pièces à machines, grands spectacles de divertissement, ou bien en faisant subir à la légende des modifications (Œdipe).
Baignée de cette éthique néo-stoïcienne, la dramaturgie cornélienne trouve sa pleine expansion dans la tragédie historique à fin heureuse : au terme d’une épreuve, force et lucidité triomphent dans l’acte de générosité et de pardon qui dénoue l’action (le Cid, Horace, Cinna).
Mais l’admiration exige, dans la technique dramatique, des effets étonnants et soutenus. Chez Corneille, l’action est le plus souvent dense, rapide, « chargée de matière », avec de fréquents rebondissements. Le sujet importe plus que les caractères, qui sont construits selon la dynamique du conflit qu’ils représentent plutôt que selon les subtilités de l’analyse : ce sont, selon les termes du temps, des « acteurs » plutôt que des « personnages », des éléments d’une dynamique plus que des êtres dont la peinture trouve sa fin en elle-même. La rhétorique abonde donc en « discours » et débats (tirades), parfois intérieurs (monologues et, dans leur forme la plus poétisée, stances), et, sur le plan de Velocutio, en figures nombreuses et variées, puisées dans le registre des effets destinés à « émouvoir » (antithèses, vocatifs, interpellations, etc.). Le vocabulaire, assez restreint, s’ordonne autour de termes clefs tels que « gloire », « devoir », « mérite », « honneur ».
Cette dramaturgie ne s’accorde que difficilement avec les « règles » et les contraintes de la bienséance étroite; l’ironie de Corneille est, à cet égard, mordante : « Il faut observer l’unité d’action, de lieu et de jour, personne
n’en doute; mais ce n’est pas une petite difficulté de savoir ce que c’est que cette unité d’action, et jusques où peut s’étendre cette unité de jour et de lieu » (Discours du poème dramatique). Il adopte une position moyenne : l’unité de temps peut, selon lui, s’étendre à trente heures; l’unité de lieu à l’espace d’une ville; la liberté de l’auteur ne doit pas être excessivement bornée. L’unité d’action « consiste, dans la comédie, en l’unité d’intrigue ou d’obstacle aux desseins des principaux acteurs, et en l’unité de péril » (Discours des trois unités). L’unité d’intrigue ou, surtout, de péril permet d’intégrer, pourvu que la cohérence soit sans faille, des conflits multiples à une même ligne de force : ainsi une action foisonnante devient possible; les événements nombreux du Cid, par exemple, forment donc un tout centré sur le péril qui menace le héros.
Le même principe qui privilégie l’admiration, l’effet extraordinaire, guide Corneille dans son rapport aux bienséances : il les respecte, mais refuse d’éliminer par pusillanimité un bel effet. Le Discours de la tragédie détaille la dialectique du « vraisemblable », du « vrai » et du « nécessaire ». Le genre pratiqué a ses exigences, qui font le nécessaire; face au vraisemblable, Corneille n’hésite pas à préférer le « vrai » (le mariage de Rodrigue et Chimène est contre les bienséances, mais il est vrai), ou à définir un « vraisemblable extraordinaire » qui, pour construire une action exemplaire, dépasse la vérité particulière (le vrai historique) et le vraisemblable ordinaire (la bienséance timide) : par exemple, Nicomède ou Héraclius font subir à l’histoire des modifications, mais permettent ainsi d’organiser une intrigue propice à l’effet d’admiration.
Les sources ne peuvent donc pas être non plus des contraintes absolues. Corneille prend d’ailleurs plaisir, dans ses préfaces et Examens, à manifester son érudition (vers les doctes) tout en les appelant au critère décisif du succès (mondain).
Sa dramaturgie, aussi indépendante que possible et novatrice, trace donc, entre la discontinuité des pièces baroques, les tentations de la tragédie romanesque (où s’illustrait son frère) et la régularité classique, une voie originale.
La dramaturgie cornélienne et la crise des valeurs nobiliaires
Dans cette esthétique de l’admiration, le conflit dramatique fondamental s’organise autour d’un personnage confronté à la difficulté d'exercer sa liberté de décision et d’action. Dans les comédies, cette liberté se heurte à l’emprise de la passion amoureuse, née dans l’éblouissement du premier regard : la lutte s’engage alors entre le désir d’indépendance et d’affirmation de soi du personnage central et le devoir amoureux que la passion impose. Dans les tragédies (et en cela, la cohérence structurelle de l’œuvre est, au sein de sa variété, remarquable), la volonté d’affirmation de soi s’exprime dans le désir de « gloire », volonté d’imposer la reconnaissance du mérite personnel. Le conflit tragique se construit entre celui-ci, les obligations de lignage (l’honneur), du service de l’État (le devoir) et de l’éthique amoureuse. Ainsi se réalise l’alliage de réflexion politique et d’essai d’éthique individuelle qui caractérise le théâtre cornélien.
Certes, sa variété confère à celui-ci des significations multiples : regards sur la morale amoureuse, analyse politique, observations sur le présent, inspiration religieuse (sensible dans les tragédies et prolongée par la traduction de l’Imitation de Jésus-Christ) et méditation sur l’histoire s’y conjuguent.
Mais l’existence d’un « noyau » dramatique permanent incite à rechercher une perspective d’interprétation capable de dégager les lignes de force de ces significations. La plus probante est celle qui se fonde sur le rapport avec le public essentiel, le public nobiliaire.
C’est à travers le prisme de l’œuvre d’art que les vues et attitudes de l’ordre nobiliaire apparaissent dans le théâtre cornélien. L’image qu’il en donne est celle d’une problématique et non la transcription ou le reflet direct de faits d’actualité. Ceux-ci pouvaient susciter la réflexion sur tel ou tel aspect des pratiques politiques (Cinna s’inscrit ainsi dans un contexte où la révolte des Va-nu-pieds normands et sa répression avaient attiré l’attention sur le choix entre punition et pardon), mais il s’agit seulement d’échos, non du sujet lui-même. La problématique se situe donc sur le plan de l’idéologie.
Le héros cornélien est porteur des valeurs nobiliaires; le conflit dramatique est symbole de la confrontation de celles-ci avec une situation historique où elles trouvent difficilement leur place, le renforcement de l'Etat monarchique limitant la liberté de l’aristocratie (interdiction
du duel, diminution des pouvoirs des gouverneurs de province, etc.). Les valeurs nobiliaires, nées dans l’ordre féodal et foncièrement individualistes et/ou gentilices, ne s’intégrent pas sans crise à ce nouvel ordre, dans lequel l’Etat domine l’individu et le lignage. La tragédie historique à fin heureuse correspond, sur le plan idéologique, à une image de conciliation entre les dynamiques nobiliaires et étatiques. Mais lorsque le détenteur du pouvoir impose des exigences abusives, ou, pire encore, lorsque le pouvoir devient une fin en soi et nie toutes les valeurs et aspirations individuelles, la tragédie dérive vers une vision pessimiste. Au fil de l’œuvre cornélienne se dessinent diverses spécifications de cette crise d’adaptation (temps d’espoirs à l’époque de Louis XIII, d'inquiétudes et de désillusions, mais avec des retours optimistes ensuite) qui éclairent chaque pièce et révèlent, dans l'ordre symbolique, au-delà des constantes de la pensée politique de Corneille (respect de la monarchie, loyauté, conciliation), la vision qu'il avait de son temps.