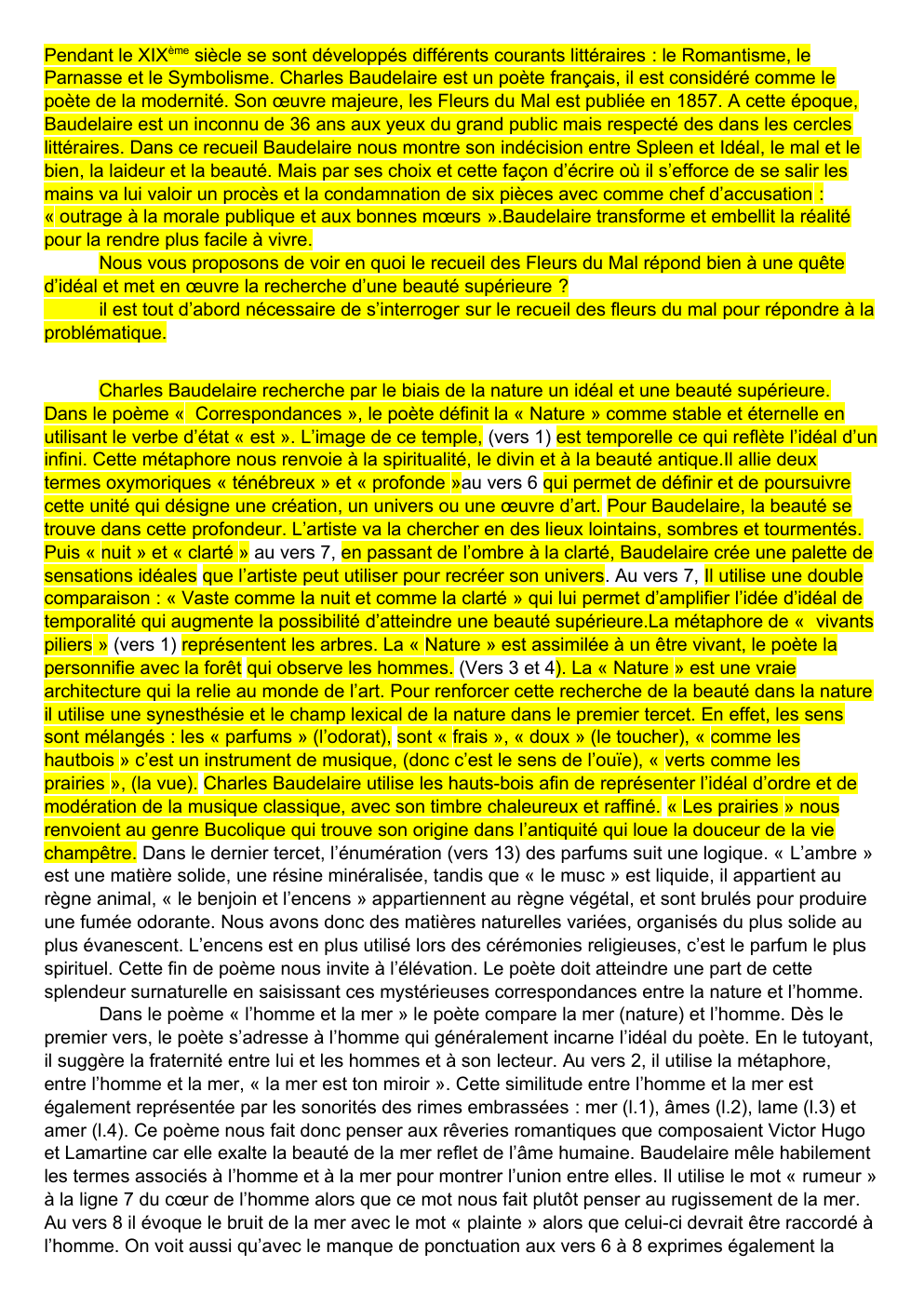Dissertation sur Baudelaire: Idéal et beauté
Publié le 15/01/2023
Extrait du document
«
Pendant le XIXème siècle se sont développés différents courants littéraires : le Romantisme, le
Parnasse et le Symbolisme.
Charles Baudelaire est un poète français, il est considéré comme le
poète de la modernité.
Son œuvre majeure, les Fleurs du Mal est publiée en 1857.
A cette époque,
Baudelaire est un inconnu de 36 ans aux yeux du grand public mais respecté des dans les cercles
littéraires.
Dans ce recueil Baudelaire nous montre son indécision entre Spleen et Idéal, le mal et le
bien, la laideur et la beauté.
Mais par ses choix et cette façon d’écrire où il s’efforce de se salir les
mains va lui valoir un procès et la condamnation de six pièces avec comme chef d’accusation :
« outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs ».Baudelaire transforme et embellit la réalité
pour la rendre plus facile à vivre.
Nous vous proposons de voir en quoi le recueil des Fleurs du Mal répond bien à une quête
d’idéal et met en œuvre la recherche d’une beauté supérieure ?
il est tout d’abord nécessaire de s’interroger sur le recueil des fleurs du mal pour répondre à la
problématique.
Charles Baudelaire recherche par le biais de la nature un idéal et une beauté supérieure.
Dans le poème « Correspondances », le poète définit la « Nature » comme stable et éternelle en
utilisant le verbe d’état « est ».
L’image de ce temple, (vers 1) est temporelle ce qui reflète l’idéal d’un
infini.
Cette métaphore nous renvoie à la spiritualité, le divin et à la beauté antique.Il allie deux
termes oxymoriques « ténébreux » et « profonde »au vers 6 qui permet de définir et de poursuivre
cette unité qui désigne une création, un univers ou une œuvre d’art.
Pour Baudelaire, la beauté se
trouve dans cette profondeur.
L’artiste va la chercher en des lieux lointains, sombres et tourmentés.
Puis « nuit » et « clarté » au vers 7, en passant de l’ombre à la clarté, Baudelaire crée une palette de
sensations idéales que l’artiste peut utiliser pour recréer son univers.
Au vers 7, Il utilise une double
comparaison : « Vaste comme la nuit et comme la clarté » qui lui permet d’amplifier l’idée d’idéal de
temporalité qui augmente la possibilité d’atteindre une beauté supérieure.La métaphore de « vivants
piliers » (vers 1) représentent les arbres.
La « Nature » est assimilée à un être vivant, le poète la
personnifie avec la forêt qui observe les hommes.
(Vers 3 et 4).
La « Nature » est une vraie
architecture qui la relie au monde de l’art.
Pour renforcer cette recherche de la beauté dans la nature
il utilise une synesthésie et le champ lexical de la nature dans le premier tercet.
En effet, les sens
sont mélangés : les « parfums » (l’odorat), sont « frais », « doux » (le toucher), « comme les
hautbois » c’est un instrument de musique, (donc c’est le sens de l’ouïe), « verts comme les
prairies », (la vue).
Charles Baudelaire utilise les hauts-bois afin de représenter l’idéal d’ordre et de
modération de la musique classique, avec son timbre chaleureux et raffiné.
« Les prairies » nous
renvoient au genre Bucolique qui trouve son origine dans l’antiquité qui loue la douceur de la vie
champêtre.
Dans le dernier tercet, l’énumération (vers 13) des parfums suit une logique.
« L’ambre »
est une matière solide, une résine minéralisée, tandis que « le musc » est liquide, il appartient au
règne animal, « le benjoin et l’encens » appartiennent au règne végétal, et sont brulés pour produire
une fumée odorante.
Nous avons donc des matières naturelles variées, organisés du plus solide au
plus évanescent.
L’encens est en plus utilisé lors des cérémonies religieuses, c’est le parfum le plus
spirituel.
Cette fin de poème nous invite à l’élévation.
Le poète doit atteindre une part de cette
splendeur surnaturelle en saisissant ces mystérieuses correspondances entre la nature et l’homme.
Dans le poème « l’homme et la mer » le poète compare la mer (nature) et l’homme.
Dès le
premier vers, le poète s’adresse à l’homme qui généralement incarne l’idéal du poète.
En le tutoyant,
il suggère la fraternité entre lui et les hommes et à son lecteur.
Au vers 2, il utilise la métaphore,
entre l’homme et la mer, « la mer est ton miroir ».
Cette similitude entre l’homme et la mer est
également représentée par les sonorités des rimes embrassées : mer (l.1), âmes (l.2), lame (l.3) et
amer (l.4).
Ce poème nous fait donc penser aux rêveries romantiques que composaient Victor Hugo
et Lamartine car elle exalte la beauté de la mer reflet de l’âme humaine.
Baudelaire mêle habilement
les termes associés à l’homme et à la mer pour montrer l’union entre elles.
Il utilise le mot « rumeur »
à la ligne 7 du cœur de l’homme alors que ce mot nous fait plutôt penser au rugissement de la mer.
Au vers 8 il évoque le bruit de la mer avec le mot « plainte » alors que celui-ci devrait être raccordé à
l’homme.
On voit aussi qu’avec le manque de ponctuation aux vers 6 à 8 exprimes également la
beauté de cette union amoureuse.
Dans le dernier quatrain Baudelaire oppose dans un combat cruel
entre l’homme et la mer toutefois ils sont liés comme le démontre l’oxymore « frères implacables »
qui fusionne dans la fraternité et la rivalité à la ligne 16.
Par ailleurs Baudelaire peut également faire le lien entre la nature et l’homme en recherchant
une quête d’idéal et de beauté supérieur par le désir d’élévation.
D’ailleurs le poème de
« L’albatros » se passe encore dans un cadre maritime.
L’albatros décrit par Baudelaire est désigné
par des périphrases qui soulignent la grandeur et la majesté de cet oiseau : « vaste oiseaux des
mers » (v.2), « compagnons de voyage » (v.3), « rois de l’azur » (v.6) ou encore « prince des
nuées » (v.13).
Nous observons que ces périphrases soulignent la symbiose entre l’albatros et son
milieu avec « vaste » au vers 2 et « azur » au vers 3.
Ces adjectifs qualifiants les albatros peuvent
aussi convenir pour au paysage marins dans lesquelles ils....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Plan de dissertation explicative : Hymne à la beauté (Baudelaire)
- BAUDELAIRE: « Spleen et idéal », « La Beauté » - commentaire
- dissertation Baudelaire: comment le poète transforme-t-il le laid en beau ?
- Etude linéaire - Spleen et Idéal, Les Fleurs du mal, Charles Baudelaire
- Baudelaire Dissertation: De la laideur et de la sottise il fera naître un nouveau genre d’enchantements