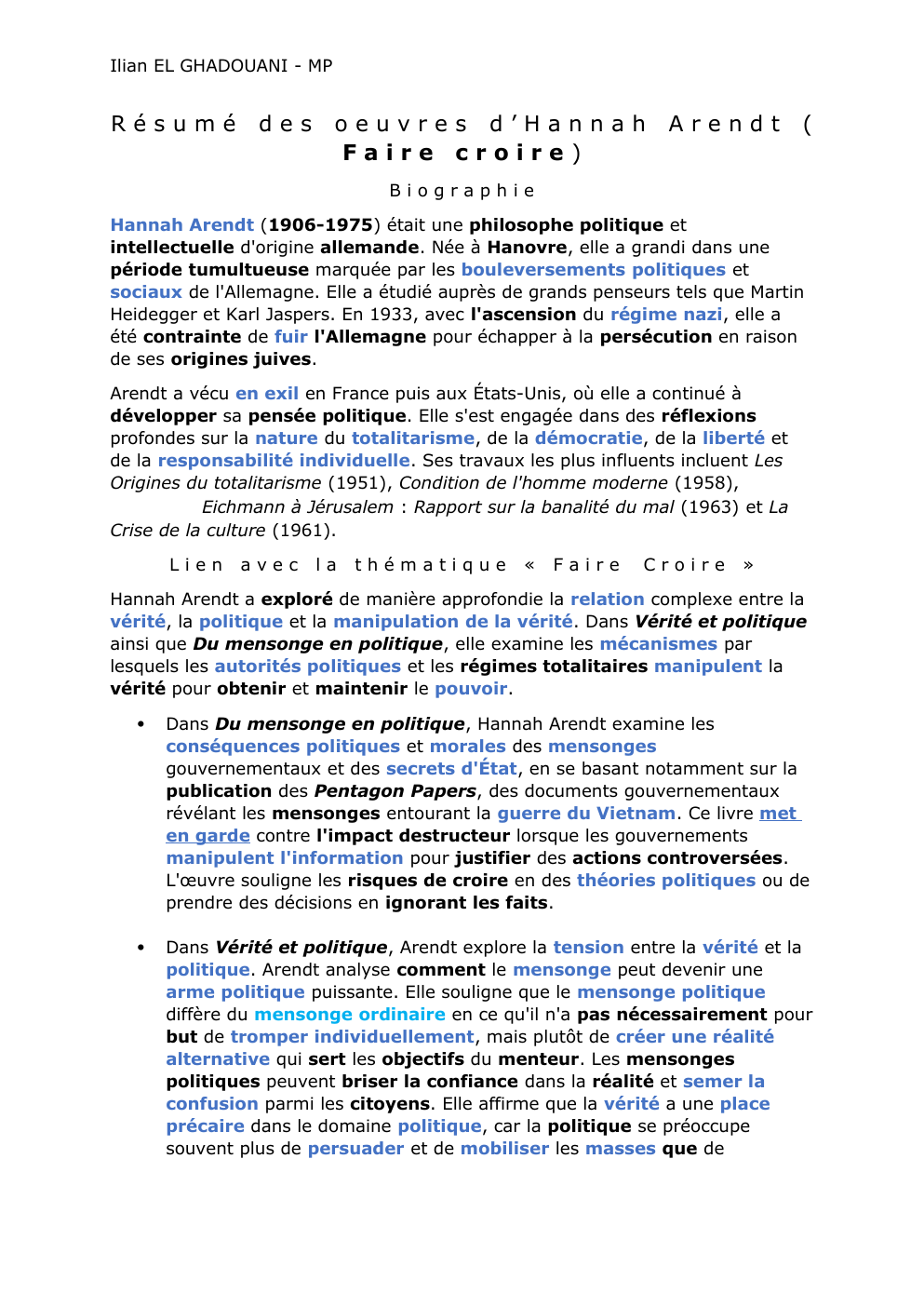Etude des deux oeuvres d'Hannah Arendt au programme CPGE 2023/2024
Publié le 09/12/2023
Extrait du document
«
Résumé
des
oeuvres d’Hannah
Faire croire)
Arendt
(
Biographie
Hannah Arendt (1906-1975) était une philosophe politique et
intellectuelle d'origine allemande.
Née à Hanovre, elle a grandi dans une
période tumultueuse marquée par les bouleversements politiques et
sociaux de l'Allemagne.
Elle a étudié auprès de grands penseurs tels que Martin
Heidegger et Karl Jaspers.
En 1933, avec l'ascension du régime nazi, elle a
été contrainte de fuir l'Allemagne pour échapper à la persécution en raison
de ses origines juives.
Arendt a vécu en exil en France puis aux États-Unis, où elle a continué à
développer sa pensée politique.
Elle s'est engagée dans des réflexions
profondes sur la nature du totalitarisme, de la démocratie, de la liberté et
de la responsabilité individuelle.
Ses travaux les plus influents incluent Les
Origines du totalitarisme (1951), Condition de l'homme moderne (1958),
Eichmann à Jérusalem : Rapport sur la banalité du mal (1963) et La
Crise de la culture (1961).
Lien
avec
la
thématique
«
Faire
Croire
»
Hannah Arendt a exploré de manière approfondie la relation complexe entre la
vérité, la politique et la manipulation de la vérité.
Dans Vérité et politique
ainsi que Du mensonge en politique, elle examine les mécanismes par
lesquels les autorités politiques et les régimes totalitaires manipulent la
vérité pour obtenir et maintenir le pouvoir.
Dans Du mensonge en politique, Hannah Arendt examine les
conséquences politiques et morales des mensonges
gouvernementaux et des secrets d'État, en se basant notamment sur la
publication des Pentagon Papers, des documents gouvernementaux
révélant les mensonges entourant la guerre du Vietnam.
Ce livre met
en garde contre l'impact destructeur lorsque les gouvernements
manipulent l'information pour justifier des actions controversées.
L'œuvre souligne les risques de croire en des théories politiques ou de
prendre des décisions en ignorant les faits.
Dans Vérité et politique, Arendt explore la tension entre la vérité et la
politique.
Arendt analyse comment le mensonge peut devenir une
arme politique puissante.
Elle souligne que le mensonge politique
diffère du mensonge ordinaire en ce qu'il n'a pas nécessairement pour
but de tromper individuellement, mais plutôt de créer une réalité
alternative qui sert les objectifs du menteur.
Les mensonges
politiques peuvent briser la confiance dans la réalité et semer la
confusion parmi les citoyens.
Elle affirme que la vérité a une place
précaire dans le domaine politique, car la politique se préoccupe
souvent plus de persuader et de mobiliser les masses que de
Ilian EL GHADOUANI - MP
rechercher la vérité.
Elle souligne également que la vérité est souvent
éclipsée par les intérêts partisans et les manipulations politiques.
Le concept d'événement est crucial dans la pensée d'Arendt.
Elle considère que
les moments où les gens se rassemblent et agissent ensemble dans le
domaine public sont essentiels pour maintenir une démocratie vibrante.
Lorsque la vérité est bafouée et que la réalité est manipulée, la capacité des
individus à s'engager dans des discussions et à agir de manière informée est
compromise, ce qui menace la démocratie elle-même.
En résumé, Hannah Arendt a consacré une grande partie de sa réflexion à la
manière dont la vérité, les mensonges et la manipulation de la réalité
interagissent avec la politique.
Elle a mis en garde contre les conséquences
dangereuses de la désinformation et de la manipulation de la vérité pour
la démocratie et la liberté individuelle.
I)
« Du mensonge en politique », Du mensonge à la
violence
Contexte : 1972, Guerre du Vietnam (1955-1975).
USA sous Richard Nixon
(1969-1974 (Watergate)).
Les documents du Pentagone sont dévoilés en 1971 par la presse.
Ceux-ci
laissent transparaître des mensonges officiels des Etats-Unis dans la guerre du
Vietnam.
P.11-68 : « Du mensonge en politique »
Robert S.
McNamara : homme politique à la tête du Pentagone.
I
Guerre du Vietnam débouche probablement de l’idéologie anticommuniste (suit la
guerre d’Indochine 1946-1954)
P.17-19 : Deux méthodes de mensonges apparaissent.
La première s’observe
dans les relations publiques : l’image que l’on se donne.
Elle découle de la
société de consommation : se forger une image en politique.
P.21 : « Ils étaient persuadés que la politique n’est qu’une variété des
relations publiques »
P.22 : Comparaison à des publicitaires, des « fabricants ordinaires d’images de
marque » : l’image.
« Leur amour (…) de l’univers purement intellectuel, leur faisait rejeter tout
« sentimentalisme » à un point assez effrayant.
»
« Ils s’efforçaient de découvrir des lois permettant d’expliquer l’enchaînement
des faits historiques et politiques » : scientifisation de l’histoire et de la
politique.
Mais l’historien et l’homme politique traitent de problèmes humains.
Ilian EL GHADOUANI - MP
Capacité d’action de l’homme : « relative liberté dont il dispose par rapport
à ce qu’il est ».
Rejet de la contingence (ce qui peut être ou ne pas être).
Seul un acte de
destruction radicale permet de se débarrasser des faits.
II
P.29 : « ‘’Persuader le monde’’ ; prouver que ‘’les Etats-Unis étaient un ‘’bon
médecin’’, soucieux de tenir ses promesses (…)’’ ».
P.29 : « En résumé, ‘’nous comporter (c’est nous qui soulignons) comme la
plus grande puissance du monde’’ pour la seule raison qu’il nous faut
convaincre le monde de ce ‘’simple fait’’ (comme le déclarait Walt Rostow) »
P.30 : « empruntés au vocabulaire du théâtre ».
On parle de scène
internationale : la politique comme pièce de théâtre.
P.30 : « chercher, non pas la conquête du monde, mais à l’emporter dans une
bataille dont l’enjeu est ‘’l’esprit des gens’’ ».
P.31 : « Des dirigeants élus (…) croient en la toute-puissance de la
manipulation sur l’esprit des hommes et pensent qu’elle peut permettre de
dominer réellement le monde.
»
P.31 : « Cette entreprise axée sur l’imaginaire »
P.33 : « Eloignement des réalités »
III
P.
38 : « Il y a une disparité totale entre les faits (…) et les prémisses, les
théories et les hypothèses qui servent souvent de base aux décisions.
»
McNaughton, 1967 (P.
43) : « Beaucoup estiment que nous tentons d’imposer
par la force une certaine image de l’Amérique à des peuples lointains que
nous ne comprenons pas… et que cette tentative est poussée jusqu’à
l’absurde.
»
Point important : « l’usage exagéré du secret ».
(P.
46)
Rapprochement de la Chine et des Etats-Unis ignoré par les responsables.
Au
contraire, ceux-ci voient en la guerre du Vietnam un moyen de lutter contre
l’expansion du communisme.
P.46-47 « Les responsables, qui ont toute latitude d’accéder aux sources,
demeurent eux-mêmes tranquillement plongés dans leur ignorance.
»
P.47 : La raison : « Leurs conditions de travail et leurs habitudes de pensée
ne leur laissaient ni le temps, ni le désir de rechercher quelques faits
inutilisables »
P.47 : « Ces brumes de mystère dont s’entourent les services
gouvernementaux ont si bien pénétré dans l’esprit des autorités
responsables »
Ilian EL GHADOUANI - MP
→
Cela questionne la nécessité d’un secret d’Etat, en latin les arcana imperii
(P.
47).
M.
Rusk décrit un « marathon de campagnes d’informations » (P.
47)
Failles dans le mensonge qui peut « avoir un effet contraire au but
recherché, c’est-à-dire de répandre la confusion au lieu de convaincre »
(P.48).
P.
48 : « La vérité, même si elle ne s’impose pas publiquement, possède en
regard de tous les mensonges une inaliénable primauté ».
Dans le cas du Vietnam : confusion, mensonge.
Mais aussi : « Les
responsables des décisions paraissent ignorer (…) le différend, vieux de dix
ans, entre Moscou et Pékin » (P.
48).
(!) « La culture très ancienne et évoluée » du Vietnam est en contradiction
avec l’image très répandue d’une « ‘’petite nation arriérée’’ ne s’intéressant
pas aux nations ‘’civilisées’’ ».
Le Vietnam n’est en réalité pas d’une grande « importance stratégique »
pour les Etats-Unis.
(P.
49)
P.
49 : « L’échec désastreux de la politique américaine d’intervention armée
[résulte] (…) du refus délibéré et obstiné, depuis plus de vingt-cinq ans, de
toutes les réalités, historiques, politiques et géographiques.
»
IV
Ellsberg qualifie l’enlisement de modèle « mythique ».
Sa question : « Comment ont-ils pu ? » → « la tromperie et
l’autosuggestion » (P.
51)
Autosuggestion : Techniques d’auto-persuasion
Contexte (P.
50) : « A la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Etats-Unis
étaient le pays le plus riche et la puissance dominante dans le monde ».
Scandale du Watergate : « L’image du président Nixon, parlant du ‘’géant
impuissant et pitoyable’’, dépeint (…) l’état de la ‘’plus grande puissance
mondiale’’.
»
L’image « du triomphe de David sur Goliath » (P.
51), du Vietnam sur les
Etats-Unis.
P.
51 : « Les déclarations publiques devaient l’emporter du seul fait
qu’elles étaient publiques.
»
Arendt, P.
51 : « Plus un trompeur est convaincant et réussit à
convaincre, plus il a de chances de croire lui-même à ses propres
mensonges.
»
Ellsberg, P.
52 : Le « processus ‘’d’autosuggestion interne’’ » a eu un effet
inverse.
Ilian EL GHADOUANI - MP
P.
52 : « Les trompeurs ont commencé par....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- ETUDE DE TEXTE: Hannah ARENDT, La Crise de la culture.
- Hannah Arendt, Journal de pensée, (1953) – traduction Sylvie Courtine-Denamy
- explication de texte hannah Arendt violence et histoire
- ORIGINES DU TOTALITARISME (LES), Hannah Arendt - résumé de l'oeuvre
- Hannah Arendt : La crise de la culture, Qu’est-ce que l’autorité