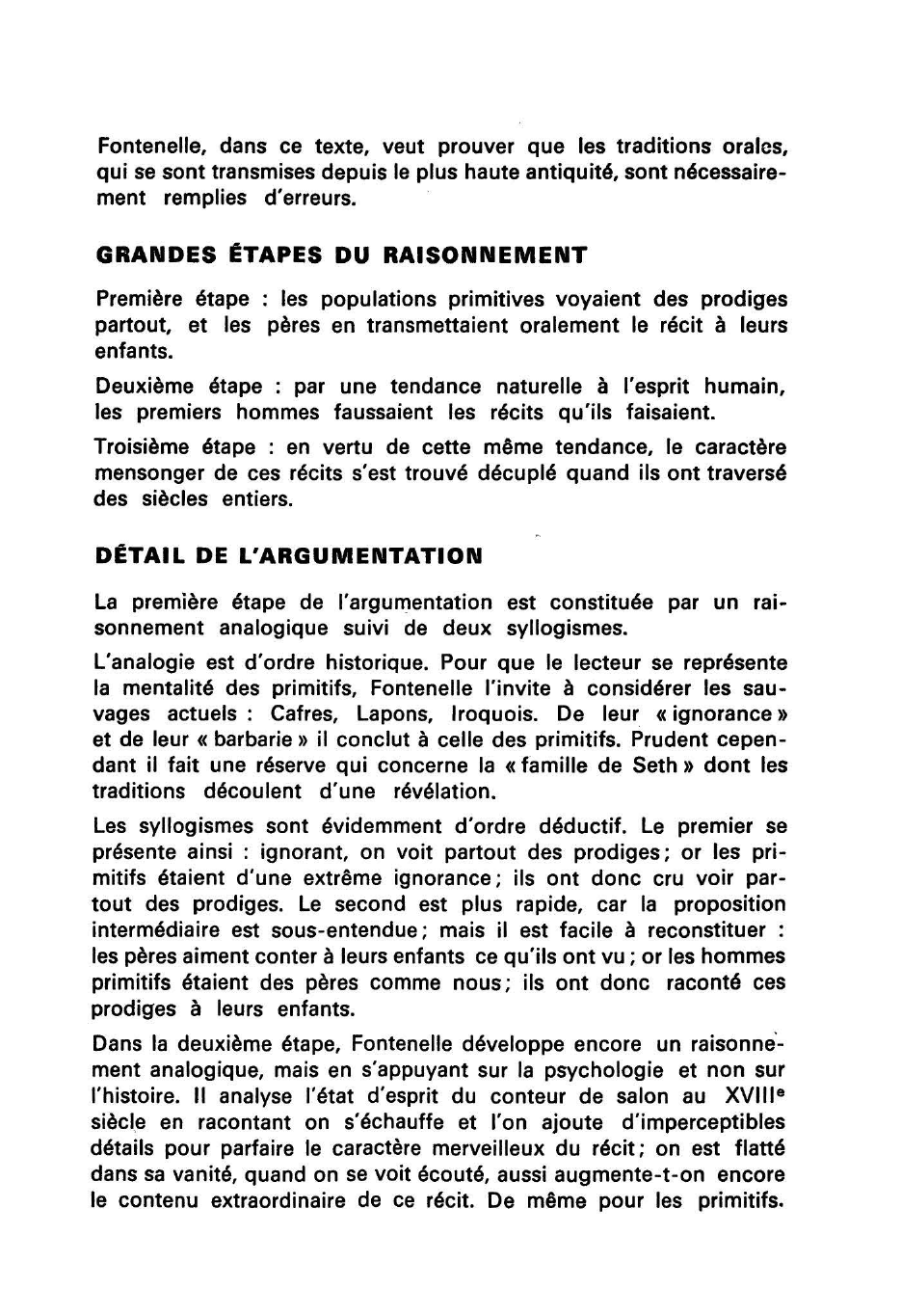FONTENELLE, De l'Origine des Fables.
Publié le 10/10/2011

Extrait du document

QUAND nous racontons quelque chose de surprenant, notre imagination s'échauffe sur son objet, et se porte d'elle-même à l'agrandir et à y ajouter ce qui y manquerait pour le rendre tout à fait merveilleux, comme si elle avait regret de laisser une belle chose imparfaite. De plus, on est flatté des sentiments de surprise et d'admiration que l'on cause à ses auditeurs, et on est bien aise de les augmenter encore, parce qu'il semble qu'il en revient je ne sais quoi à notre vanité....
Première étape : les populations primitives voyaient des prodiges partout, et les pères en transmettaient oralement le récit à leurs enfants.
Deuxième étape : par une tendance naturelle à !"esprit humain, les premiers hommes faussaient les récits qu'ils faisaient.

«
Fontenelle, dans ce texte, veut prouver que les traditions orales, qui se sont transmises depuis le plus haute antiquité, sont nécessaire
ment remplies d'erreurs.
GRANDES ~TAPES DU RAISONNEMENT
Première étape : les populations primitives voyaient des prodiges
partout, et les pères en transmettaient oralement le récit à leurs enfants.
Deuxième étape : par une tendance
naturelle à !"esprit humain, les premiers hommes faussaient les récits qu'ils faisaient.
Troisième étape :
en vertu de cette même tendance, le caractère
mensonger de ces récits s'est trouvé décuplé quand ils ont traversé
des siècles entiers.
D~TAIL DE L'ARGUMENTATION
La première étape de !"argumentation est constituée par un rai
sonnement analogique suivi de deux syllogismes.
L'analogie
est d'ordre historique.
Pour que le lecteur se représente la mentalité des primitifs, Fontenelle l'invite à considérer les sau
vages actuels : Cafres, Lapons, Iroquois.
De leur « ignorance» et de leur «barbarie» il conclut à celle des primitifs.
Prudent cepen
dant il fait une réserve qui concerne la «famille de Seth» dont les traditions découlent d'une révélation.
Les syllogismes sont évidemment d'ordre déductif.
Le premier se présente ainsi : ignorant, on voit partout des prodiges; or les pri
mitifs étaient d'une extrême ignorance; ils ont donc cru voir par
tout des prodiges.
Le second est plus rapide, car la proposition
intermédiaire est sous-entendue; mais il est facile à reconstituer : les pères aiment conter à leurs enfants ce qu'ils ont vu; or les hommes
primitifs étaient des pères comme nous; ils ont donc raconté ces
prodiges à leurs enfants.
Dans
la deuxième étape, Fontenelle développe encore un raisonne· ment analogique, mais en s'appuyant sur la psychologie et non sur !"histoire.
Il analyse l"état d'esprit du conteur de salon au XVIIIe
siècl .e en racontant on s'échauffe et l"on ajoute d'imperceptibles détails pour parfaire le caractère merveilleux du récit; on est flatté dans sa vanité, quand on se voit écouté, aussi augmente-t-on encore le contenu extraordinaire de ce récit.
De même pour les primitifs..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Comment l’astronomie, la navigation et le calcul bancaire sont-ils à l’origine de l’invention des logarithmes ?
- De l'origine des espèces de Charles Darwin (résumé et analyse)
- Dissertation Fables: II y a longtemps que les fables ne nous intéressent plus pour la moralité
- Le pragmatisme dans les fables de La Fontaine
- THEME 1 : La Terre, la vie et l’organisation du vivant Partie A : Génétique et évolution Chapitre 1 : L’origine du génotype des individus