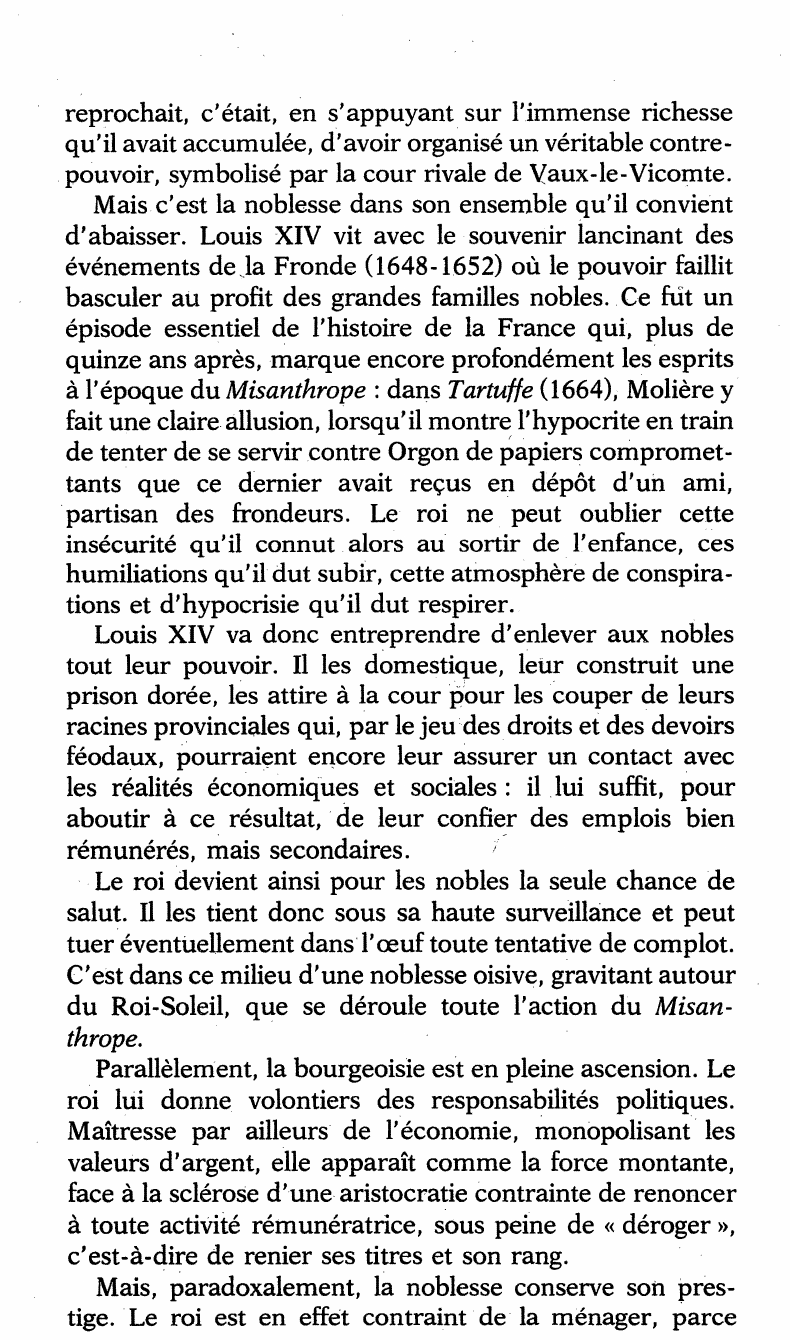« Le Misanthrope » et son temps
Publié le 02/03/2020

Extrait du document

• L'amour
Il devient un véritable jeu, mais un jeu sérieux ; il se substitue à la guerre, ce qui explique le fréquent recours à des images guerrières dans le langage de la passion. On sera amené à constater, dans Le Misanthrope, l’importance des intrigues amoureuses : Alceste peut songer à la fois à Célimène, à Arsinoé et à Eliante, tandis que Célimène est poursuivie (à la fois) par Alceste, Oronte, Acaste et Clitandre.
• La littérature
Les nobles sont de plus en plus nombreux à se lancer dans une activité littéraire qui leur permet d’affirmer leur personnalité et de créer une réalité plus satisfaisante, en se berçant dans la fiction. Certes, souvent, les œuvres ainsi composées ne manquent pas de valeur : il suffit de citer l’auteur des Maximes, La Rochefoucauld, ou le mémorialiste Saint-Simon. Mais ce n’est parfois aussi qu’une manie à la mode dont Oronte et son sonnet offrent une illustration caricaturale.
• La conversation
Elle est un véritable art de se comporter et de paraître, un moyen de s’illustrer, de briller, en évitant de trop se mettre en avant, un moyen de s’attirer la sympathie des autres, à coups de flatteries et d’hypocrisies : Alceste s'insurgera, tout au long du Misanthrope, contre cette pratique.
A ces activités qui laissent encore une assez large part à l’interprétation individuelle, s'en ajoutent d'autres davantage marquées par le formalisme ; à la cour règne une étiquette rigide dont les courtisans et le roi sont esclaves et qui renforce la théâtralisation d'une existence soumise aux règles et aux apparences. Ce degré d’intégration et de dépendance, le bon courtisan doit l'atteindre pour mériter sa réputation d’« honnête homme ». Il doit se soumettre, mais sans excès ; il doit en tout choisir la voie du juste milieu, éviter de se placer en marge et, pour ce faire, rejeter à la fois la surenchère dans l’acceptation et la démesure dans le refus. C’est cette normalité que défendra Philinte du Misanthrope, dans sa double condamnation des positions d’Alceste et de Célimène.
• Tragédie et tragi-comédie
La tragédie demeure minoritaire : Racine est au début de sa carrière et, malgré les efforts de Corneille, le genre tragique est encore supplanté par la tragi-comédie, aux sujets complexes, aux revirements inattendus, aux amours contrariées, qui permet l’expression de tout un discours précieux. Molière lui-même ne dédaignera pas cette inspiration : il s’y essaiera, sans beaucoup de succès il est vrai, avec Dom Garde de Navarre. Mais, de façon plus insidieuse, la tension tragi-comique, voire la fatalité tragique, prennent parfois place dans ses comédies : dans Le Misanthrope, Alceste vit un véritable calvaire car il est non seulement affronté à des obstacles extérieurs redoutables de tragi-comédie, mais encore confronté à sa propre contradiction, obstacle intérieur d’essence tragique.
• Comédie d'intrigue, de mœurs et de caractères
Dans le domaine comique, le schéma de la comédie d’intrigue est encore vivace et marque de sa présence la plupart des œuvres de Molière. Il se construit sur deux niveaux et permet ainsi de répondre à une double attente du spectateur : le goût pour les bons sentiments se trouve comblé, à la vue des efforts de deux amoureux sympathiques, aidés par des serviteurs rusés, pour conquérir le bonheur. Mais le public est également venu pour rire et il sera satisfait grâce à la présence de personnages ridicules hauts en couleur.
Dans Le Misanthrope, ce schéma traditionnel de la comédie d’intrigue est quelque peu tronqué : Alceste aime Célimène, mais l’amour de Célimène pour Alceste n’est pas évident. D’autre part, les deux personnages ont à lutter contre eux-mêmes plutôt que contre des obstacles extérieurs ; dans ces conditions, ils n’ont pas besoin de valets pour Içs aider dans leur entreprise ; ils doivent régler eux-mêmes leurs problèmes. Par contre, la tradition est respectée, avec la présence d'Oronte, voire de Clitandre, d’Acaste et d’Arsinoé, qui remplissent la fonction des grotesques.

«
reprochait, c'était, en s'appuyant sur l'immense richesse
qu'il avait accumulée, d'avoir organisé un véritable contre
pouvoir, symbolisé par la cour rivale de Vaux-le-Vicomte.
Mais c'est la noblesse dans son ensemble qu'il convient
d'abaisser.
Louis XIV vit avec le souvenir lancinant des
événements deJa Fronde (1648-1652) où le pouvoir faillit
basculer au profit des grandes familles nobles.
Ce ftit un
épisode essentiel de l'histoire de la France qui, plus de
quinze ans après, marque encore profondément les esprits
à l'époque du Misanthrope: dans Tartuffe (1664), Molière y
fait une claire allusion, lorsqu'il montre l'hypocrite en train
de tenter de se servir contre Orgon de papiers compromet
tants que ce dernier avait reçus en dépôt d'un ami,
partisan des frondeurs.
Le roi ne peut oublier cette
insécurité qu'il connut alors au sortir de l'enfance, ces
humiliations qu'il dut subir, cette atmosphère de conspira
tions et d'hypocrisie qu'il dut respirer.
Louis XIV va donc entreprendre d'enlever aux nobles
tout leur pouvoir.
Il les domestique, leur construit une
prison dorée, les attire à la cour pour les couper de leurs
racines provinciales qui, par le jeu des droits et des devoirs
féodaux, pourraic;mt encore leur assurer un contact avec
les réalités économiques et sociales : il lui suffit, pour
aboutir à ce résultat, de leur confier des emplois bien
rémunérés, mais secondaires.
·
Le roi devient ainsi pour les nobles la seule chance de
salut.
Il les tient donc sous sa haute surveillance et peut
tuer éventuellement dans l' œuf toute tentative de complot.
C'est dans ce milieu d'une noblesse oisive, gravitant autour
du Roi-Soleil, que se déroule toute l'action du Misan
thrope.
Parallèlement, la bourgeoisie est en pleine ascension.
Le
roi lui donne volontiers des responsabilités politiques.
Maîtresse par ailleurs de l'économie, monopolisant les
valeurs d'argent, elle apparaît comme la force montante,
face à la sclérose d'une aristocratie contrainte de renoncer
à toute activité rémunératrice, sous peine de «déroger»,
c'est-à-dire de renier ses titres et son rang.
Mais, paradoxalement, la noblesse conserve son pres
tige.
Le roi est en effet contraint de la ménager, parce
18.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « On mettrait bien du temps à devenir misanthrope si on s'en tenait à l'observation d'autrui. C'est en notant ses propres faiblesses qu'on arrive à plaindre ou à mépriser l'homme. » Que pensez-vous de cette opinion de Bergson ?
- L'organisation du « Misanthrope » : action, lieu, temps
- Dans plusieurs de ses pièces (Les Précieuses ridicules, La Critique de l'Ecole des Femmes, Le Misanthrope, Les Femmes savantes), Molière a donné son opinion soit sur son art, soit sur certaines tendances de la littérature de son temps. Dans quelle mesure a-t-il servi l'idéal classique ? Par quels moyens a-t-il su rester un auteur comique ?
- Le temps est invention. Bergson
- Texte d’étude : Charles Baudelaire, « L’Ennemi », Les Fleurs du Mal (1857): Le temps mange-t-il la vie ? (HLP Philo)