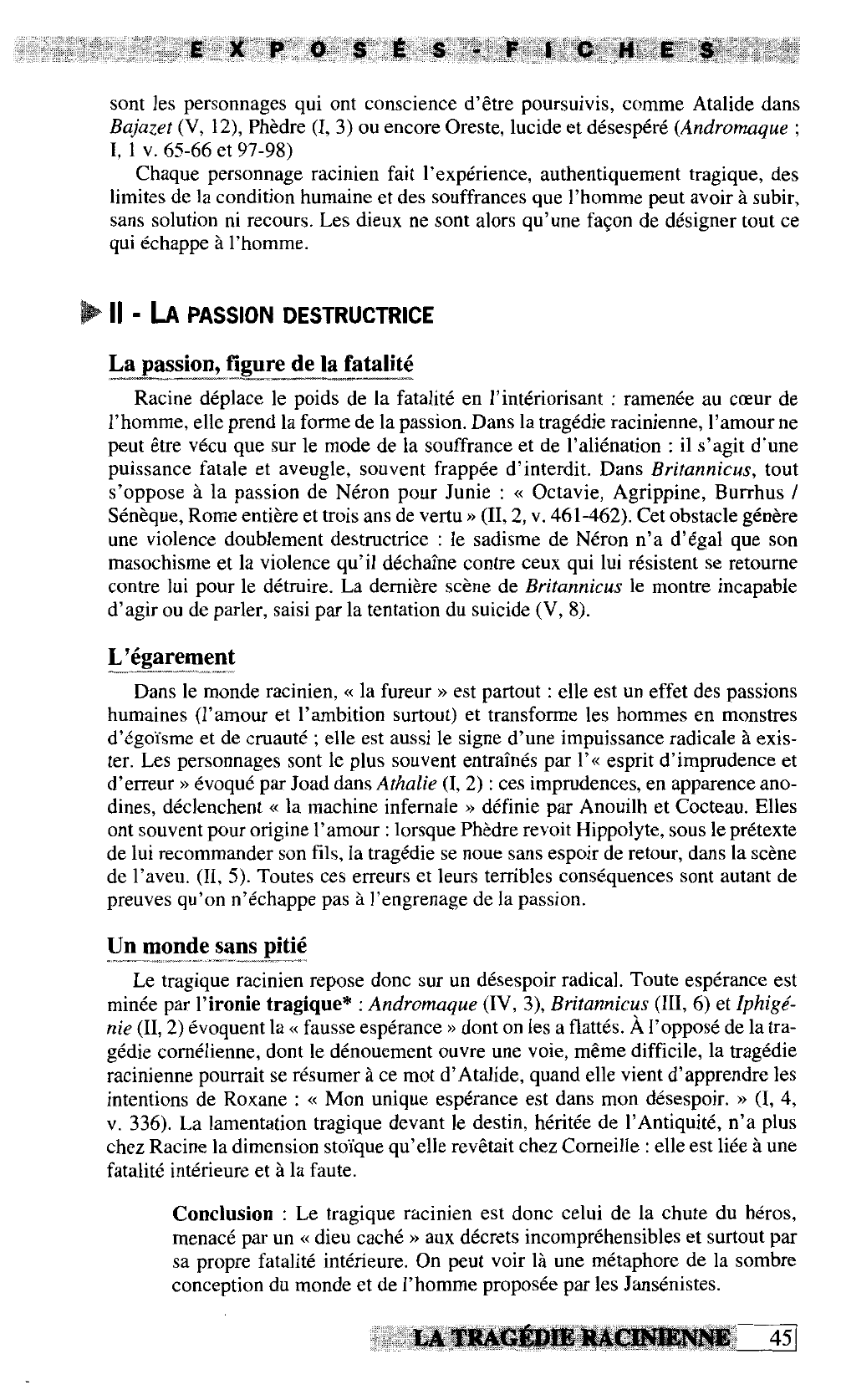Le tragique de la chute chez Racine
Publié le 26/03/2015

Extrait du document

Dans l'esprit de la tragédie antique, Racine fait de la fatalité le moteur de l'action dramatique* : les héros ne sont que les victimes des dieux, de leur volonté implacable et de leurs jeux cruels. Dans Phèdre, les dieux (Vénus, Neptune) sont évoqués plus de 80 fois dans leur cruauté et les imprécations (« Ciel «, « Dieux «) qui abondent dans la parole de Phèdre sont autant de cris d'impuissance face à une fatalité divine qui pèse sur elle sans arriver à détruire le sentiment de sa culpabilité.

«
sont les personnages qui ont conscience d'être poursuivis, comme Atalide dans
Bajazet (V, 12), Phèdre (1, 3) ou encore Oreste, lucide et désespéré (Andromaque ; 1, 1 V.
65-66 et 97-98)
Chaque personnage racinien fait l'expérience, authentiquement tragique, des
limites de la condition humaine et des souffrances que
l'homme peut avoir à subir,
sans solution
ni recours.
Les dieux ne sont alors qu'une façon de désigner tout ce
qui échappe à l'homme.
Il -LA PASSION DESTRUCTRICE
La passion, figure de la fatalité
Racine déplace le poids de la fatalité en l'intériorisant : ramenée au cœur de
l'homme, elle prend la forme de la passion.
Dans la tragédie racinienne,
l'amour ne
peut être vécu que sur le mode de la souffrance et de
l'aliénation: il s'agit d'une
puissance fatale et aveugle, souvent frappée d'interdit.
Dans Britannicus, tout
s'oppose à la passion de Néron pour Junie : « Octavie, Agrippine, Burrhus /
Sénèque, Rome entière et trois ans de vertu
» (Il, 2, v.
461-462).
Cet obstacle génère
une violence doublement destructrice : le sadisme de Néron
n'a d'égal que son
masochisme et la violence
qu'il déchaîne contre ceux qui lui résistent se retourne
contre lui pour le détruire.
La dernière scène de Britannicus le montre incapable
d'agir ou de parler, saisi par la tentation du suicide (V, 8).
L'é~~!em~!!t
Dans le monde racinien, « la fureur » est partout : elle est un effet des passions
humaines (l'amour et l'ambition surtout) et transforme les hommes en monstres
d'égoïsme et
de
cruauté; elle est aussi le signe d'une impuissance radicale à exis
ter.
Les personnages sont le plus souvent entraînés par l' « esprit d'imprudence et d'erreur» évoqué par Joad dans Athalie (1, 2): ces imprudences, en apparence ano
dines, déclenchent
« la machine infernale » définie par Anouilh et Cocteau.
Elles
ont souvent pour origine l'amour: lorsque Phèdre revoit Hippolyte, sous le prétexte
de lui recommander son fils, la tragédie se noue sans espoir de retour, dans la scène
de !'aveu.
(Il, 5).
Toutes ces erreurs et leurs terribles conséquences sont autant de
preuves
qu'on n'échappe pas à l'engrenage de la passion.
_lJ n i:!!()!1~e.!~~~J~!ti~
Le tragique racinien repose donc sur un désespoir radical.
Toute espérance est
minée par
l'ironie tragique* : Andromaque (IV, 3), Britannicus (III, 6) et Iphigé
nie
(Il, 2) évoquent la« fausse espérance» dont on les a flattés.
À l'opposé de la tra
gédie cornélienne, dont le dénouement ouvre une voie, même difficile, la tragédie
racinienne pourrait se résumer à ce mot
d' Atalide, quand elle vient d'apprendre les
intentions de Roxane :
« Mon unique espérance est dans mon désespoir.
» (I, 4,
v.
336).
La lamentation tragique devant le destin, héritée de l' Antiquité, n'a plus
chez Racine la dimension stoïque qu'elle revêtait chez Corneille: elle est liée
à une
fatalité intérieure et à la faute.
Conclusion : Le tragique racinien est donc celui de la chute du héros,
menacé par un
« dieu caché » aux décrets incompréhensibles et surtout par
sa propre fatalité intérieure.
On peut voir là une métaphore de la sombre
conception du monde
et de l'homme proposée par les Jansénistes..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Bérénice est une pièce de théâtre tragique écrite par Racine.
- Britannicus - Comment Racine arrive-t-il dans ces trois dernières scènes à nous faire ressentir tout le dénouement tragique de cette pièce ?
- Vous illustrerez par l'étude d'une tragédie de Racine cette définition que La Bruyère donne du poème tragique : « Le poème tragique vous serre le coeur dès son commen¬cement, vous laisse à peine dans tout son progrès la liberté de respirer et de vous remettre ; ou s'il vous donne quelque relâche, c'est pour vous replonger dans de nouveaux abîmes, dans de nouvelles alarmes. Il vous conduit à la terreur par la pitié ou, réciproquement, à la pitié par la terreur, vous mène par les larmes,
- Bérénice de Racine : Une pièce typiquement tragique ?
- RACINE ET LE TRAGIQUE