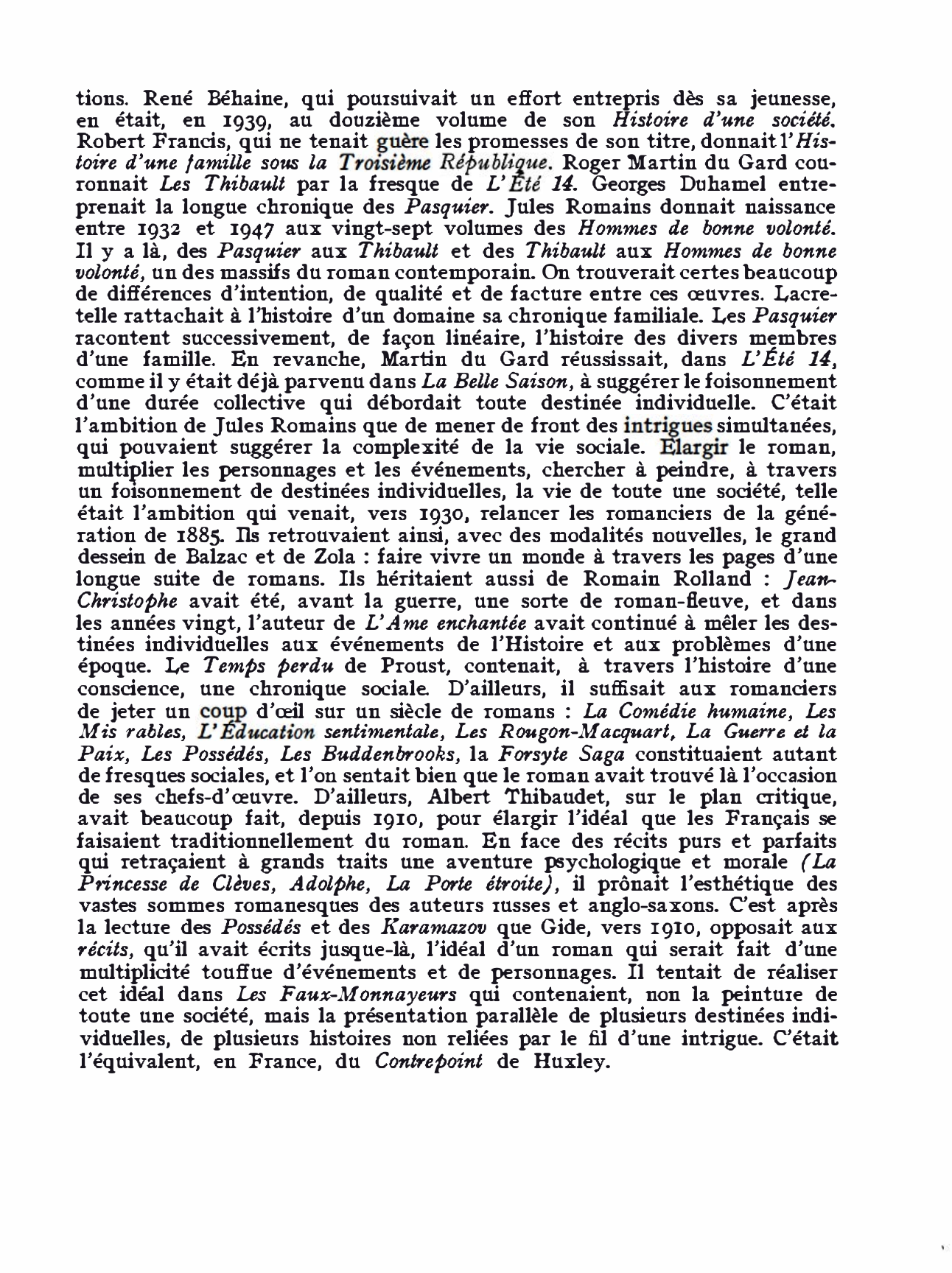Les fresques d’histoire sociale
Publié le 14/01/2018

Extrait du document

avec un moment de la durée française. Duhamel résumait un jour1, en ces termes, l'esprit de son entreprise : « L'histoire des Pasquier a donc pour sujet principal l'ascension d'une famille du peuple à l'élite, entre i88o et 1930. Raymond Pasquier, fils d'un jardinier de l'Ile-de-France, s'instruit, laborieusement, jusqu'à mériter et obtenir le diplôme de docteur en médecine, avec l'aide obstinée, passionnée, de son épouse Lucie Eléonore. De cette épouse, il a eu sept enfants. Cinq de ces enfants survivent. L'un d'entre eux, Laurent, deviendra, non sans efforts et aventures, un des premiers biologistes de son temps. L'aînée des filles, Cécile, musicienne douée de manière exceptionnelle, sera, de bonne heure, une grande artiste. La plus jeune des filles, Suzanne, remarquable par sa beauté, deviendra comédienne. Le fils aîné, enfiévré par l'appétit des biens temporels, s'illustrera comme homme d'affaires (Joseph) ... Enfin, l'un des enfants (Ferdinand) s'enfoncera tout doucement dans une médiocrité sans lueur )), On voit le procédé. En créant une famille nombreuse, le romancier prenait ses aises. En dotant les enfants de qualités diverses, en les destinant à des vocations différentes, il se donnait le loisir de peindre une assez grande variété d'épisodes et de types humains, il s'accordait la possibilité d'explorer divers secteurs de la société française. C'était une vieille habitude du roman naturaliste que cette technique un peu rudimentaire. Paul Margueritte l'avait employée dans Les Fabrecé et Zola avait bâti, en principe, ses Rougon-Macquart en suivant le schéma d'un arbre généalogique.
Duhamel s'efforçait de varier les procédés du récit : ses trois premiers volumes étaient constitués par les souvenirs de Laurent Pasquier, le tome quatrième, c'était la série des notes prises par Justin Weil pour le livre qu'il se proposait d'écrire ; tel autre volume contenait les lettres de Laurent. Le romancier, en plus d'un endroit, recourait au récit traditionnel à la troisième personne, ou bien il faisait la part belle aux dialogues. La variété des procédés utilisés ne parvient guère à effacer l'impression de monotonie qu'on ressent à la lecture des Pasquier. On comprend que l'auteur ait voulu éviter une construction dramatique qui l'eût détourné de son dessein : évoquer les lents progrès d'une vie, peindre la grisaille des jours, saisir la vie dans sa quotidienneté la moins romanesque. Mais il n'y avait jamais le souffle puissant qui seul peut animer un monde fictif. Le roman cyclique, ici, se déroule comme une lente chronique. C'est le rythme même du récit, fût-il affranchi de la traditionnelle intrigue, qui manque d'allégresse. Il traîne nonchalamment, il se perd dans la gratuité des épisodes, il ne donne jamais l'impression d'une unité organique. Duhamel affirmait, à la suite des Goncourt, que le romancier était l'historien du présent. Mais il n'était, quant à lui, que le chroniqueur de quelques destinées individuelles. Il était, au surplus, replié sur les valeurs d'un libéralisme de bon ton. Ce chantre des classes moyennes et des réussites estimables montrait une mesure, une sagesse, un bon sens, qui desservaient le romancier. Ses personnages sont touchants, pétris d'humanité, ils manquent de relief. Ils excellent dans leur partie, ils font de belles carrières, et ils restent moyens.
Martin du Gard a commencé le cycle des
Thibault en 1920. Du Cahier gris (1922) à La Mort du père (1929), il contait l'histoire de deux familles, les Thibault et les Fontanin. Il destinait des figures d'un puissant relief, il donnait vie à des personnages représentâtes : un grand bourgeois autoritaire, un adolescent révolté, un médecin énergique et ambitieux. Il héritait de Tolstoï dans l'art du portrait en épaisseur, dans la suggestion de cette troisième dimention du personnage imaginaire. Aucun effet de style gratuit, chez lui, aucune provocation esthétique. Il confiait un jour : « Nous lisons Tolstoï dans une traduction; cela n'enlève rien à sa grandeur. Voilà une leçon. Prenons soin de nos personnages et la forme prendra soin d'elle-même »h Il a été de bon ton, à la suite de quelques remarques d'André Gide, de regretter le manque d'éclat de cet art solide et probe, ou de déplorer, par comparaison avec Dostoïevsky, l'absence d'ombre et de relief dans ce panorama << à la Tolstoï »• Albert Camus a fait justice de ces critiques. <1 Il y a de grandes chances, écrivait-il®, pour que l'ambition réelle de nos écrivains soit, après avoir assimilé Les Possédés, d'écrire un jour La Guerre et la Paix. Au bout d'une longue course à travers les guerres et les négations, ils gardent l'espoir, même s'ils ne l'avouent pas, de retrouver les secrets d'un art universel qui, à force d'humilité et de maîtrise, ressusciterait enfin les personnages dans leur chair et leur durée ».
Ce ne sont pas seulement les personnages qui, dans les premiers tomes des Thibault, bénéficiaient de cette troisième dimention. Le récit lui-même, par la solidité de sa trame, imposait à l'esprit du lecteur un univers « crédible ». Martin du Gard, en face de toute une littérature romanesque fondée sur l'expérience intime d'une subjectivité, retrouvait, avec le gour de la documentation objective et de la narration impastible, les soucis des maîtres du xix6 siècle. Le roman redevenait pour lui ce qu'il était avant Proust, la représentation des êtres humains aux prises avec un monde hérissé de difficultés concrètes. Martin du Gard s'appliquait à montrer l'interaction vivante de l'homme et des choses. Héritier de Tolstoï, il ne dramatisait pas la vie. Il en reproduisait le cours avec une souveraine impastibilité. Il traçait, avec Jacques Thibault, un beau portrait d'adolescent. Il entrait dans sa révolte avec sympathie; mais austi, il en indiquait les raisons. Il était assez près de son personnage pour lui donner l'animation de la vie, assez éloigné de lui pour apercevoir les obscures motivations de ses attitudes. C'est une des vertus du réalisme que d'opposer aux emportements de la subjectivité ou aux délires visionnaires la sereine contemplation du cours des choses. « C'est très bien, Green, disait Martin du Gard8, mais il raconte ses rêves, et moi je parle de la réalité »• Il y a une sorte d'effacement de soi dans l'application et dans la mesure de cet art minutieux. Martin du Gard semble avoir eu parfois le sentiment d'une sorte d'échec : « Ce que j'appelle objectivité,
Les personnages de Jules Romains sont
souvent, il est vrai, représentatifs d'un secteur de la société française ; ils sont chargés d'incarner, selon des procédés qui remontent à Zola et à Balzac, tous les traits essentiels d'une classe ou d'une profession. On a souvent l'impression que Jules Romains est parti des catégories sociales qu'il voulait étudier, et qu'il a fabriqué des individus qui en fussent l'illustration. L'intelligence analytique est intervenue avant que ne s'exerce la puissance créatrice. Beaucoup d'individus, cependant, réussissent à éveiller l'intérêt du lecteur et à retenir son attention. Ils l'incitent même à tricher avec le plan suivi par l'auteur : il cherche à savoir, en sautant des épisodes, ce que deviennent les personnages qu'il a commencé d'aimer. Leurs pensées intimes, leur vie secrète nous sont généreusement livrées. C'est un des plaisirs de ce roman que d'y trouver accès à tant de consciences étrangères. Le lecteur passe de la conscience maniaque, méthodique et scrupuleuse de Quinette aux emportements visionnaires d'Haver-kamp, à la sagesse solide et opiniâtre de Jerphanion. Romains a jeté quelques lumières sur la liaison de la sexualité et du crime chez Quinette. Il a exploré, par ailleurs, les démarches secrètes de l'esprit créateur. Après Louis Lambert, La Recherche de l’Absolu, Manette Salomon, L’Œuvre, Les Faux-Monnayeurs, Jacques Arnaut et la somme romanesque, il a montré, avec Strigélius, un écrivain aux prises avec le langage. Il a suivi de même

«
tions.
René Béhaine, qui poursuivait un effort entrepris dès sa jeunesse,
en était, en 1939, au douzième volume de son Histoire d'une société.
Robert Francis, qui ne tenait guère les promesses de son titre, donnait l'His
toire d'une famille sous la Troisième Républù1ue.
Roger Martin du Gard cou
ronnait Les Thibault par la fresque de L' Eté 14.
Georges Duhamel entre
prenait la longue chronique des Pasquier.
Jules Romains donnait naissance
entre 1932 et 1947 aux vingt-sept volumes des Hommes de bonne volonté.
Il y a là, des Pasquier aux Thibault et des Thibault aux Hommes de bonne
volonté, un des massüs du roman contemporain.
On trouverait certes beaucoup
de différences d'intention, de qualité et de facture entre ces œuvres.
Lacre
telle rattachait à l'histoire d'un domaine sa chronique familiale.
Les Pasquier
racontent successivement, de façon linéaire, l'histoire des divers membres
d'une famille.
En revanche, Martin du Gard réussissait, dans L'Été 14,
comme il y était déjà parvenu dans La Belle Saison, à suggérer le foisonnement
d'une durée collective qui débordait toute destinée individuelle.
C'était
l'ambition de Jules Romains que de mener de front des intri
gues
simultanées,
qui pouvaient suggérer la complexité de la vie sociale.
Elargir le roman,
multi �lier les personnages et les événements, chercher à peindre, à travers
un fotsonnement de destinées individuelles, la vie de toute une société, telle
était l'ambition qui venait, vers 1930, relancer les romanciers de la géné
ration de 1885.
Ils retrouvaient ainsi, avec des modalités nouvelles, le grand
dessein de Balzac et de Zola : faire vivre un monde à travers les pages d'une
longue suite de romans.
Ils héritaient aussi de Romain Rolland : ] ean
Christophe avait été, avant la guerre, une sorte de roman-1ieuve, et dans
les années vingt, l'auteur de L'Ame enchantée avait continué à mêler les des
tinées individuelles aux événements de l'Histoire et aux problèmes d'une
époque.
Le Temps perdu de Proust, contenait, à travers l'histoire d'une
conscience, une chronique sociale D'ailleurs, il suffisait aux romanciers
de jeter un cou
_p d'œil
sur un siècle de romans : La Comédie humaine, Les
Mis
érables, L'Educati on sentimentale,
Les Roug on-Macquart, La Guerre et la
Paix, Les Possédés, Les Buddenbrooks, la Forsyte Saga constituaient autant
de fresques sociales, et l'on sentait bien que le roman avait trouvé là l'occasion
de ses chefs-d' œuvre.
D'ailleurs, Albert Thibaudet, sur le plan critique,
avait beaucoup fait, depuis 1910, pour élargir l'idéal que les Français se
faisaient traditionnellement du roman.
En face des récits purs et parfaits
qui retraçaient à grands traits une aventure psychologique et morale (La
Princesse de Clèves, Adolphe, La Porte étroite), il prônait l'esthétique des
vastes sommes romanesques des auteurs russes et anglo-saxons.
C'est après
la lecture des Possédés et des Karamazov que Gide, vers 1910, opposait aux
récits, qu'il avait écrits jusque-l à, l'idéal d'un roman qui serait fait d'une
multiplicité touffue d'événements et de personnages.
Il tentait de réaliser
cet idéal dans Les Faux-Monnayeurs qui contenaient, non la peinture de
toute une société, mais la présentation parallèle de plusieurs destinées indi
viduelles, de plusieurs histoires non reliées par le fil d'une intrigue.
C'était
l'équivalent, en France, du Contrepoint de Huxley..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Histoire et évolutions des système de protection sociale en France et en Europe.
- L e rock, forme culturelle liée d'abord, et pendant longtemps, à la marginalité et à la protestation sociale de minorités, a aujourd'hui une longue histoire.
- Le XXème siècle LES GUERRES AU 20ème SIÈCLE ; LE NAZISME L'histoire des guerres au 20ème ne se veut pas une histoire strictement militaire ni politique, mais culturelle et sociale.
- À la différence biologique des sexes, qui permet la reproduction de l'espèce, s'ajoute une différence sociale des sexes, qui s'est construite au cours de l'histoire.
- Les évolutions de la fracture sociale en France depuis les années 1850 (histoire)