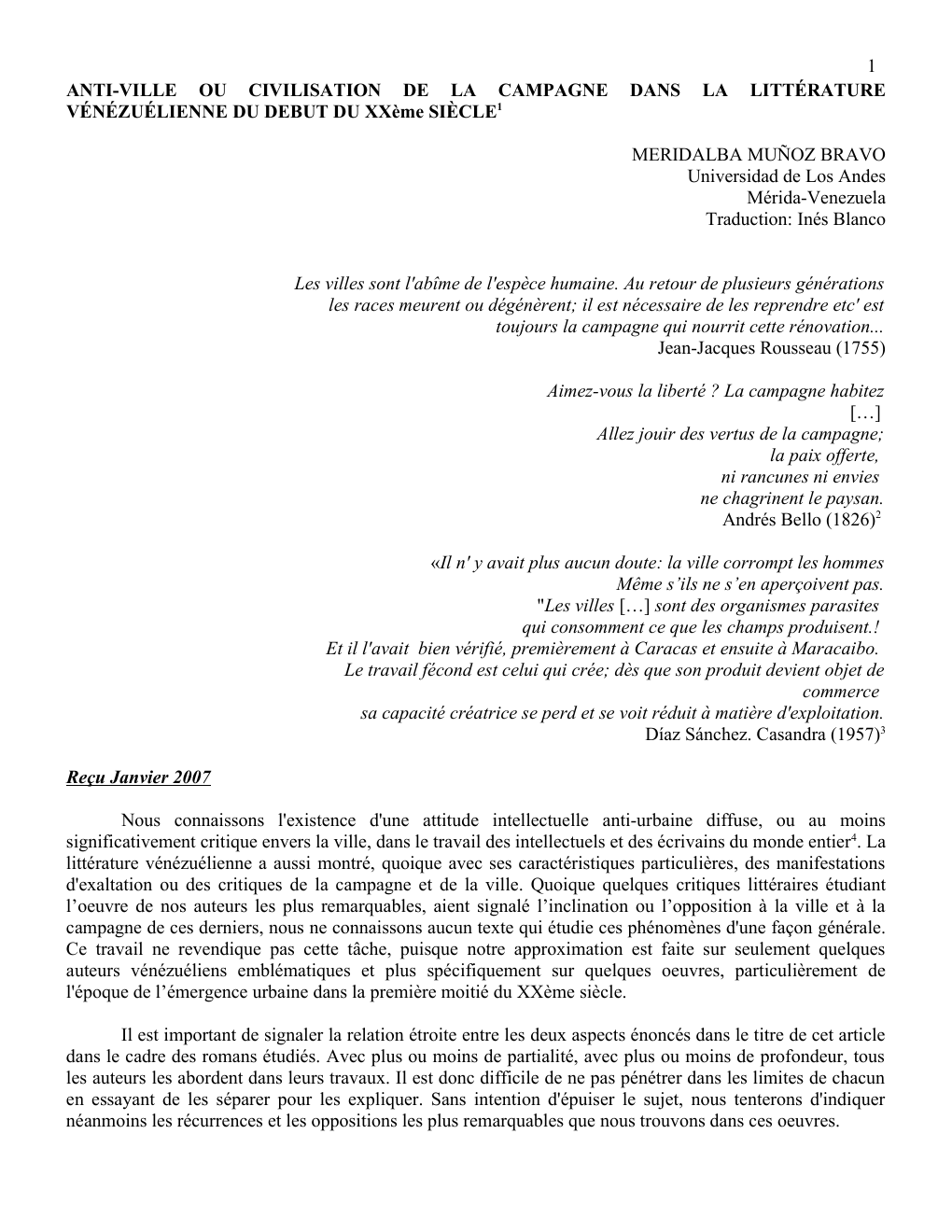Littérature et rural
Publié le 19/07/2025
Extrait du document
«
ANTI-VILLE OU CIVILISATION DE LA CAMPAGNE
VÉNÉZUÉLIENNE DU DEBUT DU XXème SIÈCLE1
DANS
LA
1
LITTÉRATURE
MERIDALBA MUÑOZ BRAVO
Universidad de Los Andes
Mérida-Venezuela
Traduction: Inés Blanco
Les villes sont l'abîme de l'espèce humaine.
Au retour de plusieurs générations
les races meurent ou dégénèrent; il est nécessaire de les reprendre etc' est
toujours la campagne qui nourrit cette rénovation...
Jean-Jacques Rousseau (1755)
Aimez-vous la liberté ? La campagne habitez
[…]
Allez jouir des vertus de la campagne;
la paix offerte,
ni rancunes ni envies
ne chagrinent le paysan.
Andrés Bello (1826)2
«Il n' y avait plus aucun doute: la ville corrompt les hommes
Même s’ils ne s’en aperçoivent pas.
"Les villes […] sont des organismes parasites
qui consomment ce que les champs produisent.!
Et il l'avait bien vérifié, premièrement à Caracas et ensuite à Maracaibo.
Le travail fécond est celui qui crée; dès que son produit devient objet de
commerce
sa capacité créatrice se perd et se voit réduit à matière d'exploitation.
Díaz Sánchez.
Casandra (1957)3
Reçu Janvier 2007
Nous connaissons l'existence d'une attitude intellectuelle anti-urbaine diffuse, ou au moins
significativement critique envers la ville, dans le travail des intellectuels et des écrivains du monde entier4.
La
littérature vénézuélienne a aussi montré, quoique avec ses caractéristiques particulières, des manifestations
d'exaltation ou des critiques de la campagne et de la ville.
Quoique quelques critiques littéraires étudiant
l’oeuvre de nos auteurs les plus remarquables, aient signalé l’inclination ou l’opposition à la ville et à la
campagne de ces derniers, nous ne connaissons aucun texte qui étudie ces phénomènes d'une façon générale.
Ce travail ne revendique pas cette tâche, puisque notre approximation est faite sur seulement quelques
auteurs vénézuéliens emblématiques et plus spécifiquement sur quelques oeuvres, particulièrement de
l'époque de l’émergence urbaine dans la première moitié du XXème siècle.
Il est important de signaler la relation étroite entre les deux aspects énoncés dans le titre de cet article
dans le cadre des romans étudiés.
Avec plus ou moins de partialité, avec plus ou moins de profondeur, tous
les auteurs les abordent dans leurs travaux.
Il est donc difficile de ne pas pénétrer dans les limites de chacun
en essayant de les séparer pour les expliquer.
Sans intention d'épuiser le sujet, nous tenterons d'indiquer
néanmoins les récurrences et les oppositions les plus remarquables que nous trouvons dans ces oeuvres.
2
LA VILLE, LA MAL AIMÉE.
Les auteurs romantiques du milieu du XIX ème siècle ont construit de nombreuses élégies du paysage
et les beautés naturelles de notre pays, travaux dans lesquels la nature et la campagne sont les protagonistes et
dans lesquels la ville était presque absente.
Au XIXème siècle le maquis et la plaine indomptable ont soutenu
une guerre non déclarée contre la ville, affirme Silverio González (2005:73-86).
C’est avec les auteurs de la
fin du siècle et du début du XXème qu’on commence à se rapporter expressément à la ville et que sont
récurrents les avis négatifs sur elle.
Nombreuses sont les visions des auteurs vénézuéliens.
L'inassouvissement face à une capitale estimée
de fin de siècle trop villageoise selon Díaz Rodríguez et de la Parra –dans Ídolos Rotos (1901) et Ifigenia
(1922) respectivement-, ou la ville également insatisfaisante et douteusement morale -Villabraba- illustrée
par Miguel Eduardo Pardo -dans Todo un pueblo (1899)-; la position de Briceño Iragorry -dans Los Riberas
(1957)-, admirateur dévoué des valeurs de noblesse et de grandeur d’âme qu’il reconnaissait dans la ville
traditionnelle -patricienne et bourgeoise-, qui succombait dans la ville moderne destructrice ; ou la défense
plus humble et pragmatique de la ville traditionnelle et même romantique de la vie villageoise faite par Picón
Salas –dans Viaje al amanecer (1943) et Nieves de antaño (1958)-, face à la fébrile métropole moderne; le
questionnement de la société vide et peu éthique de fin de siècle et à l’aube du XXéme dans Pocaterra –dans
beaucoup de ses romans, spécialement dans La casa de los Ábila (1921)-; ou le regard complémentaire vers
la nature pour l'idéaliste Gallegos –dans presque toutes ses oeuvres-, appel d'alerte pour civiliser et ne pas
abandonner la campagne, parallèlement à la création de villes meilleures et plus saines, comme le proposait
Díaz Sánchez dans ses essais; jusqu'au radicalisme surprenant d'un José Antonio Rial -dans Venezuela Imán
(1954)- et d'un Picón Salas dans son dernier roman -Los tratos de la noche (1955)-, reprochant des
perversions matérielles et psychologiques à la vie urbaine et son renoncement finale proposant la fuite vers la
nature comme le seul (en apparence) réduit sain.
Ces visions, parmi d’autres abordées dans cette recherche
nous donnent une idée de la variété de perceptions sur la chose urbaine chez nos intellectuels.
Marco Negrón (2004 : 343) reproche ce qu'il considère un injuste et nuisible mépris de la ville de la
part des intellectuels et des gouvernants, et place le plus aigu rejet dans les années soixante du XXème siècle:
«un trait récurrent de la pensée sur le territoire dans les quarante dernières années a été l’antiurbanisme
rhétorique, centré sur la condamnation des grandes villes et des migrations de la campagne à la ville.
Quoique les politiques qui en découlent aient été plutôt irrégulière et dans certains aspects contradictoires,
son corollaire le plus important fut la résistance de l'État à la création de ville et, particulièrement, à
habiliter des terres qui pouvaient permettre l'établissement ordonné des migrants les plus pauvres, puisqu’
on supposait -sans fondement, mais ceci, à ce moment-là, n'était pas si évident– que de cette manière on
stimulait le déplacement vers les villes.» Les contenus des romans analysés nous révèlent que l'insatisfaction
causée par la ville, raison possible de ce désintérêt gouvernemental des années soixante, est ressenti très en
avance, tellement que même au début du XIXème siècle, quand nos villes vénézuéliennes étaient à peine de
modestes villages -Caracas, la capitale, comptait à peine 40 mille habitants qui se sont réduits à près de 30
mille après le tremblement de terre de 1812-, nos auteurs critiquaient déjà le mal dans la ville.
Positions
fausses? Emulation simple pour nos auteurs de motifs et sujets développés par leurs homologues, dans
d'autres environnements qui, eux, étaient affectés par les maux de la grande ville ? Il nous est difficile de
douter de la sincérité des formulations d’un Andrés Bello, d’un Simón Rodríguez, d’un Fermín Toro par
exemple; nous pouvons comprendre, néanmoins, qu'un tel questionnement de la ville vise davantage ses
parasitaires et peu éthiques classes de direction et sa haute société, responsables historiques d’une mauvaise
gestion urbaine en s'abstenant de contrôler, de diriger ou de canaliser sa croissance et son développement
3
approprié; des aspects qui seront toujours motifs de critique même pour nos auteurs du XXème siècle et de
celui-ci, qui commence à peine.
Briceño Iragorry, par exemple, probablement le meilleur partisan de la ville parmi les auteurs traités,
critique la ville moderne; mais il s’agit plus d’une critique de l'oubli et de la négligence de ses valeurs -celles
de la Ville-, que d'un questionnement de la vie urbaine, à laquelle il a toujours reconnu des attributs de
civilisation, de culture et de bien-être.
Il est certain que la ville dont il fait l’éloge est celle dont la taille
physique et démographique permet la relation entre les voisins, avec une classification sociale et éthique
hiérarchique, de forte présence morale, de soigneuse défense des valeurs, qui dans la grande ville se diluent
en faveur de l’isolement, de l’anonymat, de la ségrégation sociale et même matérielle.
C'est une valorisation
de la vie plus communautaire, face à l'individualisme de la vie dans la ville.
L'états-unien John Dewey, par
exemple, au début du XXème siècle, distinguait comme des aspects positifs les valeurs de la Communauté,
plus petite, plus familiale, plus appropriable, face à celles plus impersonnelles de la Grande Société,
caractérisée par l'invasion de nouveaux modes de conduite humaine […] relativement impersonnelles et
mécaniques, distinction établie auparavant par Ferdinand Tönnies dans son oeuvre paradigmatique
Communauté et société (1887).
Les travaux, non seulement littéraires, mais aussi des essais de Dewey
soutenaient la conversion de la nouvelle Grande Société en une Grande Communauté, comme la meilleure
solution à la problématique existante (White, 1967 : 154, 169-170).
Briceño, également insatisfait de la
croissance incontrôlée et anormale de la ville vénézuélienne, se montre confronté à celle-ci, mais plutôt que
de proposer un nouvel arrangement social, il semble revendiquer nostalgiquement le retour à des formes
traditionnelles de vie dans la ville.
Néanmoins, attribuer à Briceño un questionnement de la ville serait
inexact; nous dirions plutôt qu’il glorifie les valeurs de la vie urbaine et en tout cas il critique la grande ville;
critique qui correspond à celles d’autres écrivains pour d'autres contextes géographiques et culturels5.
De son côté, Rómulo Gallegos, reconnu comme l'auteur par excellence de la plaine et de la nature
vénézuéliennes, à qui on a l’habitude d'attribuer l'exaltation exclusive de la chose rurale et aborigène, a
montré la défense des valeurs de civilisation liées à la vie urbaine depuis ses premiers écrits.
Dans son article
«Necesidad de valores culturales» publié en 1912, dans le numéro 496 de l’emblématique magazine
vénézuélien El Cojo Ilustrado,....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- C.E. 5 mai 1976, SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER. ET D'ÉTABLISSEMENT RURAL D'AUVERGNE ET MINISTRE DE L'AGRICULTURE C. BERNETTE, Rec. 232
- Madame Bovary et la littérature sentimentale
- l'histoire de la littérature
- En quoi la littérature et le cinéma participent-ils à la construction de la mémoire de la Shoah ? (exemple du journal d'Hélène Berr)
- Fiche pédagogique Littérature francophone