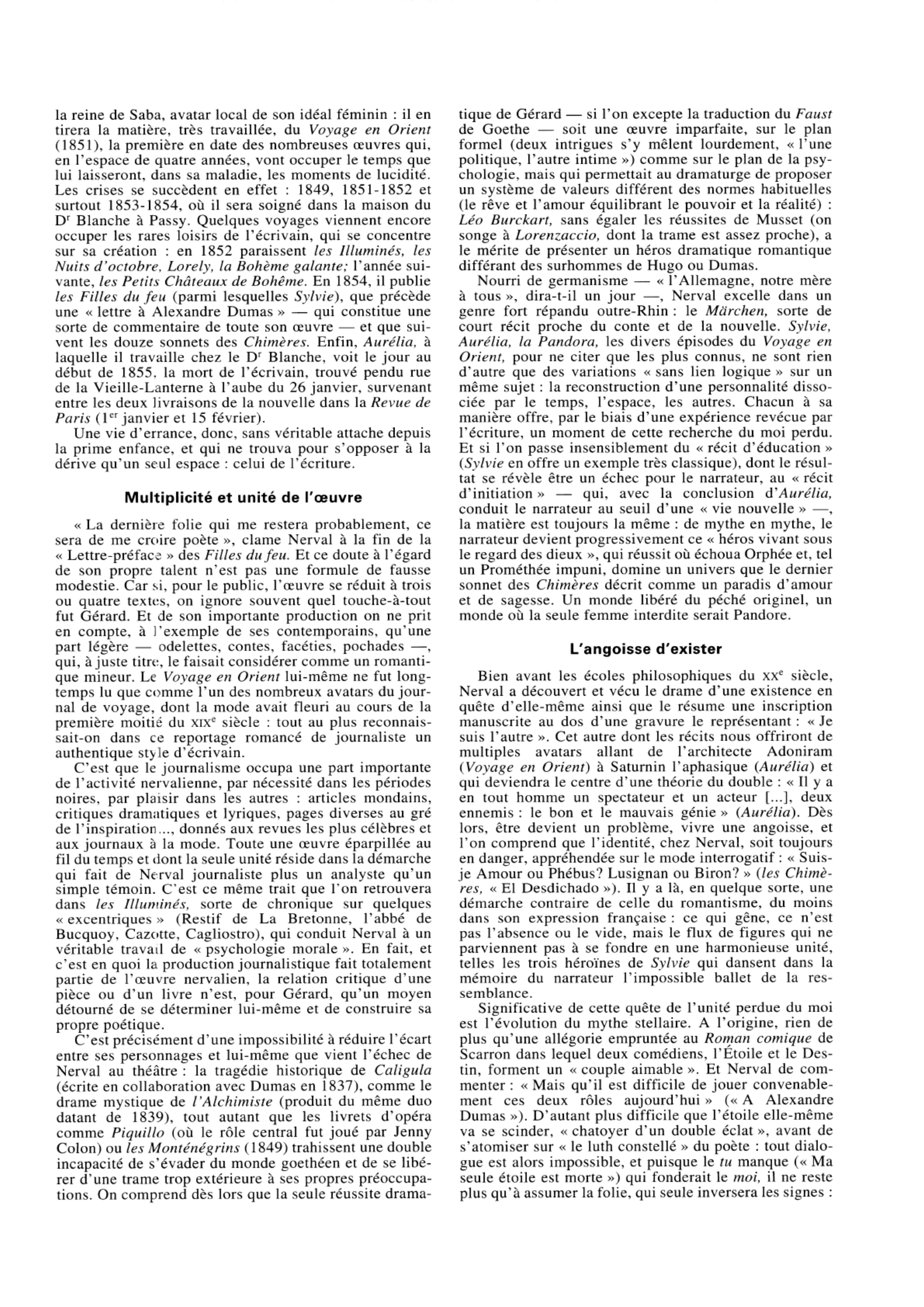NERVAL Gérard de : sa vie et son oeuvre
Publié le 24/11/2018

Extrait du document
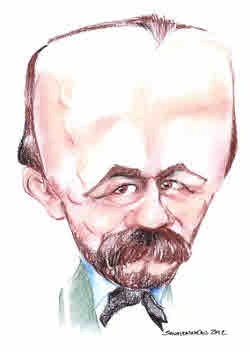
NERVAL Gérard de, pseudonyme de Gérard Labru-nie (1808-1855). L’œuvre nervalien se déroule selon un ordre, une logique et une raison qui transgressent le sens habituel de cette triade. L’existence même de l’écrivain, vécue à la manière d’un destin, porte déjà les stigmates de l’inspiré; et, grâce à la conjonction de la folie, qui, tout à la fois niée et lucidement dominée, lui permit de déchiffrer « l’alphabet magique » de l’univers, et de l’écriture, par laquelle il put « diriger son rêve éternel au lieu de le subir », Nerval entreprit une tentative démiur-gique dont la « genèse » aboutit à la création d’un mythe personnel.
Une vie de crises
Premier coup du destin : l’absence parentale. Fils d’un médecin de la Grande Armée dont il fut sans nouvelles jusqu’à six ans et d’une mère qui mourut en Silésie, où elle avait suivi son mari alors que l’enfant n’avait que deux ans, Gérard Labrunie passe sa petite enfance dans le Valois, d’abord en nourrice, puis chez son oncle maternel, Antoine Boucher. En 1814, au retour de son père, il regagne Paris, où il fait ses études au lycée Charlemagne en compagnie de Théophile Gautier. Dès 1826, il publie ses premières poésies, Élégies nationales,
chant patriotique à la gloire de Napoléon écrit dans un style byronien. L’année suivante, il traduit le Faust de Goethe, qui lui vaut une renommée immédiate et le fait entrer dans les cercles littéraires. [Voir Bousingot, Cénacles romantiques]. C’est l’époque de la bataille romantique pour la conquête de la scène, et Gérard y participe en tenant diverses critiques dramatiques dans des revues et en s’essayant, sans succès, au théâtre {Lara; le Prince des sots).
En 1832, il hérite, et il aurait alors pu vivre en paix si le destin, prenant les traits de l’actrice Jenny Colon, n’avait une seconde fois croisé son chemin. Liaison platonique, semble-t-il, dans laquelle s’engloutit tout son argent, puisque le Monde dramatique, qu’il fonda pour soutenir son idole, sombra en quelques mois. Ruiné, Gérard, qui signe du pseudonyme de Nerval en souvenir d’un clos familial du Valois, végète en faisant du journalisme, erre à travers l’Europe, passant d’Italie en Allemagne, de Belgique en Autriche, jusqu’à ce que, en 1841, une première crise de folie — alliance de manie aiguë et de psychose circulaire, diagnostiqueront plus tard les médecins — le conduise en maison de repos.
Peu après disparaît Jenny Colon, qui s’était, entretemps, mariée à un flûtiste : mais Gérard, qui a cristallisé sur elle ses rêves passionnels, voit sa raison chanceler de plus en plus. En 1843, il part pour l’Orient, en quête de la reine de Saba, avatar local de son idéal féminin : il en tirera la matière, très travaillée, du Voyage en Orient (1851), la première en date des nombreuses œuvres qui, en l’espace de quatre années, vont occuper le temps que lui laisseront, dans sa maladie, les moments de lucidité. Les crises se succèdent en effet : 1849, 1851-1852 et surtout 1853-1854, où il sera soigné dans la maison du Dr Blanche à Passy. Quelques voyages viennent encore occuper les rares loisirs de l'écrivain, qui se concentre sur sa création : en 1852 paraissent les Illuminés, les Nuits d'octobre, Lorely, la Bohème galante; l’année suivante, les Petits Châteaux de Bohême. En 1854, il publie les Filles du feu (parmi lesquelles Sylvie), que précède une « lettre à Alexandre Dumas » — qui constitue une sorte de commentaire de toute son œuvre — et que suivent les douze sonnets des Chimères. Enfin, Aurélia, à laquelle il travaille chez le Dr Blanche, voit le jour au début de 1855. la mort de l’écrivain, trouvé pendu rue de la Vieille-Lanterne à l’aube du 26 janvier, survenant entre les deux livraisons de la nouvelle dans la Revue de Paris (1er janvier et 15 février).
Une vie d’errance, donc, sans véritable attache depuis la prime enfance, et qui ne trouva pour s’opposer à la dérive qu’un seul espace : celui de l’écriture.
Multiplicité et unité de l'œuvre
« La dernière folie qui me restera probablement, ce sera de me croire poète », clame Nerval à la fin de la « Lettre-préface » des Filles du feu. Et ce doute à l'égard de son propre talent n’est pas une formule de fausse modestie. Car si, pour le public, l’œuvre se réduit à trois ou quatre textes, on ignore souvent quel touche-à-tout fut Gérard. Et de son importante production on ne prit en compte, à l’exemple de ses contemporains, qu'une part légère — odelettes, contes, facéties, pochades —, qui, à juste titre, le faisait considérer comme un romantique mineur. Le Voyage en Orient lui-même ne fut longtemps lu que comme l’un des nombreux avatars du journal de voyage, dont la mode avait fleuri au cours de la première moitié du xixc siècle : tout au plus reconnaissait-on dans ce reportage romancé de journaliste un authentique style d’écrivain.
C’est que le journalisme occupa une part importante de l’activité nervalienne, par nécessité dans les périodes noires, par plaisir dans les autres : articles mondains, critiques dramatiques et lyriques, pages diverses au gré de l’inspiration..., donnés aux revues les plus célèbres et aux journaux à la mode. Toute une œuvre éparpillée au fil du temps et dont la seule unité réside dans la démarche qui fait de Nerval journaliste plus un analyste qu’un simple témoin. C’est ce même trait que l'on retrouvera dans les Illuminés, sorte de chronique sur quelques « excentriques » (Restif de La Bretonne, l’abbé de Bucquoy, Cazotte, Cagliostro), qui conduit Nerval à un véritable travail de « psychologie morale ». En fait, et c’est en quoi la production journalistique fait totalement partie de l'œuvre nervalien, la relation critique d’une pièce ou d'un livre n’est, pour Gérard, qu’un moyen détourné de se déterminer lui-même et de construire sa propre poétique.
C’est précisément d’une impossibilité à réduire l'écart entre ses personnages et lui-même que vient l’échec de Nerval au théâtre : la tragédie historique de Caligula (écrite en collaboration avec Dumas en 1837), comme le drame mystique de l'Alchimiste (produit du même duo datant de 1839), tout autant que les livrets d'opéra comme Piquillo (où le rôle central fut joué par Jenny Colon) ou les Monténégrins (1849) trahissent une double incapacité de s’évader du monde goethéen et de se libérer d'une trame trop extérieure à ses propres préoccupations. On comprend dès lors que la seule réussite drama
tique de Gérard — si l’on excepte la traduction du Faust de Goethe — soit une œuvre imparfaite, sur le plan formel (deux intrigues s’y mêlent lourdement, « l’une politique, l’autre intime ») comme sur le plan de la psychologie, mais qui permettait au dramaturge de proposer un système de valeurs différent des normes habituelles (le rêve et l’amour équilibrant le pouvoir et la réalité) : Léo Burckart, sans égaler les réussites de Musset (on songe à Lorenzaccio, dont la trame est assez proche), a le mérite de présenter un héros dramatique romantique différant des surhommes de Hugo ou Dumas.
Nourri de germanisme — « l’Allemagne, notre mère à tous », dira-t-il un jour —, Nerval excelle dans un genre fort répandu outre-Rhin : le Mcirchen, sorte de court récit proche du conte et de la nouvelle. Sylvie, Aurélia, la Pandora, les divers épisodes du Voyage en Orient, pour ne citer que les plus connus, ne sont rien d’autre que des variations « sans lien logique » sur un même sujet : la reconstruction d’une personnalité dissociée par le temps, l’espace, les autres. Chacun à sa manière offre, par le biais d’une expérience revécue par l’écriture, un moment de cette recherche du moi perdu. Et si l’on passe insensiblement du « récit d'éducation » (Sylvie en offre un exemple très classique), dont le résultat se révèle être un échec pour le narrateur, au « récit d'initiation » — qui, avec la conclusion d'Aurélia, conduit le narrateur au seuil d’une « vie nouvelle » —, la matière est toujours la même : de mythe en mythe, le narrateur devient progressivement ce « héros vivant sous le regard des dieux », qui réussit où échoua Orphée et, tel un Prométhée impuni, domine un univers que le dernier sonnet des Chimères décrit comme un paradis d’amour et de sagesse. Un monde libéré du péché originel, un monde où la seule femme interdite serait Pandore.
L'angoisse d'exister
Bien avant les écoles philosophiques du xxe siècle, Nerval a découvert et vécu le drame d’une existence en quête d’elle-même ainsi que le résume une inscription manuscrite au dos d’une gravure le représentant : « Je suis l’autre ». Cet autre dont les récits nous offriront de multiples avatars allant de l’architecte Adoniram (Voyage en Orient) à Saturnin l’aphasique (Aurélia) et qui deviendra le centre d’une théorie du double : « Il y a en tout homme un spectateur et un acteur [...], deux ennemis : le bon et le mauvais génie » (Aurélia). Dès lors, être devient un problème, vivre une angoisse, et l’on comprend que l’identité, chez Nerval, soit toujours en danger, appréhendée sur le mode interrogatif : « Suis-je Amour ou Phébus? Lusignan ou Biron? » (les Chimères, « El Desdichado »). Il y a là, en quelque sorte, une démarche contraire de celle du romantisme, du moins dans son expression française : ce qui gêne, ce n’est pas l’absence ou le vide, mais le flux de figures qui ne parviennent pas à se fondre en une harmonieuse unité, telles les trois héroïnes de Sylvie qui dansent dans la mémoire du narrateur l’impossible ballet de la ressemblance.
Significative de cette quête de l’unité perdue du moi est l’évolution du mythe stellaire. A l’origine, rien de plus qu’une allégorie empruntée au Roman comique de Scarron dans lequel deux comédiens, l’Étoile et le Destin, forment un « couple aimable ». Et Nerval de commenter : « Mais qu’il est difficile de jouer convenablement ces deux rôles aujourd’hui » (« A Alexandre Dumas »). D’autant plus difficile que l’étoile elle-même va se scinder, « chatoyer d’un double éclat », avant de s’atomiser sur « le luth constellé » du poète : tout dialogue est alors impossible, et puisque le tu manque (« Ma seule étoile est morte ») qui fonderait le moi, il ne reste plus qu’à assumer la folie, qui seule inversera les signes : l’étoile cesse alors d’être un masque — celui de la femme —, une u-topie, pour devenir un lieu matériel où s’inscrira désormais la destinée du rêveur : « Je me mis à chercher dans le ciel une étoile. L’ayant trouvée, je continuai ma marche, marchant pour ainsi dire au-devant de mon destin. Dans cette étoile sont ceux qui m’attendent! » {Aurélia, I, 2). Ainsi l’étoile est le destin, et le moi peut enfin se refermer sur la certitude de son existence : mais pour être, il aura fallu vaincre ses chimères, dominer le double et, comme le souligne Yves Bonnefoy, accepter que « la mort grandisse en soi ». Car, paradoxalement, l’être nervalien passe par la mort, et seul le franchissement des « portes mystiques » du rêve — que les premières lignes d'Aurélia comparent à la mort — permet au moi de « s’affranchir des conditions du temps et de l’espace » qui fragmentent l’individu.
Palingénésie...
Comme le fait remarquer Kurt Schârer, « la recette de la guérison envisagée par Nerval se résume par le simple préfixe re. Pour régénérer ce qui souffre du déclin des forces, on n’a qu’à remonter le cours du temps et à se retremper aux sources originelles ». D’où le recours au voyage, au souvenir, au rêve.
Voyager, c’est en effet, pour Nerval, refaire un chemin parcouru et dont on se souvient (voir le retour à Ermenonville dans Sylvie), c’est vérifier que la réalité est bien semblable à l’idée qu’on s’en est formée (tel est le projet avoué du Voyage en Orient ou de Lorely) : « Ce n’est pas la fortune que je poursuis, c’est l’idéal, la couleur, la poésie », écrira-t-il à Gautier. Non attitude de dilettante, mais moyen de déplacer — faussement — durée et lieux : qu’on se souvienne du rôle de la « voiture » dans Sylvie, où, pendant le voyage, le héros « recompose » les souvenirs de son enfance. Survient la fin du voyage : « J’échappe au monde des rêveries », note avec tristesse le narrateur qui se heurte alors au mur de la réalité. Voyager, c’est donc se rappeler, comme se souvenir, c’est voyager dans le temps (significatif de cette similitude est le titre d’un recueil de pochades réunies en Promenades et Souvenirs). Mais, à la différence du voyage, le souvenir n’a de valeur, d’effet que lorsqu’il échappe à l’emprise de la raison ou de la conscience : qu’on oppose la joie née de la lecture d’un article de journal (Sylvie, I) — et qui met en jeu la mémoire involontaire — à l’errance dans le Valois « pour revoir » et retrouver le passé (ibid., ix), qui, née du souvenir conscient, provoque ennui et désillusion. D’où l’aspect anodin des souvenirs que Nerval appellera « fidèles » : un chant d’enfant qui ressuscite « la voix tremblante des aïeuls », un habit de fête qui recrée magiquement l’atmosphère d’antan, une tour Henri IV qui semble faire revivre le cœur du vieux pays de France, etc.
La vie est un songe, a dit Calderon; Nerval, inversant la proposition, a voulu faire du rêve sa vie : « Je ne demande pas à Dieu de rien changer aux événements, mais de me changer relativement aux choses; de me laisser le pouvoir de créer autour de moi un monde qui m’appartienne, de diriger mon rêve éternel au lieu de le subir » (Paradoxe et Vérité). Non point « rêverie », telle que la comprenait Rousseau ou telle que la vivait la génération de René, et qui n’était qu’un abandon nostalgique aux chimères, mais rêve, c’est-à-dire un univers parallèle formé de signes dont seul l’initié peut interpréter le sens.
Ainsi l’itinéraire nervalien, sans jamais cesser d’être une errance, passe d’une recomposition des souvenirs à travers la réalité à une recomposition du rêve («j’entrepris de fixer le rêve et d’en connaître le secret », Aurélia) à travers les symboles. Dès lors, il est logique que l’écri
ture, elle-même univers de signes, ait été chargée de fixer cette démiurgie.
Le mérite de l'expression
L’originalité de Nerval tient à cette osmose permanente du rêve et de la réalité qu’il a appelée « épanchement ». Mais comment transcrire une telle expérience en termes langagiers? La solution la plus évidente était d’user d’un style métaphorique. Or, il est surprenant de constater le peu de place qu’occupent les images référentielles dans le discours nervalien : de ce point de vue, la poétique de Nerval est éminemment « moderne », et l’on voit tout ce qui sépare le flot discursif de « la Bouche d’Ombre » hugolienne, des « Vers dorés » auxquels il suffit d’affirmer qu’« A la matière même un verbe est attaché » pour que se réalise la parole cosmique. Au surplus, le choix des termes est révélateur et renvoie explicitement à une conception mystique de l’écriture faisant du poète non point le mage ou le savant, mais le frère interrogateur des dieux des Chimères : Horus, Antéros, le Christ...
Une fois éliminé l’artifice de l’image, il ne restait qu’à transcrire la réalité dans sa vérité tout en la nimbant de cette « couleur pourprée » dans laquelle Proust voyait la magie nervalienne. D’où une technique impressionniste, à l’opposé de la narration romantique; les contours sont estompés, les héros n’interviennent plus comme types mais se fondent dans un décor dont ils deviennent tributaires : Sylvie et la « fenêtre où le pampre s’enlace au rosier », Aurélie et la scène théâtrale, etc. Paradoxe suprême : si la majorité des textes porte le nom d’un personnage (il en va de même des poèmes des Chimères), ceux-ci ne sont jamais décrits. Ils n’existent que comme signes et, en tant que tels, n’acquièrent de sens que par rapport au regard omnipotent du narrateur-héros : là encore, Nerval tourne le dos au romantisme, et sans doute faut-il voir dans cette situation l’origine du relatif effacement de Gérard de l’horizon littéraire durant trois quarts de siècle : ni chef d’école ni disciple, il marque l’avènement d’un nouveau discours fondé sur l’assomp-tion totale du langage. Ses pairs ne s’y sont pas trompés qui, très tôt, ont reconnu son importance tandis que Sainte-Beuve, décidément coutumier du fait, ignorait délibérément son originalité. L’histoire littéraire devait pour longtemps l’écarter des manuels scolaires; et tandis que les Aicard, Soulary ou autres illustres Autran paradaient en tête des « morceaux choisis », Nerval devra attendre les années 50 pour pénétrer véritablement dans l’univers scolaire, où il côtoie, à part désormais égale, les grands romantiques et Baudelaire, ou Rimbaud.
Pas plus que la critique officielle, le grand public ne s’intéressa à son œuvre : malgré une légende savamment entretenue par Gautier et ses amis, et qui en faisait un bohème antibourgeois ou un « fol délicieux », ses livres avaient disparu des vitrines, à l’exception de quelques contes fantaisistes ou des récits de voyage, deux genres mis en vogue par le romantisme. Seul l’avènement du surréalisme modifia les perspectives en faisant de Nerval et d’autres maudits (Sade, Lautréamont et même Rimbaud) des précurseurs des temps nouveaux : dès lors, les éditions savantes se multiplièrent; les études aussi, qui sacrifièrent d’abord à la biographie fantastique avant que la critique n’applique les grilles les plus surprenantes pour déchiffrer le microcosme nervalien : tarots, cabale, alchimie, etc. Plus récemment, les premiers travaux linguistiques appliqués aux Chimères ont montré que l’hermétisme ou l’ésotérisme n’étaient que des masques, et qu’une analyse méticuleuse du discours nervalien révélait, dans son originalité et sa démesure, l’entreprise du poète : faire de sa vie un mythe, c’est-à-dire un ensemble de signes ordonnés en fonction d’une logique propre.
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- VIE ET OEUVRE DE GÉRARD DE NERVAL
- Filles du Feu (les) de Gérard de Nerval (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- CHIMÈRES (Les) Gérard de Nerval - résumé de l'oeuvre
- Sylvie Souvenirs du Valois de Gérard de Nerval (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- AURÉLIA ou le Rêve et la Vie de Gérard de Nerval (fiche de lecture)