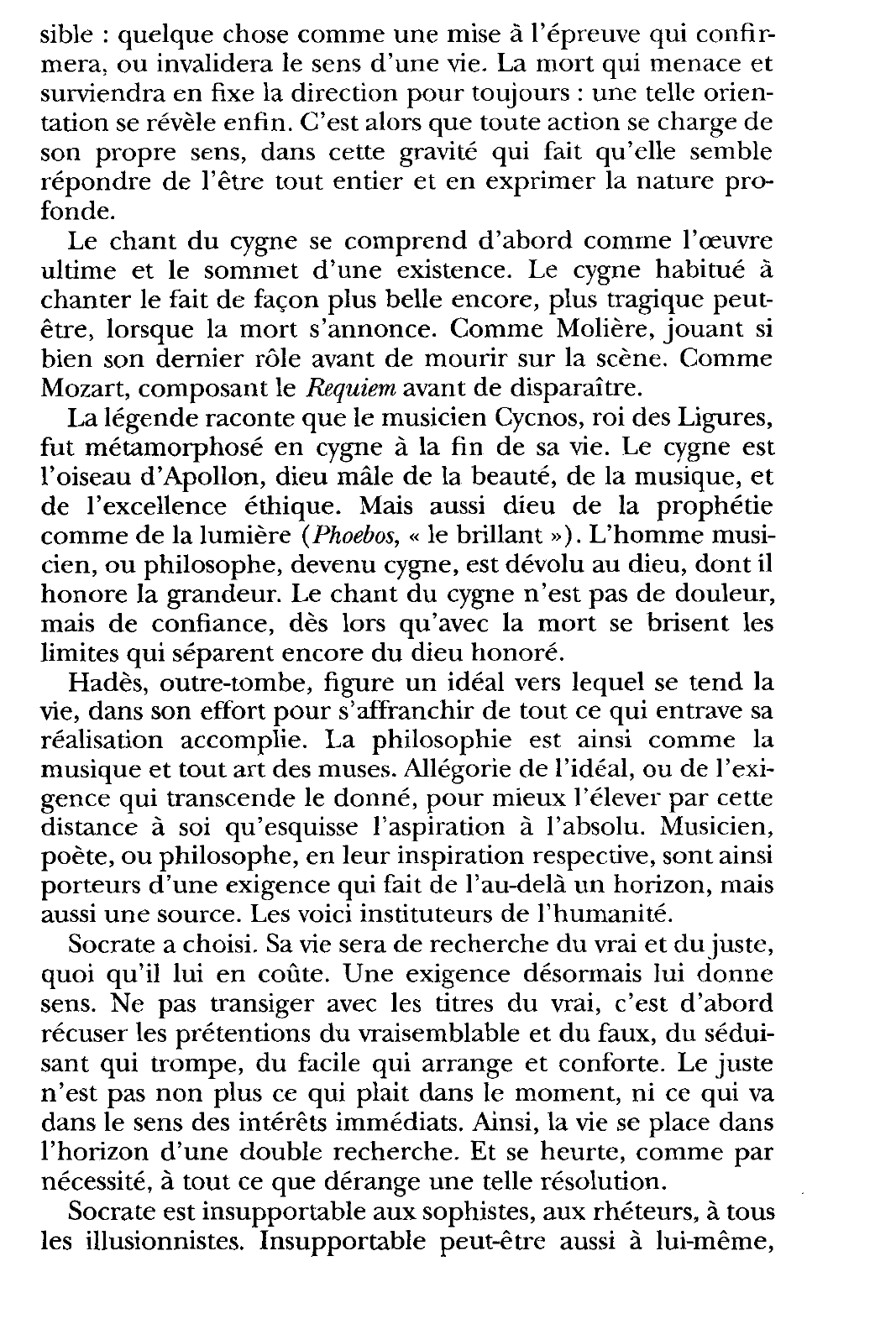Platon, Phédon, 84e-85b, trad. M. Dixsaut, GF-Flammarion.
Publié le 19/03/2015

Extrait du document
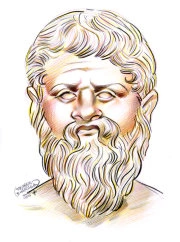
Le chant du cygne
Les cygnes, dès qu'ils sentent qu'il leur faut mourir, le chant qu'ils chantaient déjà auparavant, ils le chantent alors de façon plus fréquente et plus éclatante, tout à la joie d'aller retrouver le dieu qu'ils servent. Mais les humains, à cause de la peur qu'ils ont de la mort, calomnient même les cygnes, disant : « ils se lamentent sur leur mort, c'est la douleur qui inspire leur dernier chant « ; sans réfléchir qu'aucun oiseau ne chante quand il a faim, quand il a froid, quand il souffre d'une peine quelconque, pas même le rossignol, ni l'hirondelle, ni la huppe, eux dont le chant serait, à ce qu'on raconte, une lamentation inspirée par la souffrance. Mais, pour moi, il me paraît que ce n'est pas la souffrance qui les fait chanter, ni eux, ni les cygnes qui sont, que je sache, les oiseaux d'Apollon et possèdent donc le don de la divination : c'est la prescience des biens qu'ils trouveront chez Hadès qui les fait chanter et se réjouir ce jour-là bien plus que jamais auparavant. Or j'estime justement que je partage avec les cygnes la même servitude et que je suis consacré au même dieu...
Platon, Phédon, 84e-85b, trad. M. Dixsaut, GF-Flammarion.
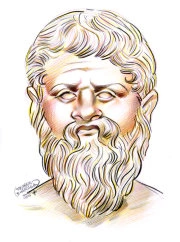
«
90 Le temps de vivre
sible: quelque chose comme une mise à l'épreuve qui confir
mera, ou invalidera le sens d'une vie.
La mort qui menace et
surviendra en fixe la direction pour toujours : une telle orien
tation se révèle enfin.
C'est alors que toute action se charge de
son propre sens, dans cette gravité qui fait qu'elle semble
répondre de l'être tout entier et en exprimer la nature pro
fonde.
Le chant du cygne se comprend d'abord comme l'œuvre
ultime et le sommet d'une existence.
Le cygne habitué à
chanter le fait de façon plus belle encore, plus tragique peut
être, lorsque la mort s'annonce.
Comme Molière, jouant si
bien son dernier rôle avant de mourir sur la scène.
Comme
Mozart, composant le Requiem avant de disparaître.
La légende raconte que le musicien Cycnos, roi des Ligures,
fut métamorphosé en cygne à la fin de sa vie.
Le cygne est
l'oiseau d'Apollon, dieu mâle de la beauté, de la musique, et
de l'excellence éthique.
Mais aussi dieu de la prophétie
comme de la lumière (Phoebos, « le brillant »).
L'homme musi
cien,
ou philosophe, devenu cygne, est dévolu au dieu, dont il
honore la grandeur.
Le chant du cygne n'est pas de douleur,
mais de confiance, dès lors qu'avec la mort se brisent les
limites
qui séparent encore du dieu honoré.
Hadès, outre-tombe, figure un idéal vers lequel se tend la
vie, dans son effort pour s'affranchir de tout ce qui entrave sa
réalisation accomplie.
La philosophie est ainsi comme la
musique et tout art des muses.
Allégorie de l'idéal, ou de l'exi
gence qui transcende le donné, pour mieux l'élever par cette
distance à soi qu'esquisse l'aspiration à l'absolu.
Musicien,
poète, ou philosophe, en leur inspiration respective, sont ainsi
porteurs d'une exigence qui fait de l'au-delà un horizon, mais
aussi
une source.
Les voici instituteurs de l'humanité.
Socrate a choisi.
Sa vie sera de recherche du vrai et du juste,
quoi qu'il lui en coûte.
Une exigence désormais lui donne
sens.
Ne pas transiger avec les titres du vrai, c'est d'abord
récuser les prétentions du vraisemblable et du faux, du sédui
sant qui trompe, du facile qui arrange et conforte.
Le juste
n'est pas non plus ce qui plait dans le moment, ni ce qui va
dans le sens des intérêts immédiats.
Ainsi, la vie se place dans
l'horizon d'une double recherche.
Et se heurte, comme par
nécessité, à tout ce que dérange une telle résolution.
Socrate est insupportable aux sophistes, aux rhéteurs, à tous
les illusionnistes.
Insupportable peut-être aussi à lui-même,.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Platon, Phédon, 60b-c, trad. M. Dixsaut, GF-Flarnmarion.
- Platon, Phèdre, 249d, trad. L. Brisson, GF-Flammarion.
- Platon, Gorgias, 523b-523e, trad. M. Canto-Sperber, GF-Flammarion.
- Platon, Théétète, 150b-d trad. M. Narcy modifiée, GF-Flammarion.
- Platon, Alcibiade, 132b-133b, trad. C. Marboeuf et J.-F. Pradeau, GF-Flammarion.