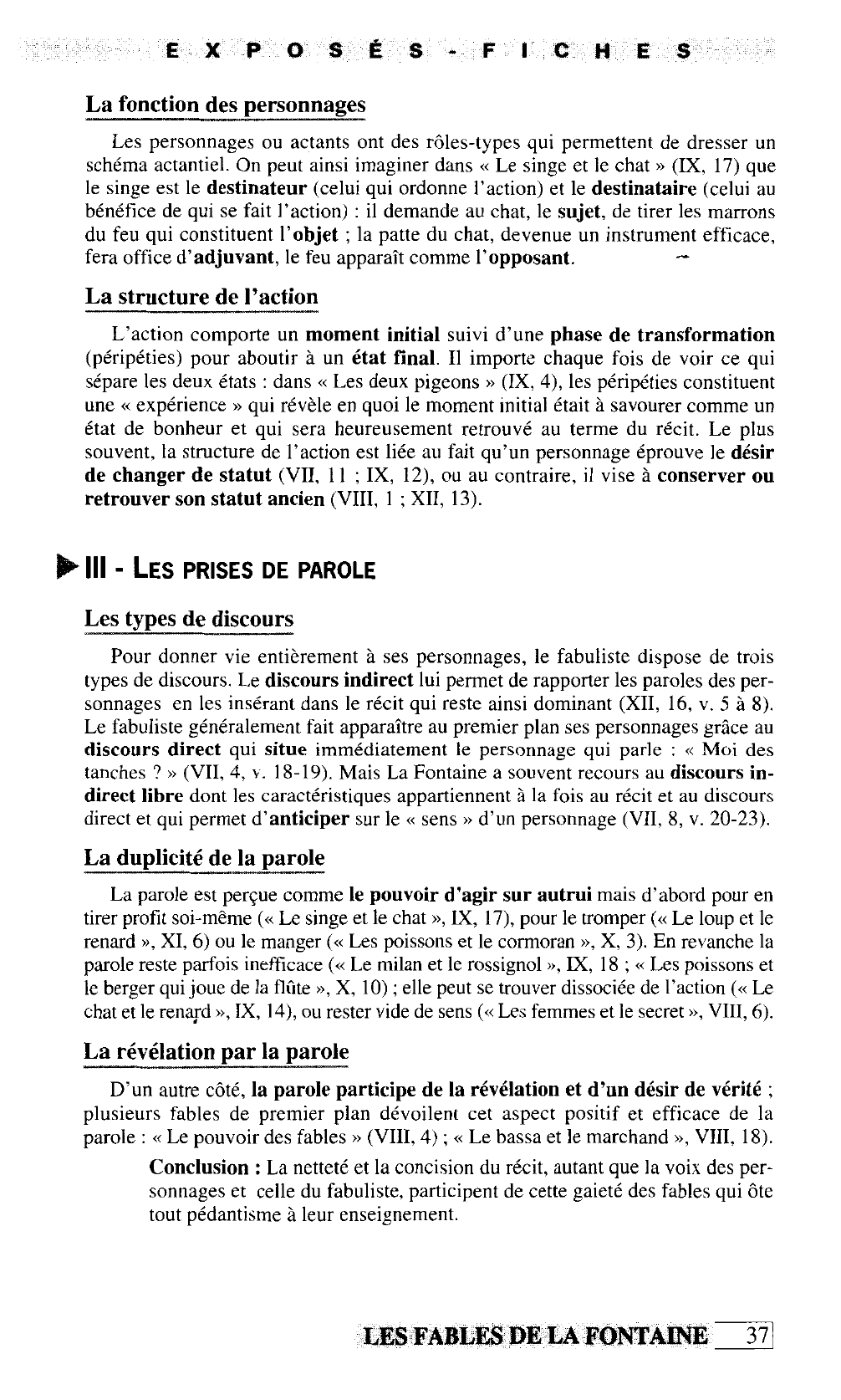Récit et discours
Publié le 27/03/2015
Extrait du document

- En général, chaque fable développe une seule action dramatique et présente habituellement une unité de temps et de lieu. Il s'agit souvent d'une scène unique construite comme un fait divers, située par des termes comme « un jour « (VIII, 17), « un soir « (VIII, 22). Cette unité d'action permet au fabuliste de faire plus facilement converger ses effets vers une finalité didactique ; elle permet au lecteur de mieux pressentir la morale finale ou de vérifier la validité de la morale initiale.

«
E X P 0 S É S F C H E S
La fonction des personnages
Les personnages ou actants ont des rôles-types qui permettent de dresser un
schéma actantiel.
On peut ainsi imaginer dans « Le singe et le chat » (IX, 17) que
le singe est le
destinateur (celui qui ordonne l'action) et le destinataire (celui au
bénéfice de qui se fait l'action) : il demande au chat, le sujet, de tirer les marrons
du feu qui constituent
l'objet; la patte du chat, devenue un instrument efficace,
fera office d'adjuvant, le feu apparaît comme l'opposant.
La structure de l'action
L'action comporte un moment initial suivi d'une phase de transformation
(péripéties) pour aboutir à un état final.
Il importe chaque fois de voir ce qui
sépare les deux
états: dans« Les deux pigeons» (IX, 4), les péripéties constituent
une
« expérience » qui révèle en quoi le moment initial était à savourer comme un
état de
bonheur et qui sera heureusement retrouvé au terme du récit.
Le plus
souvent, la structure de l'action est liée au fait
qu'un personnage éprouve le désir
de changer de statut
(VII, 11 ; IX, 12), ou au contraire, il vise à conserver ou
retrouver son statut ancien
(VIII, 1 ; XII, 13).
~ Ill -LES PRISES DE PAROLE
Les types de discours
Pour donner vie entièrement à ses personnages, le fabuliste dispose de trois
types de discours.
Le
discours indirect lui permet de rapporter les paroles des per
sonnages en les insérant dans le récit qui reste ainsi dominant (XII, 16,
v.
5 à 8).
Le fabuliste généralement fait apparaître au premier plan ses personnages grâce au
discours direct qui situe immédiatement le personnage qui parle : « Moi des tanches?» (VII, 4, v.
18-19).
Mais La Fontaine a souvent recours au discours in
direct libre
dont les caractéristiques appartiennent à la fois au récit et au discours
direct et qui permet
d'anticiper sur le« sens» d'un personnage (VII, 8, v.
20-23).
La duplicité de la parole
La parole est perçue comme le pouvoir d'agir sur autrui mais d'abord pour en
tirer profit soi-même
(«Le singe et le chat», IX, 17), pour le tromper («Le loup et le renard», XI, 6) ou le manger(« Les poissons et le cormoran», X, 3).
En revanche la
parole reste parfois inefficace(« Le milan et le
rossignol», IX, 18; «Les poissons et
le berger qui joue de la
flûte», X, 10); elle peut se trouver dissociée de l'action(« Le
chat et le
renard», IX, 14), ou rester vide de sens(« Les femmes et le secret», VIII, 6).
La révélation par la parole
D'un autre côté, la parole participe de la révélation et d'un désir de vérité ;
plusieurs fables de premier plan dévoilent cet aspect positif et efficace de la
parole: «Le pouvoir des fables» (VIII, 4) ; «Le bassa et le marchand», VIII, 18).
Conclusion : La netteté et la concision du récit, autant que la voix des per
sonnages et celle du fabuliste, participent de cette gaieté des fables qui ôte
tout pédantisme
à leur enseignement.
LES FABLES DE LA FONTAINE~.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Récit mythique et discours scientifique
- Discours et récit chez Maupassant
- Analyse rhétorique du discours de Cicéron pour Milon
- Question d’interprétation Comment Dom Juan défend-il dans ce discours de l’hypocrisie ?
- Les discours des pauvres sont vains