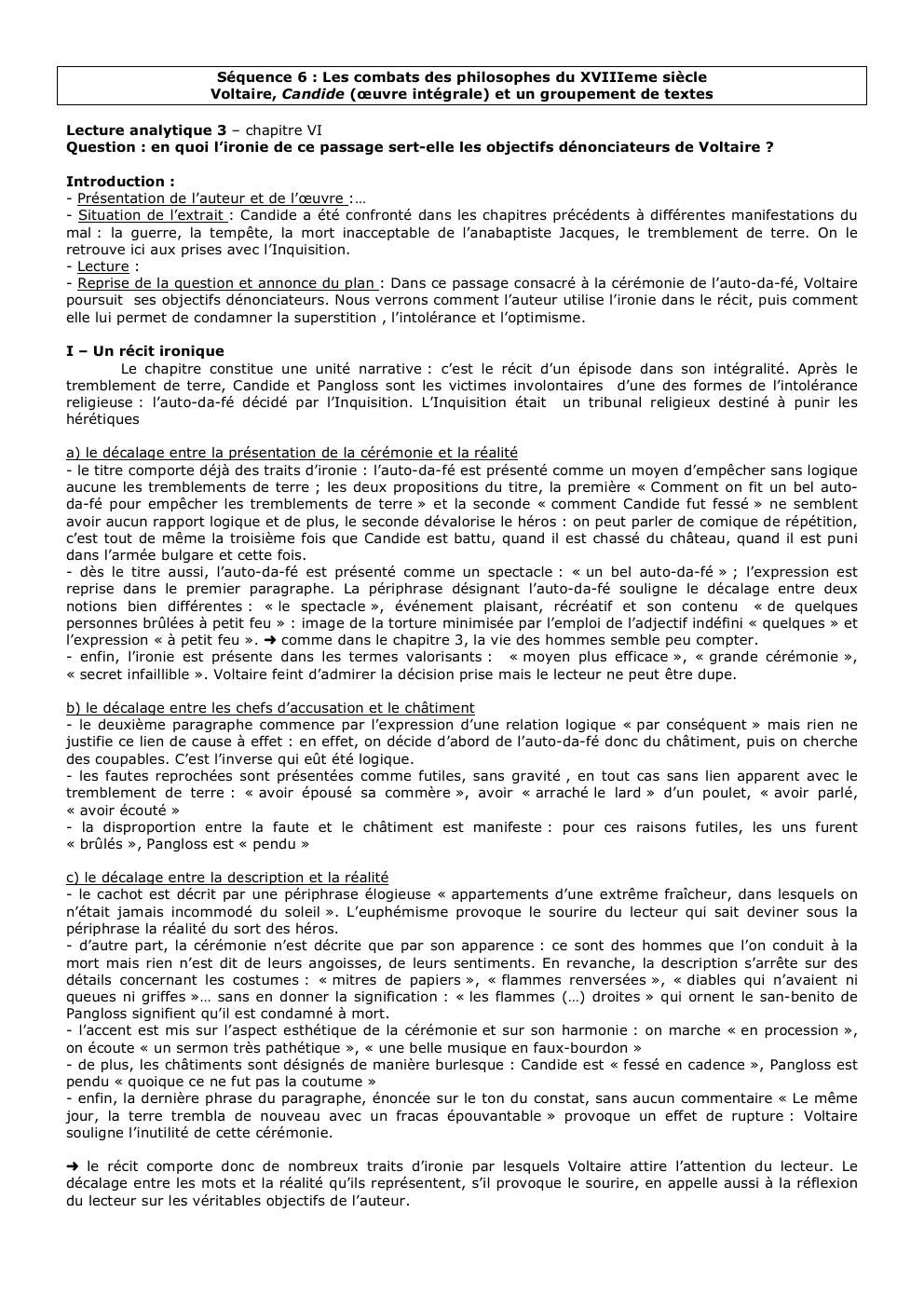Séquence 6 : Les combats des philosophes du XVIIIeme siècle Voltaire, Candide (œuvre intégrale) et un groupement de textes Lecture analytique 3 – chapitre VI
Publié le 30/04/2025
Extrait du document
«
Séquence 6 : Les combats des philosophes du XVIIIeme siècle
Voltaire, Candide (œuvre intégrale) et un groupement de textes
Lecture analytique 3 – chapitre VI
Question : en quoi l’ironie de ce passage sert-elle les objectifs dénonciateurs de Voltaire ?
Introduction :
- Présentation de l’auteur et de l’œuvre :…
- Situation de l’extrait : Candide a été confronté dans les chapitres précédents à différentes manifestations du
mal : la guerre, la tempête, la mort inacceptable de l’anabaptiste Jacques, le tremblement de terre.
On le
retrouve ici aux prises avec l’Inquisition.
- Lecture :
- Reprise de la question et annonce du plan : Dans ce passage consacré à la cérémonie de l’auto-da-fé, Voltaire
poursuit ses objectifs dénonciateurs.
Nous verrons comment l’auteur utilise l’ironie dans le récit, puis comment
elle lui permet de condamner la superstition , l’intolérance et l’optimisme.
I – Un récit ironique
Le chapitre constitue une unité narrative : c’est le récit d’un épisode dans son intégralité.
Après le
tremblement de terre, Candide et Pangloss sont les victimes involontaires d’une des formes de l’intolérance
religieuse : l’auto-da-fé décidé par l’Inquisition.
L’Inquisition était un tribunal religieux destiné à punir les
hérétiques
a) le décalage entre la présentation de la cérémonie et la réalité
- le titre comporte déjà des traits d’ironie : l’auto-da-fé est présenté comme un moyen d’empêcher sans logique
aucune les tremblements de terre ; les deux propositions du titre, la première « Comment on fit un bel autoda-fé pour empêcher les tremblements de terre » et la seconde « comment Candide fut fessé » ne semblent
avoir aucun rapport logique et de plus, le seconde dévalorise le héros : on peut parler de comique de répétition,
c’est tout de même la troisième fois que Candide est battu, quand il est chassé du château, quand il est puni
dans l’armée bulgare et cette fois.
- dès le titre aussi, l’auto-da-fé est présenté comme un spectacle : « un bel auto-da-fé » ; l’expression est
reprise dans le premier paragraphe.
La périphrase désignant l’auto-da-fé souligne le décalage entre deux
notions bien différentes : « le spectacle », événement plaisant, récréatif et son contenu « de quelques
personnes brûlées à petit feu » : image de la torture minimisée par l’emploi de l’adjectif indéfini « quelques » et
l’expression « à petit feu ».
➜ comme dans le chapitre 3, la vie des hommes semble peu compter.
- enfin, l’ironie est présente dans les termes valorisants : « moyen plus efficace », « grande cérémonie »,
« secret infaillible ».
Voltaire feint d’admirer la décision prise mais le lecteur ne peut être dupe.
b) le décalage entre les chefs d’accusation et le châtiment
- le deuxième paragraphe commence par l’expression d’une relation logique « par conséquent » mais rien ne
justifie ce lien de cause à effet : en effet, on décide d’abord de l’auto-da-fé donc du châtiment, puis on cherche
des coupables.
C’est l’inverse qui eût été logique.
- les fautes reprochées sont présentées comme futiles, sans gravité , en tout cas sans lien apparent avec le
tremblement de terre : « avoir épousé sa commère », avoir « arraché le lard » d’un poulet, « avoir parlé,
« avoir écouté »
- la disproportion entre la faute et le châtiment est manifeste : pour ces raisons futiles, les uns furent
« brûlés », Pangloss est « pendu »
c) le décalage entre la description et la réalité
- le cachot est décrit par une périphrase élogieuse « appartements d’une extrême fraîcheur, dans lesquels on
n’était jamais incommodé du soleil ».
L’euphémisme provoque le sourire du lecteur qui sait deviner sous la
périphrase la réalité du sort des héros.
- d’autre part, la cérémonie n’est décrite que par son apparence : ce sont des hommes que l’on conduit à la
mort mais rien n’est dit de leurs angoisses, de leurs sentiments.
En revanche, la description s’arrête sur des
détails concernant les costumes : « mitres de papiers », « flammes renversées », « diables qui n’avaient ni
queues ni griffes »… sans en donner la signification : « les flammes (…) droites » qui ornent le san-benito de
Pangloss signifient qu’il est condamné à mort.
- l’accent est mis sur l’aspect esthétique de la cérémonie et sur son harmonie : on marche « en procession »,
on écoute « un sermon très pathétique », « une belle musique en faux-bourdon »
- de plus, les châtiments sont désignés de manière burlesque : Candide est « fessé en cadence », Pangloss est
pendu « quoique ce ne fut pas la coutume »
- enfin, la dernière phrase du paragraphe, énoncée sur le ton du constat, sans aucun commentaire « Le même
jour, la terre trembla de nouveau avec un fracas épouvantable » provoque un effet de rupture : Voltaire
souligne l’inutilité de cette cérémonie.
➜ le récit comporte donc de nombreux traits d’ironie par lesquels Voltaire attire l’attention du lecteur.
Le
décalage entre les mots et la réalité qu’ils représentent, s’il provoque le sourire, en appelle aussi à la réflexion
du lecteur sur les véritables objectifs de l’auteur.
II – Un texte de dénonciation
Dans ce récit, Voltaire a pour cibles principales l’obscurantisme, l’intolérance et la philosophie de
l’Optimisme
a) la dénonciation de l’obscurantisme
- La lutte contre l’obscurantisme est commune aux philosophes du XVIIIe siècle : il s’agit pour eux de
dénoncer, au nom de la raison, ce qui est superstition, croyances irrationnelles, préjugés.
- Ici, dès les premières lignes, Voltaire s’en prend à ce type....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Lecture analytique : Chapitre 6 de Candide, Voltaire
- Lecture Analytique Candide, Chapitre 30, Voltaire
- LECTURE ANALYTIQUE CANDIDE, VOLTAIRE: Chapitre III « La guerre »
- CANDIDE , Voltaire : Lecture analytique chapitre I le paradis terrestre
- Lecture analytique du Chapitre 19 de Candide, Voltaire de « en approchant de la ville » jusqu'à « il entra dans Surinam »