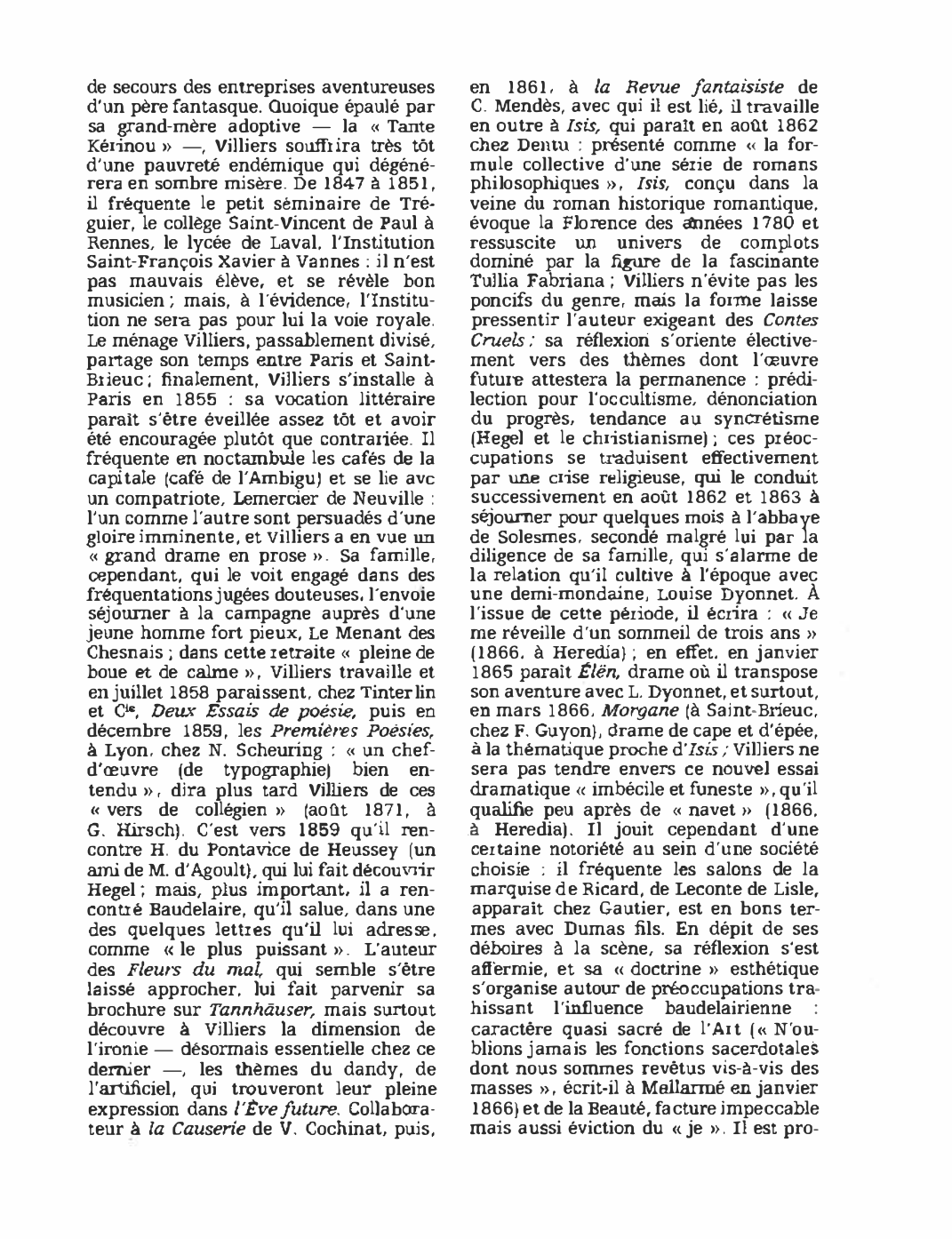VILLIERS DE L'Isle-Adam
Publié le 22/05/2019

Extrait du document
VILLIERS DE L'Isle-Adam (Jean Marie Mathias Philippe Auguste, comte de), poète et prosateur français (Saint-Brieuc, 1838 -Paris 1889). Villiers était d'illustre lignage — il portera d'ailleurs son nom en héritier convaincu de ses prérogatives — et sa famille, ruinée par la Révolution, ne devait guère recevoir de secours des entreprises aventureuses d'un père fantasque. Quoique épaulé par sa grand-mère adoptive — la « Tante Kérinou » —, Villiers souffrira très tôt d'une pauvreté endémique qui dégénérera en sombre misère. De 1847 à 1851, il fréquente le petit séminaire de Tré-guier, le collège Saint-Vincent de Paul à Rennes, le lycée de Laval, l'institution Saint-François Xavier à Vannes : il n'est pas mauvais élève, et se révèle bon musicien ; mais, à l'évidence, l'institution ne sera pas pour lui la voie royale. Le ménage Villiers, passablement divisé, partage son temps entre Paris et Saint-Brieuc ; finalement, Villiers s'installe à Paris en 1855 : sa vocation littéraire paraît s'être éveillée assez tôt et avoir été encouragée plutôt que contrariée. Il fréquente en noctambule les cafés de la capitale (café de l'Ambigu) et se lie avec un compatriote, Lemercier de Neuville : l'un comme l'autre sont persuadés d'une gloire imminente, et Villiers a en vue un « grand drame en prose ». Sa famille, cependant, qui le voit engagé dans des fréquentations jugées douteuses, l'envoie séjourner à la campagne auprès d'une jeune homme fort pieux, Le Menant des Chesnais ; dans cette retraite « pleine de boue et de calme », Villiers travaille et en juillet 1858 paraissent, chez Tinterlin et Cle, Deux Essais de poésie, puis en décembre 1859, les Premières Poésies, à Lyon, chez N. Scheuring : « un chef-d'œuvre (de typographie) bien entendu », dira plus tard Villiers de ces « vers de collégien » (août 1871, à G. Hirsch). C'est vers 1859 qu'il rencontre H. du Pontavice de Heussey (un ami de M. d'Agoult), qui lui fait découvrir Hegel; mais, plus important, il a rencontré Baudelaire, qu'il salue, dans une des quelques lettres qu'il lui adresse, comme « le plus puissant ». L'auteur des Fleurs du mal, qui semble s'être laissé approcher, lui fait parvenir sa brochure sur Tannhauser, mais surtout découvre à Villiers la dimension de l'ironie — désormais essentielle chez ce dernier —, les thèmes du dandy, de l'artificiel, qui trouveront leur pleine expression dans l'Ève future. Collaborateur à la Causerie de V. Cochinat, puis,
en 1861, à la Revue fantaisiste de C. Mendès, avec qui il est lié, il travaille en outre à Isis, qui paraît en août 1862 chez Dentu : présenté comme « la formule collective d'une série de romans philosophiques », Isis, conçu dans la veine du roman historique romantique, évoque la Florence des années 1780 et ressuscite un univers de complots dominé par la figure de la fascinante Tullia Fabriana ; Villiers n'évite pas les poncifs du genre, mais la forme laisse pressentir l'auteur exigeant des Contes Cruels; sa réflexion s'oriente électivement vers des thèmes dont l'œuvre future attestera la permanence :
«
de
secours des entreprises aventureuses
d'un père fantasque.
Quoique épaulé par
sa grand-mère adoptive -la « Tante
Kérinou » -, Villiers souff rira très tOt
d'une pauvre té endémique qui dégéné
rera en sombre misère.
De 1847 à 1851,
il fréquente le petit séminaire de Tré
guier, le collège Saint-Vincent de Paul à
Rennes, le lycée de Laval, l'In sti tution
Saint-François Xavier à Vannes : il n'e st
pas mauvais élève, et se révèle bon
musicien; mais, à !"évidence, l'Institu
tion ne sera pas pour lui la voie royale.
Le ménage Villiers, pa ss ab lem en t divisé,
partage son temps entre Paris et Saint
Brieuc ; finalement, Villiers s'installe à
Paris en 1855 : sa vocation littéraire
parait s'être éveillée assez tOt et avoir
été encouragée plutôt que contrariée.
Il
fréquente en no ctam bule les cafés de la
c a pi ta le (café de l'Ambigu) et se lie ave
un compatriote, Lemercier de Neuville :
l'un comme !"au tr e s ont p ers uadé s d'une
gloire imminente, et Villiers a en vue un
« grand drame en prose >>.
Sa famille,
cependant, qui le voit engagé dans des
fréquentations jugées douteuses, l"envoie
séjourner à la campagne auprès d'une
jeune homme fort pieux, Le Menant des
Chesnais ; dans cette retraite « pleine de
boue et de calm e », Villiers travaille et
en juillet !858 par aissen t, chez Tinter lin
et C1•, Deux Essais de poésie, puis en
décembre 1859, les Premières Poésies,
à Lyon, chez N.
Scheuring : «un chef
d'œuvre (de typographie) bien en
tendu », dira plus tard Vi
lli ers de ces
« vers de collégien » (août 1871, à
G.
Hirschj.
C'est vers 1859 qu'il ren
contre H.
du Pontavice de Heussey (un
ami de M.
d'Ag oul t), qui lui fait découvrir
Hegel; mais, plus important, il a ren
contré Baudelaire, qu' il salue, dans une
des quelques lettres qu'il lui adr es se ,
comme «le plus puissant».
L'auteur
des Fleurs du mal, qui semble s'être
laissé app roc her, lui fait parvenir sa
br oc h ure sur Tannhauser, mais surtout
découvre à Villiers la dimension de
l'ironie -désormais essenti ell e chez ce
dernier -, les thèmes du dandy, de
l'artificiel.
qui trouveront leur pleine
e x pressio n dans l'Ève future.
Collabora
teur à la Causerie de V.
Coc h in at, puis, en
1861, à la Revue fantaisiste de
C.
Mendès, avec qui il est lié, il travaille
en outre à Isis , qui parait en août 1862
ch ez Dentu : présenté comme.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Contes cruels et Nouveaux Contes CRUELS d'Auguste de Villiers de L'Isle-Adam (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- AxËL. Drame de Villiers de L'Isle-Adam (fiche de lecture)
- La cruauté du conte : les Contes cruels Villiers de L’Isle-Adam (résumé)
- AXËL D’AUËRSPERG de Villiers de l’Isle-Adam Axël
- CONTES CRUELS Villiers de L’Isle-Adam (résumé & analyse)