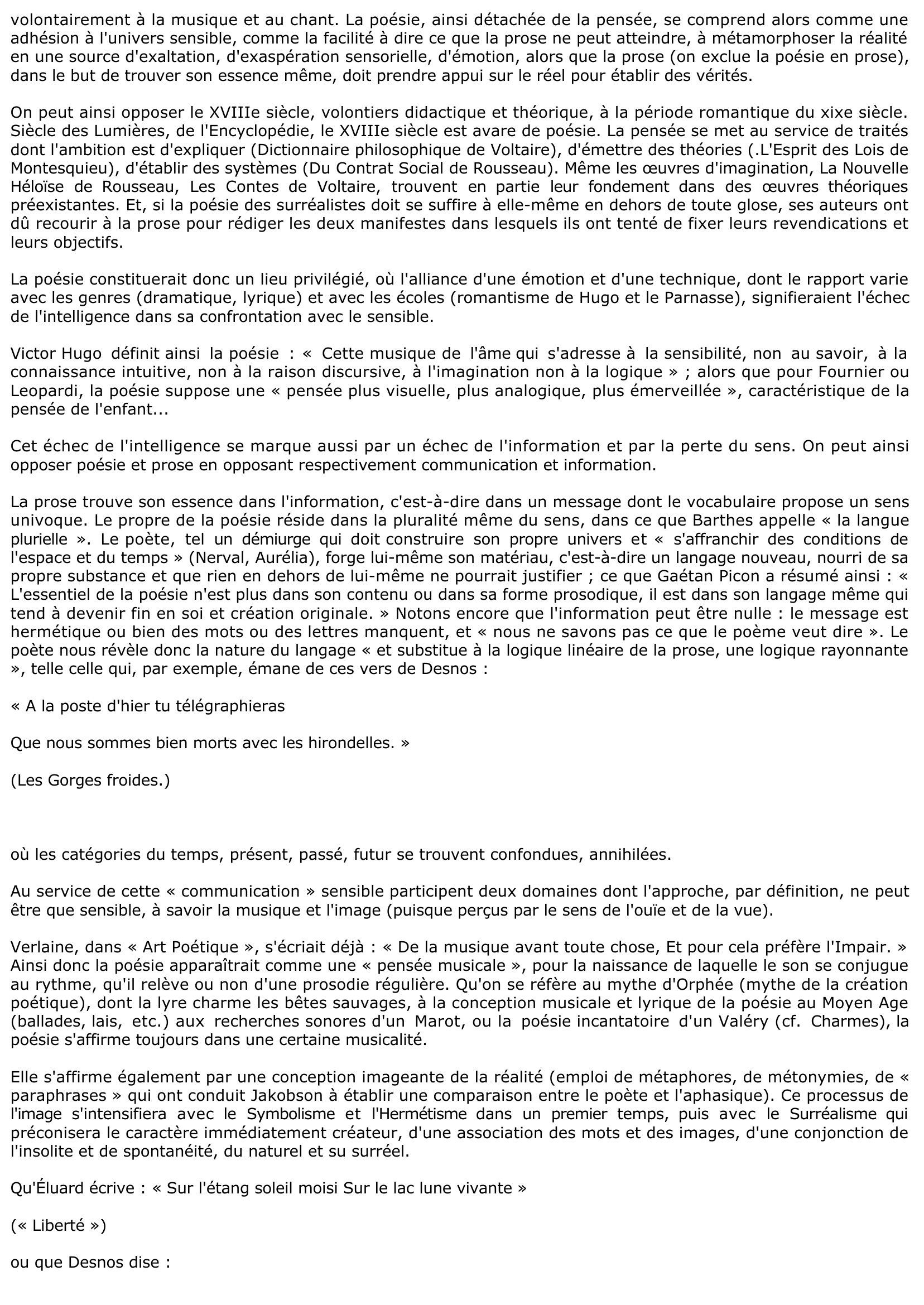Vous expliquerez et discuterez, en vous appuyant sur des exemples de votre choix, cette affirmation de J. Supervielle : « La poésie, surtout la poésie moderne, n'a nullement pour mobile la pensée... alors qu'en prose, on cherche à fixer, à immobiliser la pensée. »
Publié le 08/03/2011

Extrait du document
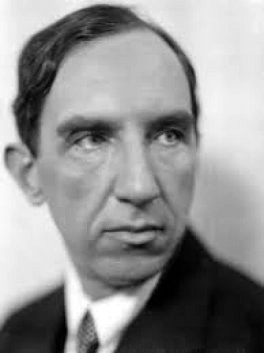
Le sujet présuppose une bonne connaissance des conceptions, qui tour à tour, au fil des siècles et selon les écoles artistiques, ont tenté de définir l'essence de la poésie. En effet, on ne pourrait confirmer ou infirmer la remarque de Jules Supervielle sans appuis théoriques tirés des conceptions esthétiques de la Pléiade, du classicisme, du romantisme, du symbolisme, du surréalisme. Mais attention à ne pas tomber dans le piège du déballage encyclopédique qui ne témoigne pas d'une réflexion personnelle, ni d'une compréhension synthétique, susceptibles de répondre à la question précise posée par le sujet.
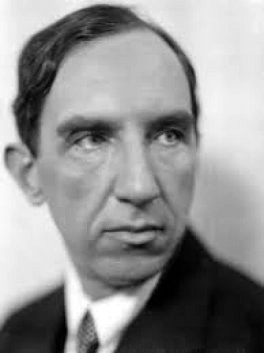
«
volontairement à la musique et au chant.
La poésie, ainsi détachée de la pensée, se comprend alors comme uneadhésion à l'univers sensible, comme la facilité à dire ce que la prose ne peut atteindre, à métamorphoser la réalitéen une source d'exaltation, d'exaspération sensorielle, d'émotion, alors que la prose (on exclue la poésie en prose),dans le but de trouver son essence même, doit prendre appui sur le réel pour établir des vérités.
On peut ainsi opposer le XVIIIe siècle, volontiers didactique et théorique, à la période romantique du xixe siècle.Siècle des Lumières, de l'Encyclopédie, le XVIIIe siècle est avare de poésie.
La pensée se met au service de traitésdont l'ambition est d'expliquer (Dictionnaire philosophique de Voltaire), d'émettre des théories (.L'Esprit des Lois deMontesquieu), d'établir des systèmes (Du Contrat Social de Rousseau).
Même les œuvres d'imagination, La NouvelleHéloïse de Rousseau, Les Contes de Voltaire, trouvent en partie leur fondement dans des œuvres théoriquespréexistantes.
Et, si la poésie des surréalistes doit se suffire à elle-même en dehors de toute glose, ses auteurs ontdû recourir à la prose pour rédiger les deux manifestes dans lesquels ils ont tenté de fixer leurs revendications etleurs objectifs.
La poésie constituerait donc un lieu privilégié, où l'alliance d'une émotion et d'une technique, dont le rapport varieavec les genres (dramatique, lyrique) et avec les écoles (romantisme de Hugo et le Parnasse), signifieraient l'échecde l'intelligence dans sa confrontation avec le sensible.
Victor Hugo définit ainsi la poésie : « Cette musique de l'âme qui s'adresse à la sensibilité, non au savoir, à laconnaissance intuitive, non à la raison discursive, à l'imagination non à la logique » ; alors que pour Fournier ouLeopardi, la poésie suppose une « pensée plus visuelle, plus analogique, plus émerveillée », caractéristique de lapensée de l'enfant...
Cet échec de l'intelligence se marque aussi par un échec de l'information et par la perte du sens.
On peut ainsiopposer poésie et prose en opposant respectivement communication et information.
La prose trouve son essence dans l'information, c'est-à-dire dans un message dont le vocabulaire propose un sensunivoque.
Le propre de la poésie réside dans la pluralité même du sens, dans ce que Barthes appelle « la langueplurielle ».
Le poète, tel un démiurge qui doit construire son propre univers et « s'affranchir des conditions del'espace et du temps » (Nerval, Aurélia), forge lui-même son matériau, c'est-à-dire un langage nouveau, nourri de sapropre substance et que rien en dehors de lui-même ne pourrait justifier ; ce que Gaétan Picon a résumé ainsi : «L'essentiel de la poésie n'est plus dans son contenu ou dans sa forme prosodique, il est dans son langage même quitend à devenir fin en soi et création originale.
» Notons encore que l'information peut être nulle : le message esthermétique ou bien des mots ou des lettres manquent, et « nous ne savons pas ce que le poème veut dire ».
Lepoète nous révèle donc la nature du langage « et substitue à la logique linéaire de la prose, une logique rayonnante», telle celle qui, par exemple, émane de ces vers de Desnos :
« A la poste d'hier tu télégraphieras
Que nous sommes bien morts avec les hirondelles.
»
(Les Gorges froides.)
où les catégories du temps, présent, passé, futur se trouvent confondues, annihilées.
Au service de cette « communication » sensible participent deux domaines dont l'approche, par définition, ne peutêtre que sensible, à savoir la musique et l'image (puisque perçus par le sens de l'ouïe et de la vue).
Verlaine, dans « Art Poétique », s'écriait déjà : « De la musique avant toute chose, Et pour cela préfère l'Impair.
»Ainsi donc la poésie apparaîtrait comme une « pensée musicale », pour la naissance de laquelle le son se conjugueau rythme, qu'il relève ou non d'une prosodie régulière.
Qu'on se réfère au mythe d'Orphée (mythe de la créationpoétique), dont la lyre charme les bêtes sauvages, à la conception musicale et lyrique de la poésie au Moyen Age(ballades, lais, etc.) aux recherches sonores d'un Marot, ou la poésie incantatoire d'un Valéry (cf.
Charmes), lapoésie s'affirme toujours dans une certaine musicalité.
Elle s'affirme également par une conception imageante de la réalité (emploi de métaphores, de métonymies, de «paraphrases » qui ont conduit Jakobson à établir une comparaison entre le poète et l'aphasique).
Ce processus del'image s'intensifiera avec le Symbolisme et l'Hermétisme dans un premier temps, puis avec le Surréalisme quipréconisera le caractère immédiatement créateur, d'une association des mots et des images, d'une conjonction del'insolite et de spontanéité, du naturel et su surréel.
Qu'Éluard écrive : « Sur l'étang soleil moisi Sur le lac lune vivante »
(« Liberté »)
ou que Desnos dise :.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- André Gide s'adresse ainsi à un jeune homme : « Ne cherche pas à remanger ce qu'ont digéré tes ancêtres. Vois s'envoler les grains ailés du platane et du sycomore, comme s'ils comprenaient que l'ombre paternelle ne leur promet qu'étiolement et qu'atrophie ... sache comprendre et t'éloigner le plus possible du passé. » Par ailleurs Renan a écrit : « Tous les siècles d'une nation sont les feuillets d'un même livre. Les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont pour point de départ un res
- Dans La Métamorphose des dieux (1957), André Malraux écrit : « L'oeuvre surgit dans son temps et de son temps, mais elle devient oeuvre d'art par ce qui lui (le temps) échappe. » Vous expliquerez et au besoin discuterez cette affirmation en appuyant votre raisonnement sur des exemples précis tirés de la littérature et, éventuellement, d'autres formes d'art.
- Dans son essai Croissance zéro, Alfred Sauvy écrit, à propos de la fascination qu'exerce sur l'homme l'idée du retour à la nature : « ... L'idée séduisante de retour à l'état naturel, à une vie végétale, ne dure guère qu'un été et d'une façon très relative. Virgile s'extasiait devant les gémissements des boeufs, mais avait des esclaves pour traire ses vaches. Rousseau fut fort aise de trouver une assistance publique pour élever ses enfants. Quant à Diogene, il devait bien produire quel
- A la fin de son ouvrage, La Préciosité et les précieux, de Thibaut de Champagne à J. Giraudoux, René Bray, cherchant à définir une « éthique de la préciosité », note (page 395) : « Ne pourrait-on dire que, dans la préciosité, le poète, au fond, est toujours seul devant soi ? Qu'il quête ou non l'applaudissement, il cherche d'abord sa propre approbation. Se distinguer des autres, c'est se donner du prix à soi et pour soi : le juge suprême, c'est toujours soi. La préciosité est une « dan
- Dans La Métamorphose des dieux (1957), André Malraux écrit : « L'oeuvre surgit dans son temps et de sort temps, mais elle devient oeuvre d'art par ce qui lui (1) échappe. » Vous expliquerez et, au besoin, discuterez cette affirma¬tion en appuyant votre raisonnement sur des exemples pré¬cis tirés de la littérature et éventuellement d'autres formes d'art.