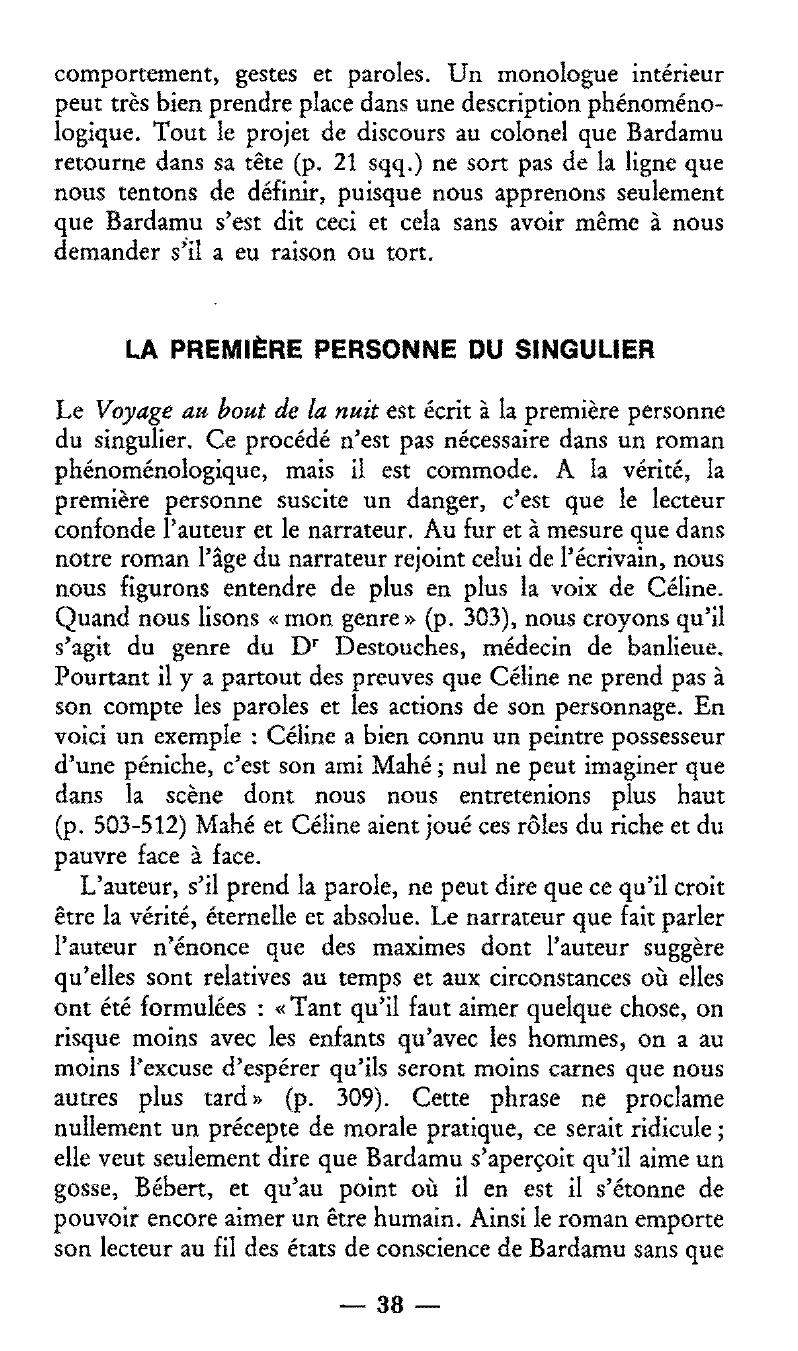Voyage au bout de la nuit de Céline: L’âge du roman phénoménologique
Publié le 23/01/2020

Extrait du document
surprenante de Louis-Ferdinand Destouches dans le roman, l’insertion d’un appel personnel à quelque Américaine perdue.
Le reste du Voyage est d’une autre facture. La tante de Bébert est un cas très intéressant. Nous pourrions d’abord la confondre avec les comédiennes dont nous parlions plus haut. « Elle ne pensait à rien. Elle parlait énormément sans jamais penser» (p. 310). En réalité ces lignes préparent l’admirable page où Céline décrit la dernière entrevue de la vieille femme et de Bardamu, après la mort de Bébert (p. 440-441). On s’aperçoit alors que le flot de paroles n’est pas une apparence tandis que dans le secret de son cœur souffrirait l’être humain véritable, accablé par le deuil. La tante ne « pense » pas plus que d’habitude, la disparition de l’enfant ne lui a pas donné une « âme » ; elle parle et ce rabâchage est poignant et respectable comme toutes les douleurs. Bardamu découvre que la peine de la malheureuse est tout entière dans l’effort qu’elle fait pour dire « toutes les gentilles qualités » de l’enfant. Ce discours incohérent et un peu ivre est le chagrin de la tante. C’est un phénomène qui ne cache rien, qui ne renvoie à rien ; il se suffit à lui-même. La « scène » est d’autant plus belle que le narrateur semble découvrir lui aussi la nature phénoménologique de ce qui se passe. Avec la tante de Bébert le théâtre célinien prend une autre dimension.
L’AMOUR, LE RÊVE, LA RECHERCHE DE SOI-MÊME
Céline va donc pouvoir faire entrer les hommes tout entiers dans son roman sans devoir renoncer à les saisir tels qu’ils s’offrent à la vue, à l’ouïe, au toucher — à l’odorat ! Les hommes aiment, rêvent et se mettent parfois en quête d’on ne sait quel Graal. Ce sont là des faits.
Dans L’Eglise Bardamu essayait d’expliquer à son amie Vera qu’il cachait dans son cœur un grand amour ineffable pour elle. Pour le contraste, que l’on relise dans le Voyage les propos de Molly et de Ferdinand (p. 291 sqq.). Nous avons vu comment était présenté l’amour de la tante de Bébert. Quant aux deux autres sentiments forts du Voyage, l’amour d’Alcide pour sa nièce (p. 205 sqq.) et celui de Bardamu pour Bébert (p. 351-370), le premier n’est rien d’autre que le sacrifice du sergent pour élever et soigner la fillette, car, mis à
nous puissions jamais trouver référence à des vérités qui transcenderaient l’instant où nous les rencontrons dans le texte. Le «je» et la constante présence de Bardamu placent peut-être le héros au centre du monde connu, on ne peut cependant parler d’égocentrisme, car cette situation ne confère aucun privilège : «Moi là-dedans comme un autre» (p. 277). C’est plutôt modestie : Bardamu ne peut savoir autre chose que ce qu’il sait au moment présent. Et nous, lecteurs, n’en apprendrons jamais davantage.
LA CONNAISSANCE D’AUTRUI
En particulier, sur les autres personnages nous n’apprendrons jamais que ce que Bardamu sait sur eux. « Il y a [...] beaucoup de folie à s’occuper d’autre chose que de ce qu’on voit», dit fort bien Bardamu (p. 221). Des riches on ne connaît rien de précis. Toute cette partie de la société a quelque chose de mythique. Les pauvres sont, comme le dit Céline, plus « substantiels » (p. 100), parce que Bardamu est l’un d’eux, qu’il devine plus de choses en eux et surtout qu’il les voit vivre et les entend parler quotidiennement.
Mais, riche ou pauvre, chaque être humain n’apparaîtra jamais que du point de vue de Bardamu : ce que font Musyne, ou Mme Herote, ou Baryton hors de la présence du narrateur n’est même pas imaginable et, autant dire, n’existe pas ; nous apprenons p. 61 que Robinson a été «un peu graveur», et p. 403 ce même Robinson avoue qu’il a fait de la prison ; nous l’apprenons en même temps que Bardamu : « Il ne m’avait pas dit ça qu’il avait été en prison. Ça avait dû se passer avant qu’on se rencontre, avant la guerre.» Robinson a-t-il été faux-monnayeur ? La question n’est même pas posée explicitement dans le texte. Quant à la mort d’Henrouille, nous ne pouvons que partager les doutes de Bardamu. Ailleurs, si ce dernier, en tant que narrateur, nous dévoile l’intimité des Henrouille, il ajoute tout aussitôt : « J’ai appris tout ça, peu à peu, par eux et puis par d’autres, et puis par la tante à Bébert » (p. 316-317). Céline s’en tient à cette technique avec une rigueur absolue : « On ne sait rien de la véritable histoire des hommes» (p. 86). C’est une des grandes beautés du roman
«
comportement, gestes et paroles.
Un monologue intérieur
peut très bien prendre place dans une description phénoméno
logique.
Tout le projet de discours au colonel que Bardamu
retourne dans sa tête (p.
21 sqq.) ne sort pas de la ligne que
nous tentons de définir, puisque nous apprenons seulement
que Bardamu s'est dit ceci et cela sans avoir même à nous
demander s,.il a eu raison ou tort.
LA PREMIÈRE PERSONNE OU SINGULIER
Le Voyage au bout de la nuit est écrit à la première personne
du singulier.
Ce procédé n'est pas nécessaire dans un roman
phénoménologique, mais il est commode.
A la vérité, la
première personne suscite un danger, c'est que le lecteur
confonde l'auteur et le narrateur.
Au fur et à mesure que dans
notre roman l'âge du narrateur rejoint celui de !'écrivain, nous
nous figurons entendre de plus en plus la voix de Céline.
Quand nous lisons «mon genre» (p.
303), nous croyons qu'il
s'agit du genre du Dr Destouches, médecin de banlieue.
Pourtant il y a partout des preuves que Céline ne prend pas à
son compte les paroles et les actions de son personnage.
En
voici un exemple : Céline a bien connu un peintre possesseur
d'une péniche, c'est son ami Mahé; nul ne peut imaginer que
dans la scène dont nous nous entretenions plus haut
(p.
503-512) Mahé et Céline aient joué ces rôles du riche et du
pauvre face à face.
L'auteur, s'il prend la parole, ne peut dire que ce qu'il croit
être la vérité, éternelle et absolue.
Le narrateur que fait parler
l'auteur n'énonce que des maximes dont l'auteur suggère
qu'elles sont relatives au temps et aux circonstances où elles
ont été formulées : «Tant qu'il faut aimer quelque chose, on
risque moins avec les enfants qu'avec les hommes, on a au
moins l'excuse d'espérer qu'ils seront moins carnes que nous
autres plus tard» (p.
309).
Cette phrase ne proclame
nullement un précepte de morale pratique, ce serait ridicule;
elle veut seulement dire que Bardamu s'aperçoit qu'il aime un
gosse, Bébert, et qu'au point où il en est il s'étonne de
pouvoir encore aimer un être humain.
Ainsi le roman emporte
son lecteur au fil des états de conscience de Bardamu sans que
-38-.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Un roman phénoménologique - Voyage au bout de la nuit (Céline)
- Qu'y a-t-il du voyage, du bout et de la nuit dans le roman de Céline ?
- Voyage au bout de la nuit de Céline: Problèmes de structures Le sens général du roman
- Un roman sur l'amour - Voyage au bout de la nuit (Céline)
- Un roman picaresque - Voyage au bout de la nuit (Céline)