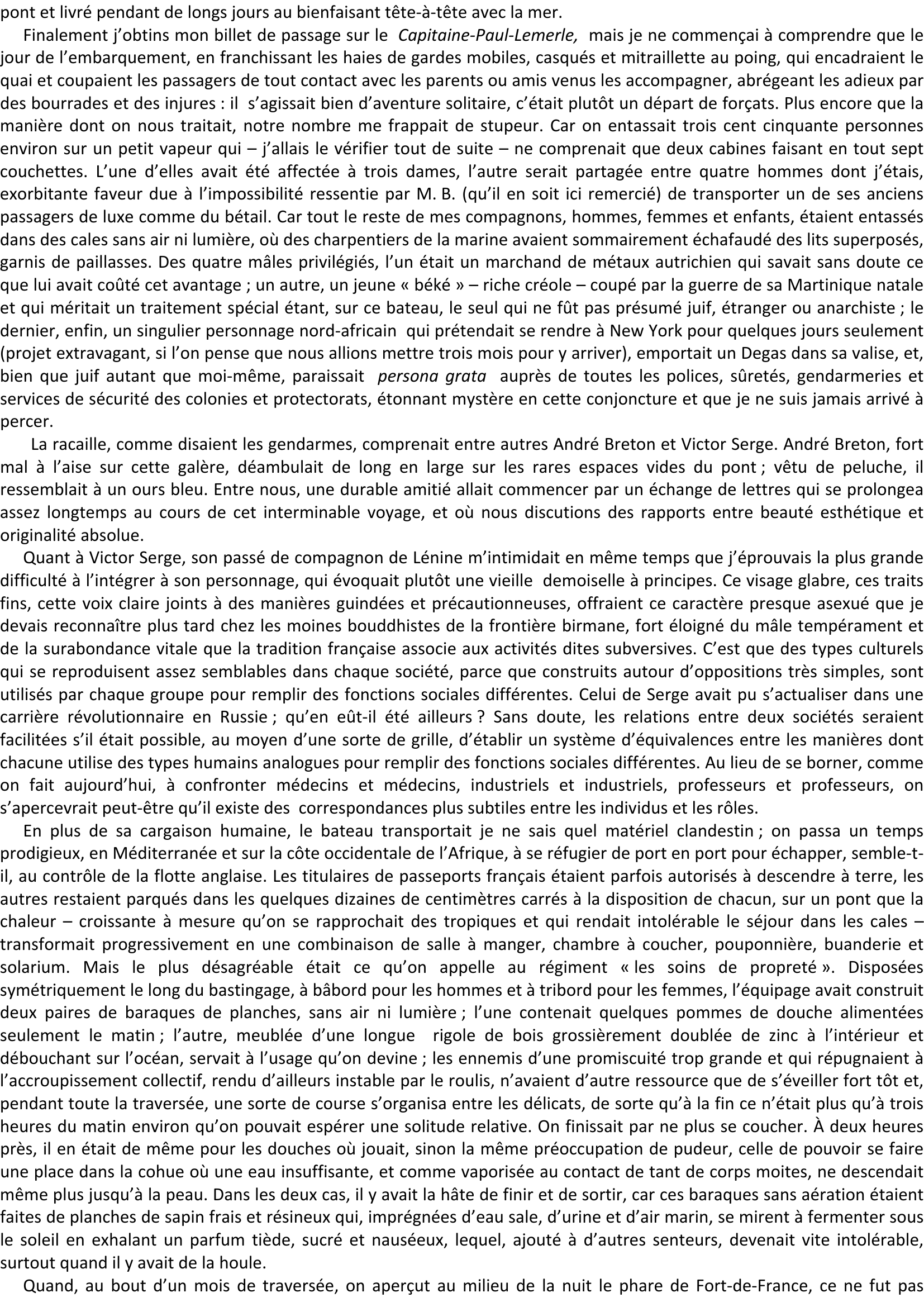II EN BATEAU Nous ne nous doutions pas, en tout cas, que, pendant les quatre ou cinq années qui suivirent, notre petit groupe était estiné à constituer - sauf de rares exceptions - l'effectif entier des premières sur les paquebots mixtes de la Compagnie es Transports Maritimes qui desservait l'Amérique du Sud. On nous proposait les secondes sur le seul bateau de luxe qui aisait cette route, ou les premières sur des navires plus modestes. Les intrigants choisissaient la première formule en ayant la différence de leur poche ; ils espéraient ainsi se frotter aux ambassadeurs et en recueillir des avantages roblématiques. Nous autres, nous prenions les bateaux mixtes qui mettaient six jours de plus, mais dont nous étions les aîtres et qui faisaient beaucoup d'escales. Je voudrais aujourd'hui qu'il m'ait été donné, voici vingt ans, d'apprécier à sa juste valeur le luxe inouï, le royal rivilège qui consiste dans l'occupation exclusive, par les huit ou dix passagers du pont, des cabines, du fumoir et de la alle à manger des premières, sur un bateau conçu pour accommoder cent ou cent cinquante personnes. En mer pendant ix-neuf jours, cet espace rendu presque sans borne par l'absence d'autrui nous était une province ; notre apanage se ouvait avec nous. Après deux ou trois traversées, nous retrouvions nos bateaux, nos habitudes ; et nous connaissions ar leur nom, avant même de monter à bord, tous ces excellents stewards marseillais, moustachus et chaussés de fortes emelles, qui exhalaient une puissante odeur d'ail au même moment qu'ils déposaient dans nos assiettes les suprêmes de oularde et les filets de turbot. Les repas, déjà prévus pour être pantagruéliques, le devenaient encore davantage du fait ue nous étions peu nombreux à consommer la cuisine du bord. La fin d'une civilisation, le début d'une autre, la soudaine découverte par notre monde que, peut-être, il commence à devenir trop petit pour les hommes qui l'habitent, ce ne sont point tant les chiffres, les statistiques et les révolutions qui e rendent ces vérités palpables que la réponse, reçue il y a quelques semaines au téléphone, alors que je jouais avec 'idée - quinze ans après - de retrouver ma jeunesse à l'occasion d'une nouvelle visite au Brésil : en tout état de cause, il e faudrait retenir un passage quatre mois à l'avance. Moi qui m'imaginais que, depuis l'établissement des services aériens pour passagers entre l'Europe et l'Amérique du ud, il n'y avait plus que de rares excentriques pour prendre les bateaux ! Hélas, c'est encore se faire trop d'illusions, de roire que l'invasion d'un élément en libère un autre. Du fait des Constellations, la mer ne retrouve pas plus son calme ue les lotissements en série de la Côte d'Azur ne nous rendent des environs de Paris villageois. Mais c'est qu'entre les traversées merveilleuses de la période 1935 et celle à quoi je m'empressai de renoncer il y en vait eu, en 1941, une autre dont je ne me doutais pas non plus à quel point elle serait symbolique des temps futurs. Au endemain de l'armistice, l'amicale attention portée à mes travaux ethnographiques par Robert H. Lowie et A. Métraux, jointe à la vigilance de parents installés aux États-Unis, m'avait valu, dans le cadre du plan de sauvetage des savants uropéens menacés par l'occupation allemande élaboré par la Fondation Rockefeller, une invitation à la New School for Social Research de New York. Il fallait y partir, mais comment ? Ma première idée avait été de prétendre rejoindre le Brésil pour y poursuivre mes recherches d'avant-guerre. Dans le petit rez-de-chaussée vichyssois où s'était installée l'ambassade du Brésil, une brève et pour moi tragique scène se déroula, quand j'allai solliciter le renouvellement de mon visa. L'ambassadeur Luis de Souza-Dantas, que je connaissais bien et qui aurait agi de même si je ne l'avais pas connu, vait levé son cachet et s'apprêtait à tamponner le passeport, quand un conseiller déférent et glacial l'interrompit en lui aisant observer que ce pouvoir venait de lui être retiré par de nouvelles dispositions législatives. Pendant quelques econdes le bras resta en l'air. D'un regard anxieux, presque suppliant, l'ambassadeur tenta d'obtenir de son ollaborateur qu'il détournât la tête tandis que le tampon s'abaisserait, me permettant ainsi de quitter la France, sinon eut-être d'entrer au Brésil. Rien n'y fit, l'oeil du conseiller resta fixé sur la main qui machinalement retomba, à côté du ocument. Je n'aurais pas mon visa, le passeport me fut rendu avec un geste navré. Je rejoignis ma maison cévenole non loin de laquelle, à Montpellier, le hasard de la retraite avait voulu que je fusse émobilisé, et je m'en allai traîner à Marseille ; là, des conversations du port m'apprirent qu'un bateau devait bientôt artir pour la Martinique. De dock en dock, d'officine en officine, je sus finalement que le bateau en question appartenait la même Compagnie des Transports Maritimes dont la mission universitaire française au Brésil avait constitué, pendant outes les années précédentes, une clientèle fidèle et très exclusive. Par une bise hivernale, en février 1941, je retrouvai, ans des bureaux non chauffés et fermés aux trois quarts, un fonctionnaire qui jadis venait nous saluer au nom de la ompagnie. Oui, le bateau existait, oui, il allait partir ; mais il était impossible que je le prenne. Pourquoi ? Je ne me endais pas compte ; il ne pouvait pas m'expliquer, ce ne serait pas comme avant. Mais comment ? Oh, très long, très énible, il ne pouvait même pas m'imaginer là-dessus. Le pauvre homme voyait encore en moi un ambassadeur au petit pied de la culture française ; moi, je me sentais déjà ibier de camp de concentration. Au surplus, je venais de passer les deux années précédentes, d'abord en pleine forêt ierge, puis de cantonnement en cantonnement, dans une retraite échevelée qui m'avait conduit de la ligne Maginot à éziers en passant par la Sarthe, la Corrèze et l'Aveyron : de trains de bestiaux en bergeries ; et les scrupules de mon nterlocuteur me paraissaient incongrus. Je me voyais reprendre sur les océans mon existence errante, admis à partager es travaux et les frugaux repas d'une poignée de matelots lancés à l'aventure sur un bateau clandestin, couchant sur le pont et livré pendant de longs jours au bienfaisant tête-à-tête avec la mer. Finalement j'obtins mon billet de passage sur le Capitaine-Paul-Lemerle, mais je ne commençai à comprendre que le jour de l'embarquement, en franchissant les haies de gardes mobiles, casqués et mitraillette au poing, qui encadraient le quai et coupaient les passagers de tout contact avec les parents ou amis venus les accompagner, abrégeant les adieux par des bourrades et des injures : il s'agissait bien d'aventure solitaire, c'était plutôt un départ de forçats. Plus encore que la anière dont on nous traitait, notre nombre me frappait de stupeur. Car on entassait trois cent cinquante personnes nviron sur un petit vapeur qui - j'allais le vérifier tout de suite - ne comprenait que deux cabines faisant en tout sept ouchettes. L'une d'elles avait été affectée à trois dames, l'autre serait partagée entre quatre hommes dont j'étais, xorbitante faveur due à l'impossibilité ressentie par M. B. (qu'il en soit ici remercié) de transporter un de ses anciens assagers de luxe comme du bétail. Car tout le reste de mes compagnons, hommes, femmes et enfants, étaient entassés ans des cales sans air ni lumière, où des charpentiers de la marine avaient sommairement échafaudé des lits superposés, arnis de paillasses. Des quatre mâles privilégiés, l'un était un marchand de métaux autrichien qui savait sans doute ce ue lui avait coûté cet avantage ; un autre, un jeune « béké » - riche créole - coupé par la guerre de sa Martinique natale t qui méritait un traitement spécial étant, sur ce bateau, le seul qui ne fût pas présumé juif, étranger ou anarchiste ; le ernier, enfin, un singulier personnage nord-africain qui prétendait se rendre à New York pour quelques jours seulement projet extravagant, si l'on pense que nous allions mettre trois mois pour y arriver), emportait un Degas dans sa valise, et, ien que juif autant que moi-même, paraissait persona grata auprès de toutes les polices, sûretés, gendarmeries et services de sécurité des colonies et protectorats, étonnant mystère en cette conjoncture et que je ne suis jamais arrivé à percer. La racaille, comme disaient les gendarmes, comprenait entre autres André Breton et Victor Serge. André Breton, fort mal à l'aise sur cette galère, déambulait de long en large sur les rares espaces vides du pont ; vêtu de peluche, il ressemblait à un ours bleu. Entre nous, une durable amitié allait commencer par un échange de lettres qui se prolongea ssez longtemps au cours de cet interminable voyage, et où nous discutions des rapports entre beauté esthétique et originalité absolue. Quant à Victor Serge, son passé de compagnon de Lénine m'intimidait en même temps que j'éprouvais la plus grande ifficulté à l'intégrer à son personnage, qui évoquait plutôt une vieille demoiselle à principes. Ce visage glabre, ces traits ins, cette voix claire joints à des manières guindées et précautionneuses, offraient ce caractère presque asexué que je evais reconnaître plus tard chez les moines bouddhistes de la frontière birmane, fort éloigné du mâle tempérament et e la surabondance vitale que la tradition française associe aux activités dites subversives. C'est que des types culturels ui se reproduisent assez semblables dans chaque société, parce que construits autour d'oppositions très simples, sont tilisés par chaque groupe pour remplir des fonctions sociales différentes. Celui de Serge avait pu s'actualiser dans une arrière révolutionnaire en Russie ; qu'en eût-il été ailleurs ? Sans doute, les relations entre deux sociétés seraient acilitées s'il était possible, au moyen d'une sorte de grille, d'établir un système d'équivalences entre les manières dont hacune utilise des types humains analogues pour remplir des fonctions sociales différentes. Au lieu de se borner, comme n fait aujourd'hui, à confronter médecins et médecins, industriels et industriels, professeurs et professeurs, on 'apercevrait peut-être qu'il existe des correspondances plus subtiles entre les individus et les rôles. En plus de sa cargaison humaine, le bateau transportait je ne sais quel matériel clandestin ; on passa un temps rodigieux, en Méditerranée et sur la côte occidentale de l'Afrique, à se réfugier de port en port pour échapper, semble-tl, au contrôle de la flotte anglaise. Les titulaires de passeports français étaient parfois autorisés à descendre à terre, les utres restaient parqués dans les quelques dizaines de centimètres carrés à la disposition de chacun, sur un pont que la haleur - croissante à mesure qu'on se rapprochait des tropiques et qui rendait intolérable le séjour dans les cales - ransformait progressivement en une combinaison de salle à manger, chambre à coucher, pouponnière, buanderie et olarium. Mais le plus désagréable était ce qu'on appelle au régiment « les soins de propreté ». Disposées ymétriquement le long du bastingage, à bâbord pour les hommes et à tribord pour les femmes, l'équipage avait construit eux paires de baraques de planches, sans air ni lumière ; l'une contenait quelques pommes de douche alimentées eulement le matin ; l'autre, meublée d'une longue rigole de bois grossièrement doublée de zinc à l'intérieur et ébouchant sur l'océan, servait à l'usage qu'on devine ; les ennemis d'une promiscuité trop grande et qui répugnaient à 'accroupissement collectif, rendu d'ailleurs instable par le roulis, n'avaient d'autre ressource que de s'éveiller fort tôt et, endant toute la traversée, une sorte de course s'organisa entre les délicats, de sorte qu'à la fin ce n'était plus qu'à trois eures du matin environ qu'on pouvait espérer une solitude relative. On finissait par ne plus se coucher. À deux heures près, il en était de même pour les douches où jouait, sinon la même préoccupation de pudeur, celle de pouvoir se faire une place dans la cohue où une eau insuffisante, et comme vaporisée au contact de tant de corps moites, ne descendait ême plus jusqu'à la peau. Dans les deux cas, il y avait la hâte de finir et de sortir, car ces baraques sans aération étaient faites de planches de sapin frais et résineux qui, imprégnées d'eau sale, d'urine et d'air marin, se mirent à fermenter sous le soleil en exhalant un parfum tiède, sucré et nauséeux, lequel, ajouté à d'autres senteurs, devenait vite intolérable, surtout quand il y avait de la houle. Quand, au bout d'un mois de traversée, on aperçut au milieu de la nuit le phare de Fort-de-France, ce ne fut pas l'espoir d'un repas enfin mangeable, d'un lit avec des draps, d'une nuit paisible, qui gonfla le coeur des passagers. Tous es gens qui, jusqu'à l'embarquement, avaient joui de ce que l'anglais appelle joliment les « aménités » de la civilisation, lus que de la faim, de la fatigue, de l'insomnie, de la promiscuité et du mépris, avaient souffert de la saleté forcée, ncore aggravée par la chaleur, dans laquelle ils venaient de passer ces quatre semaines. Il y avait à bord des femmes jeunes et jolies ; des flirts s'étaient dessinés, des rapprochements s'étaient produits. Pour elles, se montrer avant la séparation enfin sous un jour favorable était plus qu'un souci de coquetterie : une traite à régler, une dette à honorer, la preuve loyalement due qu'elles n'étaient pas foncièrement indignes des attentions dont, avec une touchante délicatesse, elles considéraient qu'on leur avait seulement fait crédit. Il n'y avait donc pas simplement un côté bouffon, mais aussi une dose discrète et pathétique, dans ce cri qui montait de toutes les poitrines, remplaçant le « terre ! terre ! » des récits de avigation traditionnels : « Un bain ! enfin un bain ! demain un bain ! » entendait-on de toutes parts en même temps que 'on procédait à l'inventaire fiévreux du dernier morceau de savon, de la serviette non souillée, du chemisier serré pour ette grande occasion. Outre que ce rêve hydrothérapique impliquait une vue exagérément optimiste de l'oeuvre civilisatrice qu'on peut ttendre de quatre siècles de colonisation (car les salles de bains sont rares à Fort-de-France), les passagers n'allaient plus arder à apprendre que leur bateau crasseux et bondé était encore un séjour idyllique, comparé à l'accueil que leur éservait, à peine avions-nous mouillé en rade, une soldatesque en proie à une forme collective de dérangement cérébral ui eût mérité de retenir l'attention de l'ethnologue, si celui-ci n'avait été occupé à utiliser toutes ses ressources ntellectuelles dans le seul but d'échapper à ses fâcheuses conséquences. La plupart des Français avaient vécu une « drôle » de guerre ; celle des officiers en garnison à la Martinique ne relève 'aucun superlatif pour être exactement qualifiée. Leur unique mission, qui était de garder l'or de la Banque de France, 'était dissoute dans une sorte de cauchemar dont l'abus du punch n'était que partiellement responsable, un rôle plus nsidieux, mais non moins essentiel, étant dévolu à la situation insulaire, l'éloignement de la métropole, et une tradition istorique riche en souvenirs de pirates où la surveillance nord-américaine, les missions secrètes de la flotte sous-marine llemande, faisaient sans difficulté la relève de protagonistes à boucles d'oreilles en or, à oeil crevé et à jambe de bois. 'est ainsi que s'était développée une fièvre obsidionale qui, sans qu'aucun engagement se fût produit et pour cause, et ans qu'aucun ennemi ait été jamais aperçu, n'en avait pas moins engendré chez la plupart un sentiment d'affolement. uant aux insulaires, leurs propos révélaient de façon plus prosaïque des démarches intellectuelles du même type : Y'avait plus d'morue, l'île était foutue », entendait-on dire fréquemment, tandis que d'autres expliquaient que Hitler 'était autre que Jésus-Christ redescendu sur terre pour punir la race blanche d'avoir, pendant les deux mille ans qui récèdent, mal suivi ses enseignements. Au moment de l'armistice, les gradés, loin de rallier la France Libre, se sentirent à l'unisson du régime métropolitain. Ils llaient continuer à rester « hors du coup » ; leur résistance physique et morale rongée depuis des mois les eût mis hors 'état de combattre, si tant est qu'ils s'y fussent jamais trouvés ; leur esprit malade retrouvait une sorte de sécurité à emplacer un ennemi réel, mais si éloigné qu'il en était devenu invisible et comme abstrait - les Allemands - par un nnemi imaginaire, mais qui avait l'avantage d'être proche et palpable : les Américains. D'ailleurs, deux bateaux de guerre . S. A. croisaient en permanence devant la rade. Un habile adjoint du commandant en chef des forces françaises éjeunait tous les jours à leur bord, tandis que son supérieur s'employait à enflammer ses troupes de haine et de ancoeur envers les Anglo-Saxons. En fait d'ennemis sur qui exercer une agressivité accumulée depuis des mois, de responsables d'une défaite à laquelle ls se sentaient étrangers puisqu'ils étaient restés à l'écart des combats, mais dont, en un autre sens, ils se sentaient onfusément coupables (n'avaient-ils pas offert l'exemple le plus complet, fourni la réalisation la plus poussée de 'insouciance, des illusions et de la lassitude dont, pour une part au moins, le pays était tombé victime ?), notre bateau eur apportait un échantillonnage particulièrement bien choisi. C'était un peu comme si, en permettant notre mbarquement à destination de la Martinique, les autorités de Vichy n'avaient fait qu'adresser à ces messieurs une argaison de boucs émissaires pour soulager leur bile. La troupe en shorts, casquée et armée qui s'installa dans le bureau u commandant semblait moins se livrer, sur chacun d'entre nous comparaissant isolément devant elle, à un nterrogatoire de débarquement qu'à un exercice d'insultes où nous n'avions qu'à écouter. Ceux qui n'étaient pas français 'entendirent traiter d'ennemis ; ceux qui l'étaient, on leur déniait grossièrement cette qualité en même temps qu'on les ccusait, par leur départ, d'abandonner lâchement leur pays : reproche non seulement contradictoire mais assez singulier ans la bouche d'hommes qui, depuis la déclaration de guerre, avaient vécu en fait à l'abri de la doctrine de Monroe... Adieu les bains ! On décida d'interner tout le monde dans un camp appelé le Lazaret, de l'autre côté de la baie. Trois ersonnes seulement furent autorisées à descendre à terre : le « béké », qui était hors de cause, le mystérieux Tunisien ur présentation d'un document et moi-même, par une grâce spéciale accordée au commandant par le Contrôle naval, ar nous nous étions retrouvés comme de vieilles connaissances : il était second sur un des bateaux que j'avais empruntés vant la guerre.