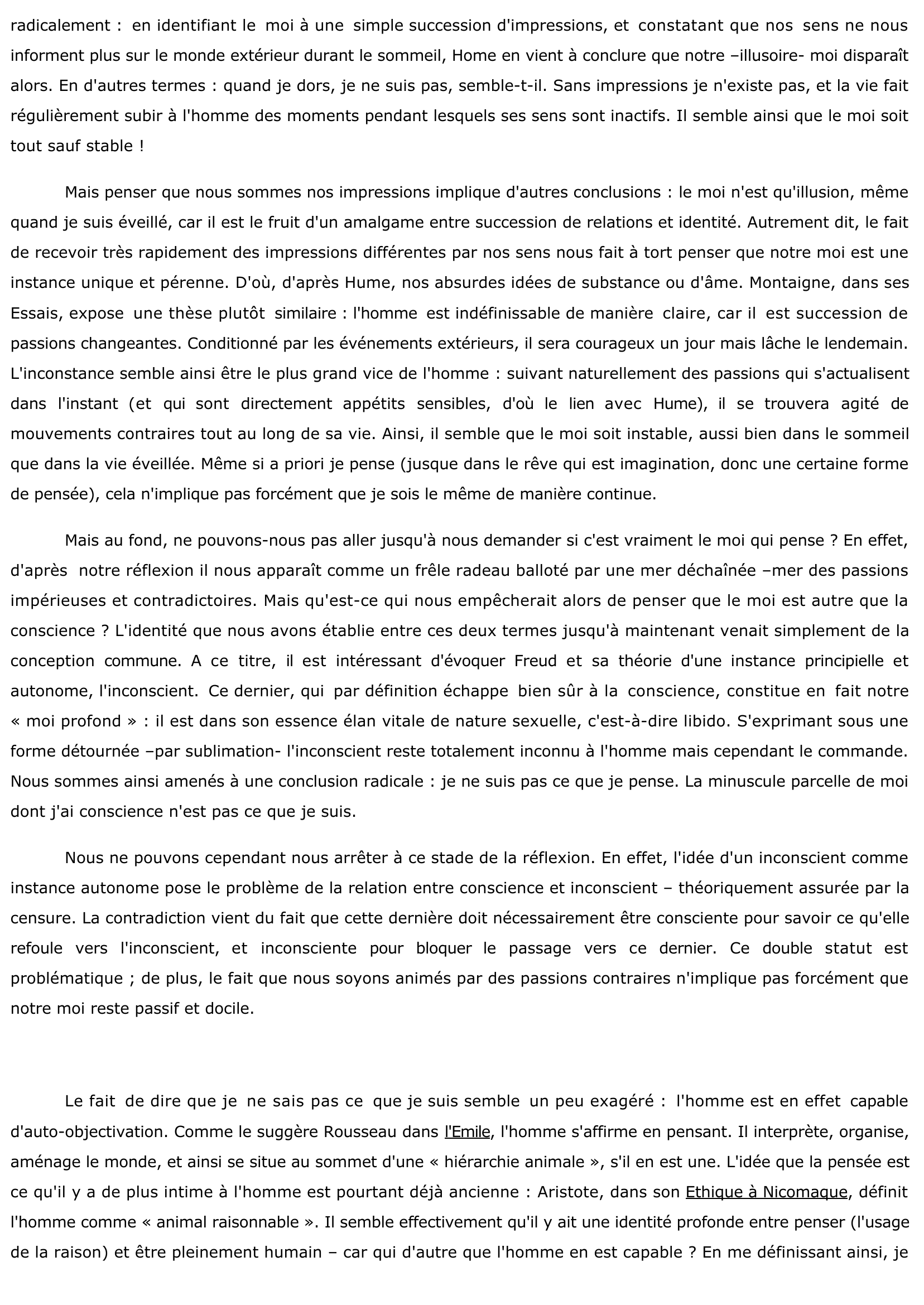A-t-on raison de dire : « parfois je pense et parfois je suis » ?
Publié le 24/05/2011

Extrait du document
« J’étais hors de moi « ; « je n’étais plus moi-même « : beaucoup d’expressions communes, sans que nous ne nous en rendions forcément compte, semblent remettre en cause la stabilité du moi. Ceci est d’ailleurs une préoccupation pour chacun tout au long de la vie : « suis-je le même qu’il y a vingt ans ? « ; le corps change, la pensée gagne en maturité et pourtant mon identité semble rester la même. Paul Valéry, dans Tel quel, formule ces interrogations d’une manière intéressante : « parfois je pense et parfois je suis «. De fait, notre questionnement doit porter non seulement sur une identité entre être et penser, mais encore sur la permanence de la pensée à tous les moments de la vie. Ainsi, nous pouvons problématiser notre réflexion comme suit : peut-on faire reposer tout notre être sur la pensée, dont la permanence ne semble pas aller de soi ? Il serait en effet effrayant de se dire : « je suis parfois vivant ! «. Nous tenterons de procéder logiquement en basant notre réflexion sur quelques opinions communes ; ainsi, nous étudierons dans un premier temps l’apparente instabilité du moi. Nous nous pencherons ensuite sur une possible identité du moi et de la pensée, et sur la pérennité de cette dernière ; enfin, nous évoquerons les problèmes que pose le corps dans notre problématique.
«
radicalement : en identifiant le moi à une simple succession d'impressions, et constatant que nos sens ne nous
informent plus sur le monde extérieur durant le sommeil, Home en vient à conclure que notre –illusoire- moi disparaît
alors.
En d'autres termes : quand je dors, je ne suis pas, semble-t-il.
Sans impressions je n'existe pas, et la vie fait
régulièrement subir à l'homme des moments pendant lesquels ses sens sont inactifs.
Il semble ainsi que le moi soit
tout sauf stable !
Mais penser que nous sommes nos impressions implique d'autres conclusions : le moi n'est qu'illusion, même
quand je suis éveillé, car il est le fruit d'un amalgame entre succession de relations et identité.
Autrement dit, le fait
de recevoir très rapidement des impressions différentes par nos sens nous fait à tort penser que notre moi est une
instance unique et pérenne.
D'où, d'après Hume, nos absurdes idées de substance ou d'âme.
Montaigne, dans ses
Essais, expose une thèse plutôt similaire : l'homme est indéfinissable de manière claire, car il est succession de
passions changeantes.
Conditionné par les événements extérieurs, il sera courageux un jour mais lâche le lendemain.
L'inconstance semble ainsi être le plus grand vice de l'homme : suivant naturellement des passions qui s'actualisent
dans l'instant (et qui sont directement appétits sensibles, d'où le lien avec Hume), il se trouvera agité de
mouvements contraires tout au long de sa vie.
Ainsi, il semble que le moi soit instable, aussi bien dans le sommeil
que dans la vie éveillée.
Même si a priori je pense (jusque dans le rêve qui est imagination, donc une certaine forme
de pensée), cela n'implique pas forcément que je sois le même de manière continue.
Mais au fond, ne pouvons-nous pas aller jusqu'à nous demander si c'est vraiment le moi qui pense ? En effet,
d'après notre réflexion il nous apparaît comme un frêle radeau balloté par une mer déchaînée –mer des passions
impérieuses et contradictoires.
Mais qu'est-ce qui nous empêcherait alors de penser que le moi est autre que la
conscience ? L'identité que nous avons établie entre ces deux termes jusqu'à maintenant venait simplement de la
conception commune.
A ce titre, il est intéressant d'évoquer Freud et sa théorie d'une instance principielle et
autonome, l'inconscient.
Ce dernier, qui par définition échappe bien sûr à la conscience, constitue en fait notre
« moi profond » : il est dans son essence élan vitale de nature sexuelle, c'est-à-dire libido.
S'exprimant sous une
forme détournée –par sublimation- l'inconscient reste totalement inconnu à l'homme mais cependant le commande.
Nous sommes ainsi amenés à une conclusion radicale : je ne suis pas ce que je pense.
La minuscule parcelle de moi
dont j'ai conscience n'est pas ce que je suis.
Nous ne pouvons cependant nous arrêter à ce stade de la réflexion.
En effet, l'idée d'un inconscient comme
instance autonome pose le problème de la relation entre conscience et inconscient – théoriquement assurée par la
censure.
La contradiction vient du fait que cette dernière doit nécessairement être consciente pour savoir ce qu'elle
refoule vers l'inconscient, et inconsciente pour bloquer le passage vers ce dernier.
Ce double statut est
problématique ; de plus, le fait que nous soyons animés par des passions contraires n'implique pas forcément que
notre moi reste passif et docile.
Le fait de dire que je ne sais pas ce que je suis semble un peu exagéré : l'homme est en effet capable
d'auto-objectivation.
Comme le suggère Rousseau dans l'Emile , l'homme s'affirme en pensant.
Il interprète, organise,
aménage le monde, et ainsi se situe au sommet d'une « hiérarchie animale », s'il en est une.
L'idée que la pensée est
ce qu'il y a de plus intime à l'homme est pourtant déjà ancienne : Aristote, dans son Ethique à Nicomaque , définit
l'homme comme « animal raisonnable ».
Il semble effectivement qu'il y ait une identité profonde entre penser (l'usage
de la raison) et être pleinement humain – car qui d'autre que l'homme en est capable ? En me définissant ainsi, je.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « Tout existant naît sans raison, se prolonge par faiblesse et meurt par rencontre » JEAN-PAUL SARTRE
- Puis-je être certain d'avoir raison ?
- On loue plus que de raison la marchandise dont on veut se défaire
- La tradition est-elle un obstacle à la raison ?
- Comment savoir que l'on a raison ?